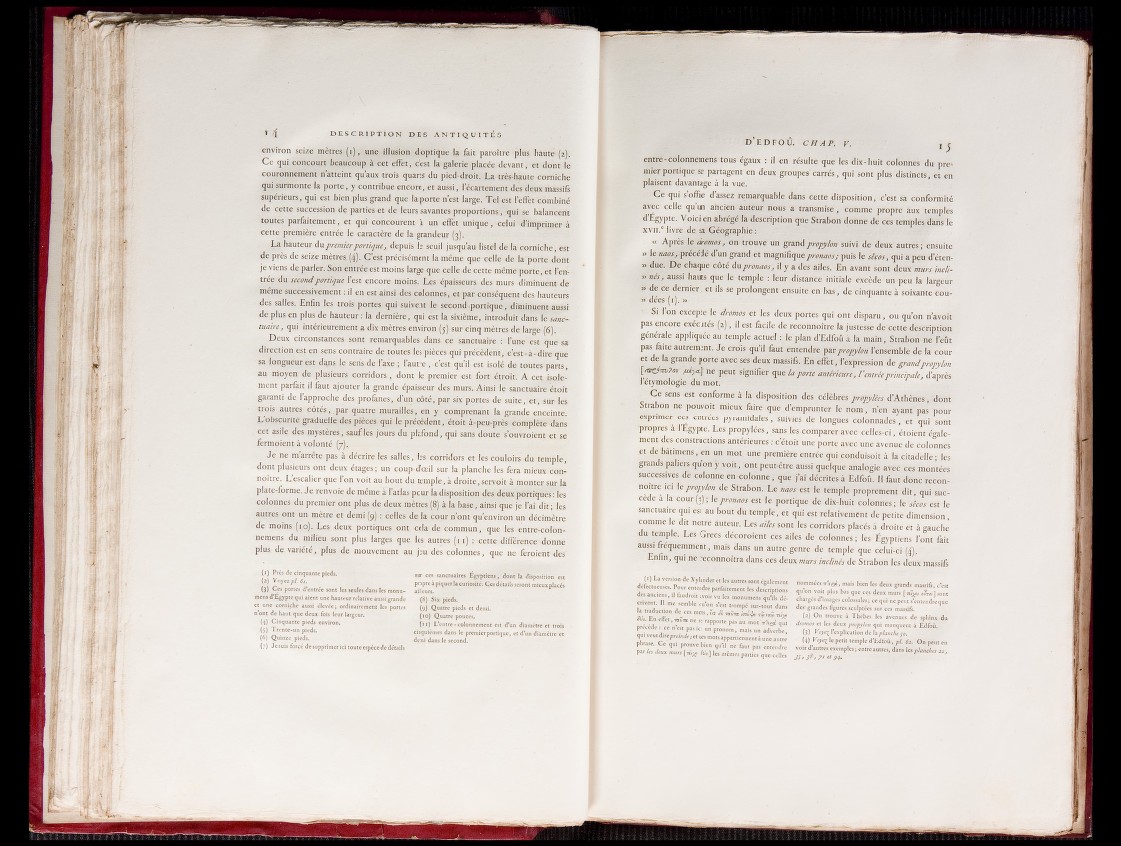
environ seize mètres ( i), une illusion d’optique la fait paroître plus haute (2).
Ce qui concourt beaucoup à cet effet, c’est la galerie placée devant, et dont le
couronnement h atteint quaux trois quarts du pied-droit. La très-haute corniche
qui surmonte la porte, y contribue encore, et aussi, lecartement des deux massifs
supérieurs, qui est bien plus grand que la porte n’est large. Tel est l’effet combiné
de cette succession de parties et de leurs savantes proportions, qui se balancent
toutes parfaitement, et qui concourent à un effet unique, celui d’imprimer à
cette première entrée le caractère de la grandeur (3).
La hauteur Av. premier portique, depuis le seuil jusqu’au listel de la corniche, est
de près de seize mètres (4). C’est précisément la même que celle de la porte dont
je viens de parler. Son entrée est moins large que celle de cette même porte, et l’entrée
du second portique 1 est encore moins. Les épaisseurs des murs diminuent de
même successivement : il en est ainsi des colonnes, et par conséquent des hauteurs
des salies. Enfin les trois portes qui suivent le second .portique, diminuent aussi
de plus en plus de hauteur : la dernière, qui est la sixième, introduit dans le sanctuaire,
qui intérieurement a dix mètres environ (5) sur cinq mètres de large (6).
Deux circonstances sont remarquables dans ce sanctuaire : l’une est que sa
direction est en sens contraire de toutes les pièces qui précèdent, c’est-à-dire que
sa longueur est dans le sens de l’axe ; l’autre , c’est qu’il est isolé dé toutes parts,
au nioyen de plusieurs corridors , dont le premier est fort étroit. A cet isolement
parfait il faut ajouter la grande épaisseur des murs. Ainsi le sanctuaire étoit
garanti de 1 approche des profanes, d’un côté, par six portes de suite, et, sur les
trois autres côtés,. par quatre murailles, en y comprenant la grande enceinte.
L obscurité graduelle des pièces qui le précèdent, étoit à-peu-près complète dans
cet asile des mystères, sauf les jours du plafond, qui sans doute s’ouvroient et se
fermoient à volonté (7).
Je ne marrête pas à décrire les salles, les corridors et les couloirs du temple,
dont plusieurs ont deux étages; un coup-d’oeil sur la planche les fera mieux con-
noîtie. L escalier que 1 on voit au bout du temple, à droite, servoit à monter sur la
plate-forme. Je renvoie de même à l’atlas pour la disposition des deux portiques: les
colonnes du premier ont plus de deux mètres (8) à la base, ainsi que je l’ai dit ; les
autres ont un mètre et demi (9) : celles de la cour n’ont qu’environ un décimètre
de moins (10). Les deux portiques ont cela de commun, que les entre-col'on-
nemens du milieu sont plus larges que les autres (11) : cette différence donne
plus de variété, plus de mouvement au jeu des colonnes, que ne feroient des'
n V iT de " nqoanIe Piei,s- ' « r ces sanctuaires Égyptiens,. dont la disposition est
, 2j n) ez f D , propre à piquer la curiosité. Ces détails seront mieux placés
(3) L ys portes d entree sont les seules dans les tnonu- ailleurs.
mens d E gypte qui aient une hauteur relative aussi grande (8) Six pieds.
et une corniche aussi élevée; ordinairement les portes (9) Quatre pieds et demi,
n’ont de haut que deux fois leur largeur. (10) Quatre pouces.
(4) Cinquante pieds environ. ( 11) L’entre - colonnement est d’un diamètre et trois
X rente_un P,e<k- cinquièmes dans le premierportique, et d’un diamètre et
(6) Quinze pieds. demi dans le second.
(7 ) Jesuis forcé desupprimerici touteespècededétails
entre - colonnemens tous égaux : ¡1 en résulte que les dix-huit colonnes du pre-1
mier portique se partagent en deux groupes'carrés, qui sont plus distincts, et en
plaisent davantage à la vue.
Ce qui s’offre d’assez remarquable dans cette disposition, c’est sa conformité
avec celle qu un ancien auteur nous a transmise, comme propre aux temples
d’Egypte. Voici en abrégé la description que Strabon donne de ces temples dans le
xvn.c livre de sa Géographie :
« Apres le dromos, on trouve un grandpropylon suivi de deux autres; ensuite
» le naos, précédé d un grand et magnifique pronaos; puis le sêcos, qui a peu d’éten-
» due. De chaque côté du pronaos, il y a des ailes. En avant sont deux murs incli-
» nés, aussi hauts que le temple : leur distance initiale excède un peu la largeur
» de ce dernier, et ils se prolongent ensuite en bas, de cinquante à soixante cou-
» dées (i). »
Si l'on excepte le dromos et les deux portes qui ont disparu, ou qu’on n’avoit
pas encore exécutés (2), il est facile de reconnoître la justesse de cette description
généiale appliquée au temple actuel : le plan d’Edfoû à la main, Strabon ne l’eût
pas faite autrement. Je crois qu’il faut entendre par propylon l’ensemble de la cour
et de la grande porte avec ses deux massifs. En effet, l’expression de grand propylon
[«oüttoAm piyo.'l ne peut signifier que la porte antérieure, l ’entrée principale, d’après
l’étymologie du mot.
Ce sens est conforme à la disposition des célèbres propylées d’Athènes , dont
Strabon ne pouvoit mieux faire que d’emprunter le nom, n’en ayant pas pour
exprimer ces entrées pyramidales, suivies de longues colonnades, et qui sont
propres à 1 Egypte. Les propylées, sans les comparer avec celles-ci, étoient également
des constructions antérieures : C’étoit une porte avec une avenue de colonnes
et de batimens, en un mot une première entrée qui conduisoit à la citadelle; les
grands paliers qu’on y voit, ont peut-être aussi quelque analogie avec ces montées
successives de colonne en colonne, que j’ai décrites à EdfoÛ. Il faut donc reconnaître
ici 1 c propylon de Strabon. Le naos est le temple proprement dit, qui succédé
à la cour(3); 11pronaos est le portique de dix-huit colonnes; le sêcos est le
sanctuaire qui est au bout du temple, et qui est relativement de petite dimension,
comme Je dit notre auteur. Les ailes sont les corridors placés à droite et à gauche
du temple. Les Grecs décoroient ces ailes de colonnes ; les Égyptiens l’ont fait
aussi fréquemment, mais dans un autre genre de temple que celui-ci (4).
Enfin, qui ne reconnoitra dans ces deux murs inclinés de Strabon les deux massifs
( 1 ) La version de Xylander et les autres sont également
défectueuses. Pour entendre parfaitement les descriptions
des anciens, il faudroii avoir vu les monumens qu’ils décrivent.
Il me semble qu’on s’est trompé sur-tout dans
■ tr“ducf.°" de ces moK ■ « Jt «8™ ™ »£ „A,
3bo. En effet, mura ne se rapporte pas au n,o tV 1t e è qui
précédé : ce n est pas ici un pronom, mais un adverbe,
qui veut direpm,’» * , . « ces mots appartiennent à une autre
phrase. Ce qui prouve bien qu’il ne faut pas entendre
par les deux murs [rtiyw Jdo] les mêmes parties que celles
nommées rflteè, mais bien les deux grands massifs, c’est
qu’on voit plus bas que ces deux murs [myei où™] sont
chargés d images colossales; ce qui ne peut s’entendre que
des* grandes figures sculptées sur ces massifs.
(2) On trouve a Thèbes les avenues de sphinx du
dromos et les deux propylon qui manquent à Edfoû.
(3) Voyei l’explication de la planche yo.
(4) V°yel le petit temple d’Edfoû, pl. 62. On peut en
voir d’autres exemples; entreautres, dans les planches 20,
3S> 3 8 , ? i et ¡,4.