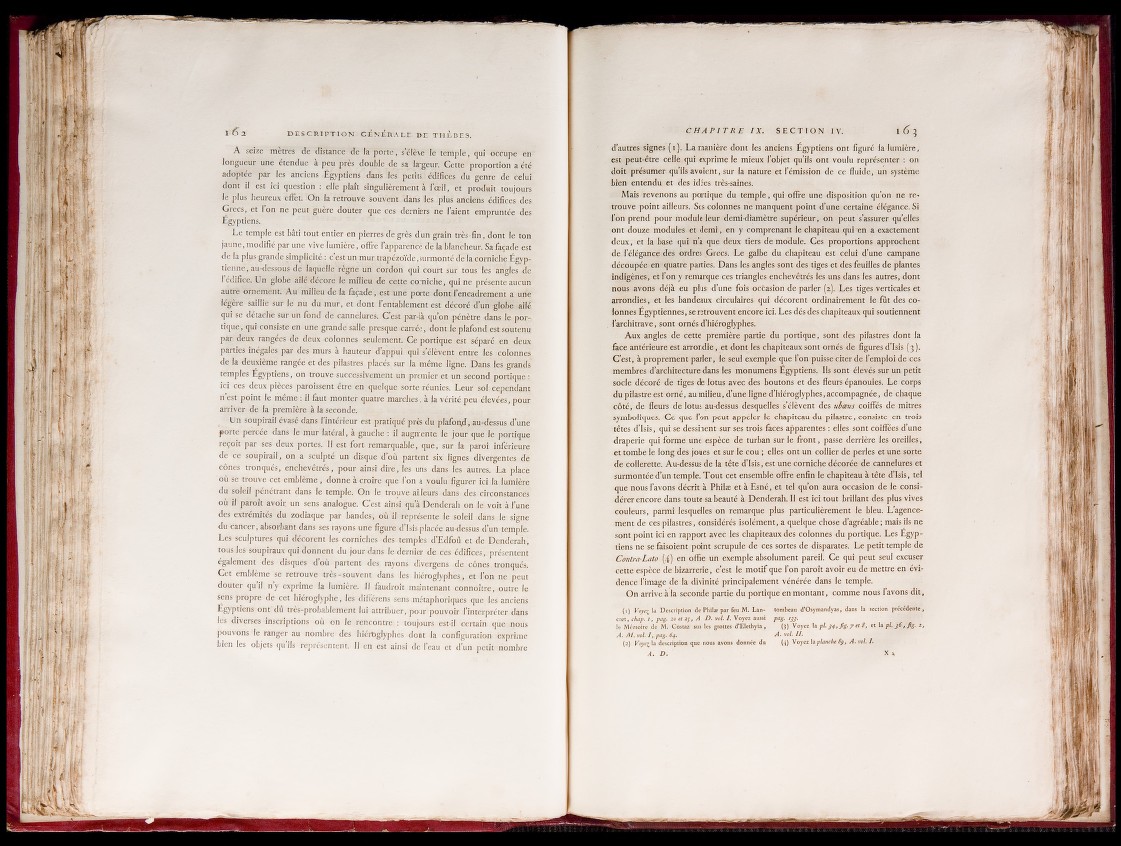
A seize mètres de distance de la porte, s’élève le temple, qui occupe en
longueur une etendue a peu près double de sa largeur. Cette proportion a été
adoptée par les anciens Égyptiens dans les petits édifices du genre de celui
dont il est ici question : elle plaît singulièrement a lceil, et produit toujours
le plus heureux effet. On la retrouve souvent dans les plus anciens édifices des
Grecs, et 1 on ne peut guère douter que ces derniers ne l’aient empruntée des
Égyptiens.
Le temple est bati tout entier en pierres de grès d’un grain très-fin, dont le ton
jaune, modifié par une vive lumière, offre l’apparence de la blancheur. Sa façade est
de la plus grande simplicité : c’est un mur trapézoïde, surmonté de la corniche Égyptienne,
au-dessous de laquelle règne un cordon qui court sur tous les angles de
1 édifice. Un globe aile decore le milieu de cette corniche, qui ne présente aucun
autre ornement. Au milieu de la façade, est une porte dont l’encadrement a une
légère saillie sur le nu du mur, et dont l’entablement est décoré d’un globe ailé
qui se détaché sur un fond de cannelures. C’est par-là qu’on pénètre dans le portique,
qui consiste en une grande salle presque carrée, dont le plafond est soutenu
par deux rangées de deux colonnes seulement. Ce portique est séparé en deux
parties inégales par des murs à hauteur d’appui qui s’élèvent entre les colonnes
de la deuxième rangée et des pilastres placés sur la même ligne. Dans les grands
temples Égyptiens, on trouve successivement un premier et un second portique :
ici ces deux pièces paraissent être en quelque sorte réunies. Leur sol cependant
n’est point le même : il faut monter quatre marches, à la vérité peu élevées, pour
arriver de la première à la seconde.
Un soupirail evase dans 1 intérieur est pratiqué près du plafond, au-dessus d’une
porte percée dans le mur latéral, à gauche : il augmente le jour que le portique
reçoit par ses deux portes. 11 est fort remarquable, que, sur la paroi inférieure
de ce soupirail, on a sculpte un disque d où partent six lignes divergentes de
cônes tronqués, enchevêtrés, pour ainsi dire, les uns dans les autres. La place
où se trouve cet emblème , donne à croire que l’on a voulu figurer ici la lumière
du soleil pénétrant dans le temple. On le trouve ailleurs dans des circonstances
où il paraît avoir, un sens analogue. C’est ainsi qu’à Denderah on le voit à l’une
des extrémités du zodiaque par bandes, ou il représente le soleil dans le signe
du cancer, absorbant dans ses rayons une figure d’ïsis placée au-dessus d’un temple.
Les sculptures qui décorent les corniches des temples d’Edfoû et de Denderah,
tous les soupiraux qui donnent du jour dans le dernier de ces édifices, présentent
également des disques d’où partent des rayons divergens de cônes. tronqués.
Cet emblème se retrouve très-souvent dans les hiéroglyphes, et l’on ne peut
douter quil ny exprime la lumière. Il faudrait maintenant connoître, outre le
sens propre de cet hiéroglyphe, les differens sens métaphoriques que les anciens
Égyptiens ont dû très-probablement lui attribuer, pour pouvoir l’interpréter dans
les diverses inscriptions où on le rencontre : toujours est-il certain que nous
pouvons le ranger au nombre des hiéroglyphes dont la configuration exprime
bien les objets qu ils représentent. Il en est ainsi de l’eau et d’un petit nombre
d’autres signes (i). La manière dont les anciens Égyptiens ont figuré la lumière,
est peut-être celle qui exprime le mieux l’objet qu’ils ont voulu représenter : on
doit présumer qu’ils avoient, sur la nature et l’émission de ce fluide, un système
bien entendu et des idées très-saines.
Mais revenons au portique du temple, qui offre une disposition qu’on ne retrouve
point ailleurs. Ses colonnes ne manquent point d’une certaine élégance. Si
l’on prend pour module leur demi-diamètre supérieur, on peut s’assurer qu’elles
ont douze modules et demi, en y comprenant le chapiteau qui en a exactement
deux, et la base qui n’a que deux tiers démodulé. Ces proportions approchent
de l’élégance des ordres Grecs. Le galbe du chapiteau est celui d’une campane
découpée en quatre parties. Dans les angles sont des tiges et des feuilles de plantes
indigènes, et l’on y remarque ces triangles enchevêtrés les uns dans les autres, dont
nous avons déjà eu plus d’une fois occasion de parler (z). Les tiges verticales et
arrondies, et les bandeaux circulaires qui décorent ordinairement le fût des colonnes
Égyptiennes, se retrouvent encore ici. Les dés des chapiteaux qui soutiennent
l’architrave, sont ornés d’hiéroglyphes.
Aux angles de cette première partie du portique, sont des pilastres dont la
face antérieure est arrondie, et dont les chapiteaux sont ornés de figures d’Isis ( 3 ).
C’est, à proprement parler, le seul exemple que l’on puisse citer de l’emploi de ces
membres d’architecture dans les monumens Égyptiens. Ils sont élevés sur un petit
socle décoré de tiges de lotus avec des boutons et des fleurs épanouies. Le corps
du pilastre est orné, au milieu, d’une ligne d’hiéroglyphes, accompagnée, de chaque
côté, de fleurs de lotus au-dessus desquelles s’élèvent des uboeus coiffes de mitres
symboliques. Ce que l’on peut appeler le chapiteau du pilastre, consiste en trois
têtes d’Isis, qui se dessinent sur ses trois faces apparentes : elles sont coiffées d’une
draperie qui forme une espèce de turban sur le front, passe derrière les oreilles,
et tombe le long des joues et sur le cou ; elles ont un collier de perles et une sorte
de collerette. Au-dessus de la tête d’Isis, est une corniche décorée de cannelures et
surmontée d’un temple. Tout cet ensemble offre enfin le chapiteau à tête d’Isis, tel
que nous l’avons décrit à Philæ et à Esné, et tel qu’on aura occasion de le considérer
encore dans toute sa beauté à Denderah. Il est ici tout brillant des plus vives
couleurs, parmi lesquelles on remarque plus particulièrement le bleu. L ’agencement
de ces pilastres, considérés isolément, a quelque chose d’agréable; mais ils ne
sont point ici en rapport avec les chapiteaux des colonnes du portique. Les Égyptiens
ne se faisoient point scrupule de ces sortes de disparates. Le petit temple de
Contra-Lato (4) en offre un exemple absolument pareil. Ce qui peut seul excuser
cette espèce de bizarrerie, c’est le motif que l’on paraît avoir eu de mettre en évidence
l’image de la divinité principalement vénérée dans le temple.
On arrive à la seconde partie du portique en montant, comme nous l’avons dit,
(1) Voye^ la Description de Philæ par feu M. Lan- tombeau d’Osymandyas, dans la section précédente,
cret, chap. l , pag. 20 et 2p. A . D . vol. I . Voyez aussi pag. 133.
ie Mémoire de M. Costaz sur les grottes d’Elethyia, (3) Voyez la pl. 3 4 , f g . 7 et S , et la pl. 3 6 , Jig. 2 ,
A . M , vol. I , pag. 64. A . vol. I I .
(2) Voye^ la description que nous avons donnée du (4) Voyez la planche 83, A . vol. I.
A . D . X t