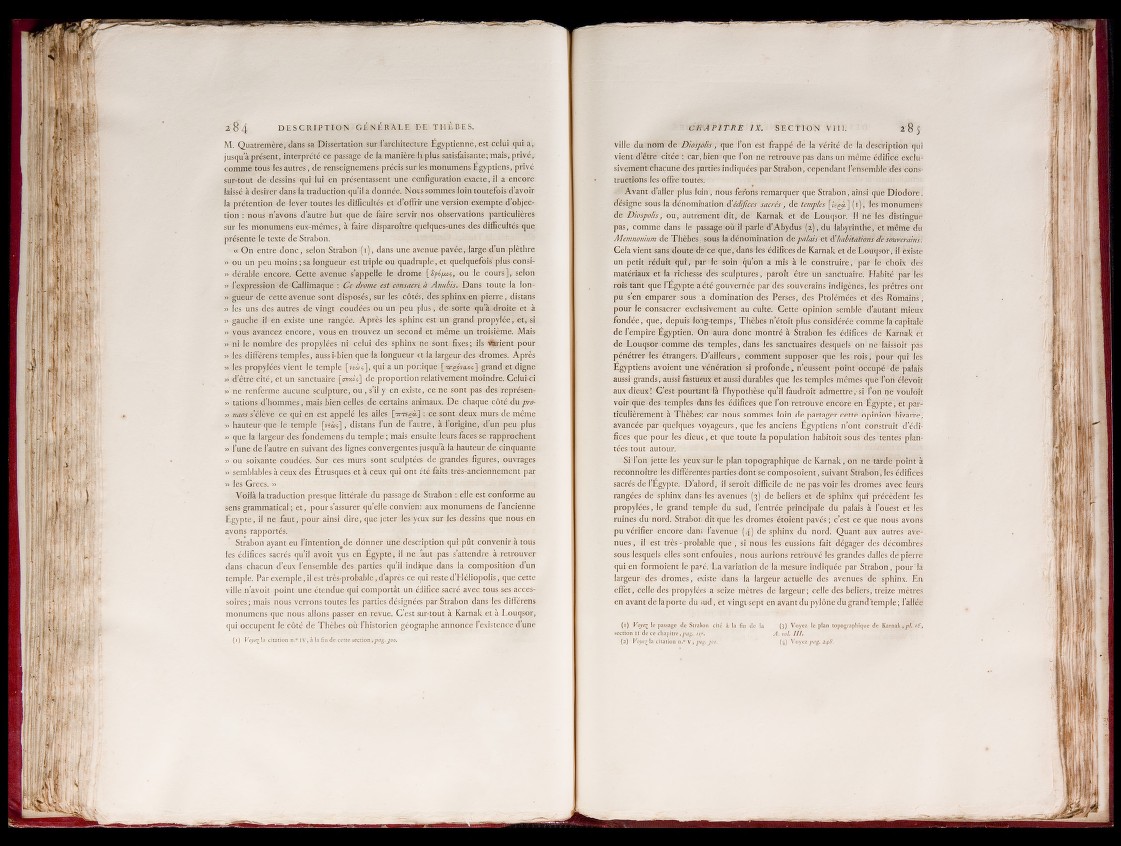
2 8 4 D E S C R I P T I O N G É N É R A L E D E T H È B E S .
M. Quatremère, dans sa Dissertation sur l’architecture Égyptienne, est celui qui a,
jusqu’à présent, interprété ce passage de la manière la plus satisfaisante; mais, privé,
comme tous les autres, de renseignemens précis sur les monumens Égyptiens, privé
sur-tout de dessins qui lui en présentassent une configuration exacte, il a encore
laissé à desirer dans la traduction qu’ila donnée. Nous sommes loin toutefois d’avoir
la prétention de lever toutes les difficultés et d’offrir une version exempte d’objection
: nous n’avons d’autre but que de faire servir nos observations particulières
sur les monumens eux-mêmes, à faire disparoître quelques-unes des difficultés que
présente le texte de Strabon.
I On entre donc, selon Strabon (1) , dans une avenue pavée, large d’un plèthre
» ou un peu moins ; sa longueur est triple ou quadruple, et quelquefois plus consi-
» dérable encore. Cette avenue s’appelle le drome [Sfôfxtn, ou le cours], selon
» l’expression de Callimaque : Ce drome est consacré à Anubis. Dans toute la lon-
» gueur de cette avenue sont disposés, sur les côtés, des sphinx en pierre, distans
» les uns des autres de vingt coudées ou un peu plus, de sorte qu’à droite et à
» gauche il en existe une rangée. Après les sphinx est un grand propylée, et, si
» vous avancez encore, vous en trouvez un second et même un troisième. Mais
» ni le nombre des propylées ni celui des sphinx ne sont fixes ; ils ifarient pour
» les différens temples, aussi-bien que la longueur et la largeur des drornes. Après
5) les propylées vient le temple [vsàs], qui a un portique [«¿¿«.05] grand et digne
» d’être cité, et un sanctuaire [otxo'î] de proportion relativement moindre. Celui-ci
» ne renferme aucune sculpture, ou , s’il y en existe, ce ne sont pas des représen-
» tâtions d’hommes, mais bien celles de certains animaux. De chaque côté dupro-
» naos s’élève ce qui en est appelé les ailes [Tregi] : ce sont deux murs de même
y> hauteur que le temple [veàs], distans l’un de l’autre, à l’origine, d’un peu plus
» que la largeur des fondemens du temple ; mais ensuite leurs faces se rapprochent
» l’une de l’autre en suivant des lignes convergentes jusqu’à la hauteur de cinquante
» ou soixante coudées. Sur ces murs sont sculptées de grandes figures, ouvrages
» semblables à ceux des Étrusques et à ceux qui ont été faits très-anciennement par
» les Grecs. »
Voilà la traduction presque littérale du passage de Strabon : elle est conforme au
sens grammatical; et, pour s’assurer quelle convient aux monumens de 1 ancienne
Égypte, il ne faut, pour ainsi dire, que jeter les yeux sur les dessins que nous en
avons rapportés.
Strabon ayant eu l’intention de donner une description qui pût convenir à tous
les édifices sacrés qu’il avoit vus en Égypte, il ne faut pas s’attendre à retrouver
dans chacun d’eux l’ensemble des parties qu’il indique dans la composition d’un
temple. Par exemple, il est très-probable, d’après ce qui reste d’Héliopolis, que cette
ville n’avoit point une étendue qui comportât un édifice sacré avec tous ses accessoires;
mais nous verrons toutes les parties désignées par Strabon dans les différens
monumens que nous allons passer en revue. C’est sur-tout à Karnak et à Louqsor,
qui occupent le côté de Thèbes où l’historien géographe annonce l’existence d’une
( 1 ) V o y e ^ la c i t a t i o n n . ° I V , à la f in d e c e t t e s e c t i o n , p a g . j o o .
ville du nom de Dlospolis, que l’on est frappé de la vérité de la description qui
vient d’être citée ; car, bien que l’on ne retrouve pas dans un même édifice exclusivement
chacune des parties indiquées par Strabon, cependant l’ensemble des constructions
les offre toutes.
Avant d aller plus loin , nous ferons remarquer que Strabon, ainsi que Diodore,
désigne sous la dénomination d ’édifiées sacrés■, de temples [/sg^] (1), les monumens
de Diospolis, ou, autrement dit, de Karnak et de Louqsor. Il né les distingue
pas, comme dans le passage où il parle d’Abydus (2), du labyrinthe, et même du
Memnonium de Thèbes, sous la dénomination de palais et d’habitations déscniverains:
Cela vient sans doute de ce que, dans les édifices de Karnak et de Louqsor, il existe
un petit réduit qui, par le soin qu’on a mis à le construire, pàr le choix des
matériaux et la richesse des sculptures, pâroît être un sanctuaire. Habité par les
rois tant que l’Égypte a été gouvernée par dés souverains indigènes, les prêtres ont
pu s’en emparer sous la domination des Perses, des Ptoléméës et des Romains,
pour le consacrer exclusivement au culte. Cette opinion semblé d’autant mieux
fondée, que, depuis longtemps, Thèbes netoit plus considérée comme la capitale
de l’empire Égyptien. On aura donc montré à Strabon les édifices de Karnak èt
de Louqsor comme des temples, dans les sanctuaires desquels ôn né lâissoit pâs
pénétrer les étrangers. D’ailleurs, comment supposer que les rois, pour qui les
Égyptiens avoient une vénération si profonde, n’eussênt point occupé de palais
aussi grands, aussi fastueux et aussi durables que les temples mêmes que l’on élevoit
aux dieux! C’est pourtant là l’hypothèse qu’il faudrôit admettre,'si l’on rje vouloit
voir que des temples dahs les édifices que l’on retrouvé encore èn Égypte, et particulièrement
à Thèbes; car nous sommes loin de partager cette opinion bizarre,
avancée par quelques voyageurs, que les anciens Égyptiens n’ont construit d’édifices
que pour les dieux, et que toute la population habitoit sous des tentes plantées
tout autour.
Si l’on jette les yeux sur le plan topographique de Karnak, on ne tarde point à
reconnoître les différentes parties dont se compôsoient, suivant Strabon, les édifices
sacrés de l’Égypte. D’abord, il seroit difficile de ne pas voir lés drornes avec leurs
rangées de sphinx dans les avenues (3) de beliers et de sphinx qui précèdent les
propylées, le grand temple du sud, l’entrée principale du palais à l’ouest et les
ruines du nord. Strabon dit que les drornes étoient pavés ; c’est ce que nous avons
pu vérifier encore dans l’avenue (4) de sphinx du nord. Quant aux autres avenues,
il est très - probable que, si nous les eussions fait dégager des décombres
sous lesquels elles sont enfouies, nous aurions retrouvé les grandes dalles de pierre
qui en formoient le pavé. La variation de la mesure indiquée par Strabon, pourla
largeur des dromes, existe dans la largeur actuelle des avenues de sphinx. En
effet, celle des propylées a seize mètres de largeur; celle des beliers, treize mètres
en avant de laporte du sud, et vingt-sept en avant du pylône du grand temple ; l’allée
(1) Voyt^ le passage de Strabon cité à la fin de la (3) Voyez le plan topographique de Karnak,pl. 16.,,
section 11 de ce chapitre,pag. u j , A . vol. I I I .
(2) Voyc^ la citation n.° v , vag.jor. ‘ . (/]) Voyez pag. 24.8.