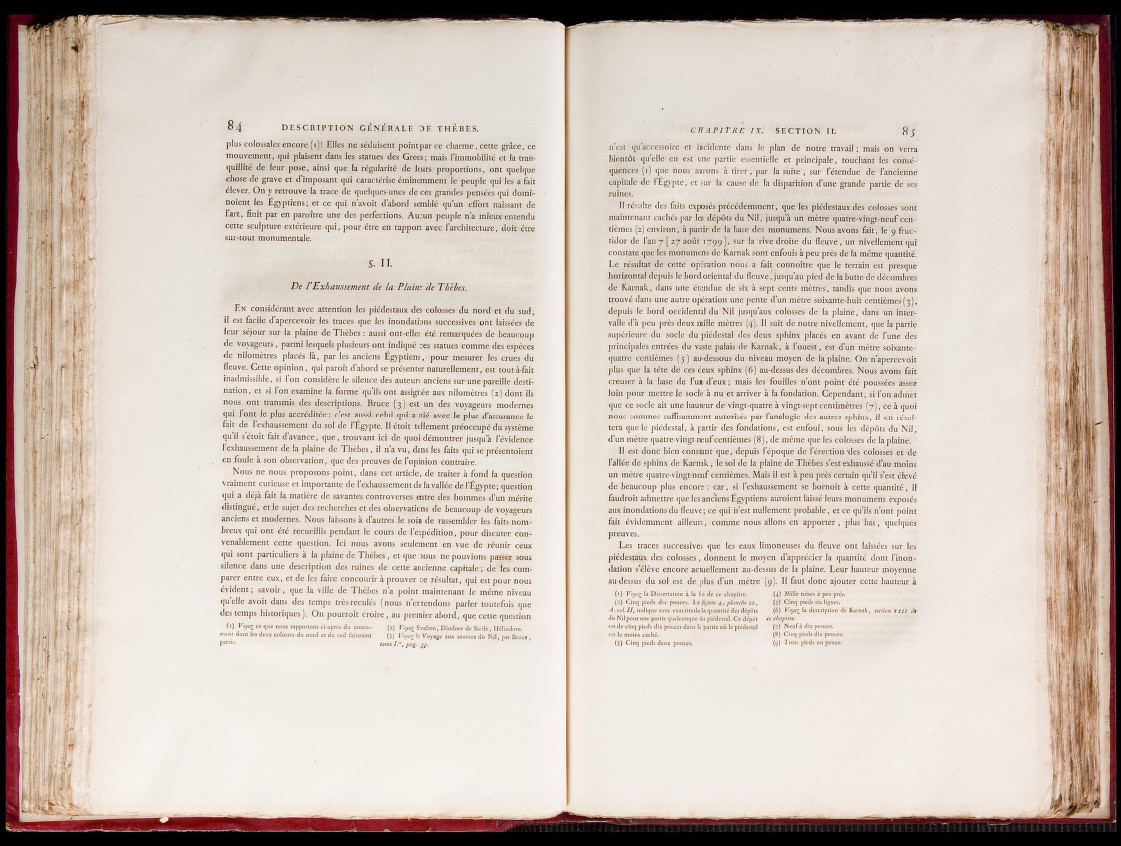
plus colossales encore ( i)î Elles ne séduisent point par ce charme, cette grâce, ce
mouvement, qui plaisent dans les statues des Grecs; mais l’immobilité et la tranquillité
de leur pose, ainsi que la régularité de leurs proportions, ont quelque
chose de grave et d imposant qui caractérise éminemment le peuple qui les a fait
élever. On y retrouve la trace de quelques-unes de ces grandes pensées qui domi-
noient les Egyptiens; et ce qui n’avoit d’abord semblé qu’un effort naissant de
lart, finit par en paroître une des perfections. Aucun peuple n’a mieux entendu
cette sculpture extérieure qui, pour être en rapport avec l’architecture, doit être
sur-tout monumentale.
§■ I I .
De l ’Exhaussement de la P laine de Thebes.
E n considérant avec attention les piédestaux des colosses du nord et du sud,
il est facile d’apercevoir les traces que les inondations successives ont laissées de
leur séjour sur la plaine de Thèbes : aussi ont-elles été remarquées de beaucoup
de voyageurs, parmi lesquels plusieurs ont indiqué ces statues comme des espèces
de nilomètres placés là, par les anciens Égyptiens, pour mesurer les crues du
fleuve. Cette opinion, qui paraît d’abord se présenter naturellement, est tout-à-fait
inadmissible, si 1 on considère le silence des auteurs anciens sur une pareille destination,
et si l’on examine la fonne qu’ils ont assignée aux nilomètres (2) dont ils
nous ont transmis des descriptions. Bruce (3) est un des voyageurs modernes
qui l’ont le plus accréditée ; c’est aussi celui qui a nié avec le plus d’assurance le
fait de l’exhaussement du sol de l’Egypte. Il étoit tellement préoccupé du système
quil serait fait d’avance, que, trouvant ici de quoi démontrer jusqu’à l’évidence
1 exhaussement de la plaine de Thebes, il n a vu, dans les faits qui se présentoient
en foule a son observation, que des preuves de l’opinion contraire.
Nous ne nous proposons point, dans cet article, de traiter à fond la question
vraiment curieuse et importante de l’exhaussement de la vallée de l’Egypte; question
qui a déjà fait la matière de savantes controverses entre des hommes d’un mérite
distingué, et le sujet des recherches et des observations de beaucoup de voyageurs
anciens et modernes. Nous laissons à d’autres le soin de rassembler les faits nombreux
qui ont été recueillis pendant le cours de l’expédition, pour discuter convenablement
cette question. Ici nous avons seulement en vue de réunir ceux
qui sont particuliers à la plaine de Thèbes , et que nous ne pouvions passer sous
silence dans une description des ruines de cette ancienne capitale ; de les comparer
entre eux, et de les faire concourir a prouver ce résultat, qui est pour nous
évident ; savoir,. que la ville de Thèbes n’a point maintenant le même niveau
qu’elle avoit dans des temps très-reculés (nous n’entendons parler toutefois que
des temps historiques ). On pourroit croire, au premier abord, que cette question
(1) Voyez ce que nous rapportons ci-après du raonu- (i) Koyej Strabon, Diodore de Sicile, Héliodore.
ment dont les deux colosses du nord et du sud faisoient (3) Koyrj le Voyage aux sources du N il, par Bruce ,
P a r l *e ’ tome I p a g . i j j .
n’est qu accessoire et incidente dans le plan de notre travail ; mais on verra
bientôt quelle en est une partie essentielle et principale, touchant les conséquences
(1) que nous aurons à tirer, par la suite , sur l’étendue de l’ancienne
capitale de 1 Egypte, et sur la cause de la disparition d’une grande partie de ses
ruines.
Il résulte des faits exposés précédemment, que les piédestaux des colosses sont
maintenant cachés par les dépôts du Nil, jusqu’à un mètre quatre-vingt-neuf centièmes
(2) environ, à partir de la base des monumens. Nous avons fait, le 9 fructidor
de l’an 7 [ 27 août 1799 ], sur la rive droite du fleuve, un nivellement qui
constate que les monumens de Karnak sont enfouis à peu près de la même quantité.
Le résultat de cette opération nous a fait connoître que le terrain est presque
horizontal depuis le bord oriental du fleuve,' jusqu’au pied de la butte de décombres
de Karnak, dans une étendue de six à sept cents mètres, tandis que nous avons
trouvé dans une autre opération une pente d’un mètre soixante-huit centièmes (3);
depuis le bord occidental du Nil jusqu’aux colosses de la plaine, dans un intervalle
d’à peu près deux mille mètres (4). Il suit de notre nivellement, que la partie
supérieure du socle du piédestal des deux sphinx placés en avant de l’une des
principales entrées du vaste palais de Karnak, à l’ouest, est d’un mètre soixante-
quatre centièmes ( y ) au-dessous du niveau moyen de la plaine. On n’apercevoit
plus que la tête de ces deux sphinx (6) au-dessus des décombres. Nous avons fait
creuser à la base de l’un d’eux; mais les fouilles n’ont point été poussées assez
loin pour mettre Je socle à nu et arriver à la fondation. Cependant, si l’on admet
que ce socle ait une hauteur de vingt-quatre à vingt-sept centimètres (7), ce à quoi
nous sommes suffisamment autorisés par l’analogie des autres sphinx, il en résultera
que le piédestal, à partir des fondations, est enfoui, sous les dépôts du Nil,
d’un mètre quatre-vingt-neuf centièmes (8), de même que les colosses de la plaine.
Il est donc bien constant que, depuis l’époque de l’érection 'des colosses et de
1 allée de sphinx de Karnak, le sol de la plaine de Thèbes s’est exhaussé d’au moins
un mètre quatre-vingt-neuf centièmes. Mais il est à peu près certain qu’il s’est élevé
de beaucoup plus encore : car, si l’exhaussement se bornoit à cette quantité, il
faudrait admettre que les anciens Égyptiens auraient laissé leurs monumens exposés
aux inondations du fleuve ; ce qui n’est nullement probable, et ce qu’ils n’ont point
fait évidemment ailleurs, comme nous allons en apporter, plus bas, quelques
preuves.
Les traces successives que les eaux limoneuses du fleuve ont laissées sur les
piédestaux des colosses, donnent le moyen d’apprécier la quantité dont l’inondation
s’élève encore actuellement au-dessus de la plaine. Leur hauteur moyenne
au-dessus du sol est de plus d’un mètre (9). Il faut donc ajouter cette hauteur à
(>) Voye^ la Dissertation à la fin de ce chapitre. (4) Mille toises à peu près.
(2) Cinq pieds dix pouces. La figure 4 , planche 2 2 , (5) Cinq pieds six lignes.
A . vo l.II, indique avec exactitude la quantité des dépôts (6) Voye^ la description de Karnak, section v i n de
du Nil pour une partie quelconque du piédestal. Ce dépôt ce chapitre.
est de cinq pieds dix pouces dans la partie où le piédestal (7) Neuf à dix pouces.
est le moins caché. (8) Cinq pieds dix pouces.
(3) Cinq pieds deux pouces. (9) Trois pieds un pouce.