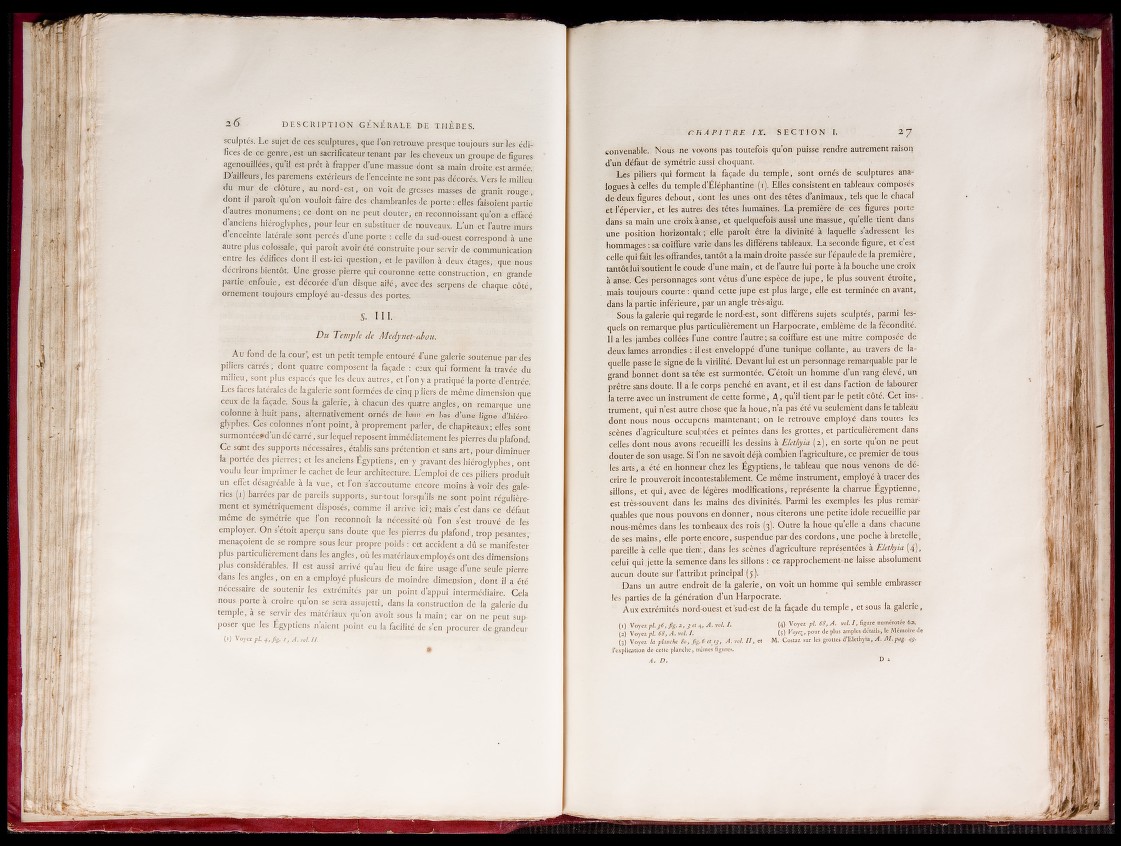
sculptés. Le sujet de ces sculptures, que 1 on retrouve presque toujours sur les édifices
de ce genre, est un sacrificateur tenant par les cheveux un groupe de figures
agenouillées, qui! est prêt a frapper dune massue dont sa main droite est armée.
D ’ailleurs, les paremens extérieurs de l’enceinte ne sont pas décorés. Vers le milieu
du mur de clôture, au nord-est, on voit de grosses masses de granit rouge,
dont il paroît qu’on vouloit faire des chambranles de porte : elles faisoient partie
d autres monumens; ce dont on ne peut douter, en reconnoissant qu’on a eflacé
d’anciens hiéroglyphes, pour leur en substituer de nouveaux. L ’un et l’autre murs
d enceinte latérale sont perces d une porte : celle du sud-ouest correspond à une
autre plus colossale, qui paroît avoir été construite pour servir de communication
entre les édifices dont il est- ici question, et le pavillon à deux étages, que nous
décrirons bientôt. Une grosse pierre qui couronne cette construction, en grande
partie enfouie, est décorée d’un disque ailé, avec des serpens de chaque côté,
ornement toujours employé au-dessus des portes.
5 - III.
Du Temple de Medynet-abou.
Au fond de la cour”, est un petit temple entouré d’une galerie soutenue par des
piliers carres, dont quatre composent la façade : ceux qui forment la travée du
milieu, sont plus espacés que les deux autres, et l’on y a pratiqué la porte d’entrée.
Les faces latérales de la galerie sont formées de cinq piliers de même dimension que
ceux de la façade. Sous la galerie, à chacun des quatre angles, on remarque une
colonne à huit pans, alternativement ornés de haut en bas d’une ligne d’hiéroglyphes.
Ces colonnes n’ont point, à proprement parier, de chapiteaux; elles sont
surmontée»d’un dé carré, sur lequel reposent immédiatement les pierres du plafond.
Ce sont des supports nécessaires, établis sans prétention et sans art, pour diminuer
la portée des pierres ; et les anciens Égyptiens, en y gravant des hiéroglyphes, ont
voulu leur imprimer le cachet de leur architecture. L ’emploi de ces piliers produit
un effet désagréable à la vue, et l’on s’accoutume encore moins à voir des galeries
(j) barrées par de pareils supports, sur-tout lorsqu’ils ne sont point régulièrement
et symétriquement disposes, comme il arrive ici; mais c’est dans ce défaut
même de symétrie que l’on reconnoît la nécessité où l’on s’est trouvé de les
employer. On sétoit aperçu sans doute que les pierres du plafond, trop pesantes,'
menaçoient de se rompre sous leur propre poids : cet accident a dû se manifester
plus particulièrement dans les angles, où les matériaux employés ont des dimensions
plus considérables. Il est aussi arrivé qu’au lieu de faire usage d’une seule pierre
dans les angles, on en a employé plusieurs de moindre dimension, dont il a été
nécessaire de soutenir les extrémités par un point d’appui intermédiaire. Cela
nous porte a croire quon se sera assujetti, dans la construction de la galerie du
temple, a se servir des matériaux quon avoit sous la main; car on ne peut supposer
que les Égyptiens n aient point eu la facilité de s’en procurer de grandeur
( 0 Voyez pl. 4 , fig. / , A . vol. //.
convenable. Nous ne voyons pas toutefois qu’on puisse rendre autrement raison
d’un défaut de symétrie aussi choquant.
Les piliers qui forment la façade du temple, sont ornés de sculptures analogues
à celles du temple d’Éléphantine (ij. Elles consistent en tableaux composés
de deux figures debout, dont les unes ont des têtes d’animaux, tels que le chacal
e tl’épervier, et les autres des têtes humaines. La première de ces figures porte
dans sa main une croix à anse, et quelquefois aussi une massue, quelle tient dans
une position horizontale ; elle paroît être la divinité a laquelle s’adressent les
hommages : sa coiffure varie dans les différens tableaux. La seconde figure, et c’est
celle qui fait les offrandes, tantôt a la main droite passée sur l’épaule de la première,
tantôt lui’soutient le coude d’une main, et de l’autre lui porte à la bouche une croix
à anse. Ces personnages sont vêtus d’une espèce de jupe, le plus souvent étroite,
mais toujours courte : quand cette jupe est plus large, elle est terminée en avant,
dans la partie inférieure, par un angle très-aigu.
Sous la galerie qui regarde le nord-est, sont différens sujets sculptés, parmi lesquels
on remarque plus particulièrement un Harpocrate, emblème de la fécondité.
Il a les jambes collées l’une contre l’autre ; sa coiffure est une mitre composée de
deux lames arrondies : il est enveloppé d’une tunique collante, au travers de laquelle
passe le signe de la virilité. Devant lui est un personnage remarquable par le
grand bonnet dont sa tête est surmontée. C e toit un homme d’un rang élevé, un
prêtre sans doute. Il a le corps penché en avant, et il est dans l’action de labourer
la terre avec un instrument de cette forme, A , qu’il tient par le petit côté. Cet ins- .
trument, qui n’est autre chose que la houe, n’a pas été vu seulement dans le tableau
dont nous nous occupons maintenant; on le retrouve employé dans toutes les
scènes d’agriculture sculptées et peintes dans les grottes, et particulièrement dans
celles dont nous avons recueilli les dessins à Eletlyia (2), en sorte qu’on ne peut
douter de son usage. Si l’on ne savoit déjà combien l’agriculture, ce premier de tous
les arts, a été en honneur chez les Égyptiens, le tableau que nous venons de décrire
le pr.ouveroit incontestablement. Ce même instrument, employé à tracer des
sillons, et qui, avec de légères modifications, représente la charrue Égyptienne,
est très-souvent dans les mains des divinités. Parmi les exemples les plus remarquables
que nous pouvons en donner, nous citerons une petite idole recueillie par
nous-mêmes dans les tombeaux des rois (3). Outre la houe qu elle a dans chacune
de ses mains, elle porte encore, suspendue par des cordons, une poche a bretelle,
pareille à celle que tient, dans les scènes d’agriculture représentées à Eletlyia (4),
celui qui .jette la semence dans les sillons : ce rapprochement-ne laisse absolument
aucun doute sur l’attribut principal (y).
Dans un autre endroit de la galerie, on voit un homme qui semble embrasser
lés parties de la génération d’un Harpocrate.
Aux extrémités nord-ouest et sud-est de la façade du temple, et sous la galerie,
(,) Voyez p l . j6 , fis- 2 , y et 4 , A . vol. I . (4) Voyez pl. 68, A . vol. I , figure numérotée 62,
(z) Voyez pl. 68, A . vol. I . (y) Voyej, pour de plus amples détails, le Mémoire de
(3) Voyez la planche 80, fig. 6 et i j , A . vol. I I , et M. Costaz sur les grottes d’EIethyia, A . M .p a g . 4p.
l’explication de cette planche, mêmes figures.