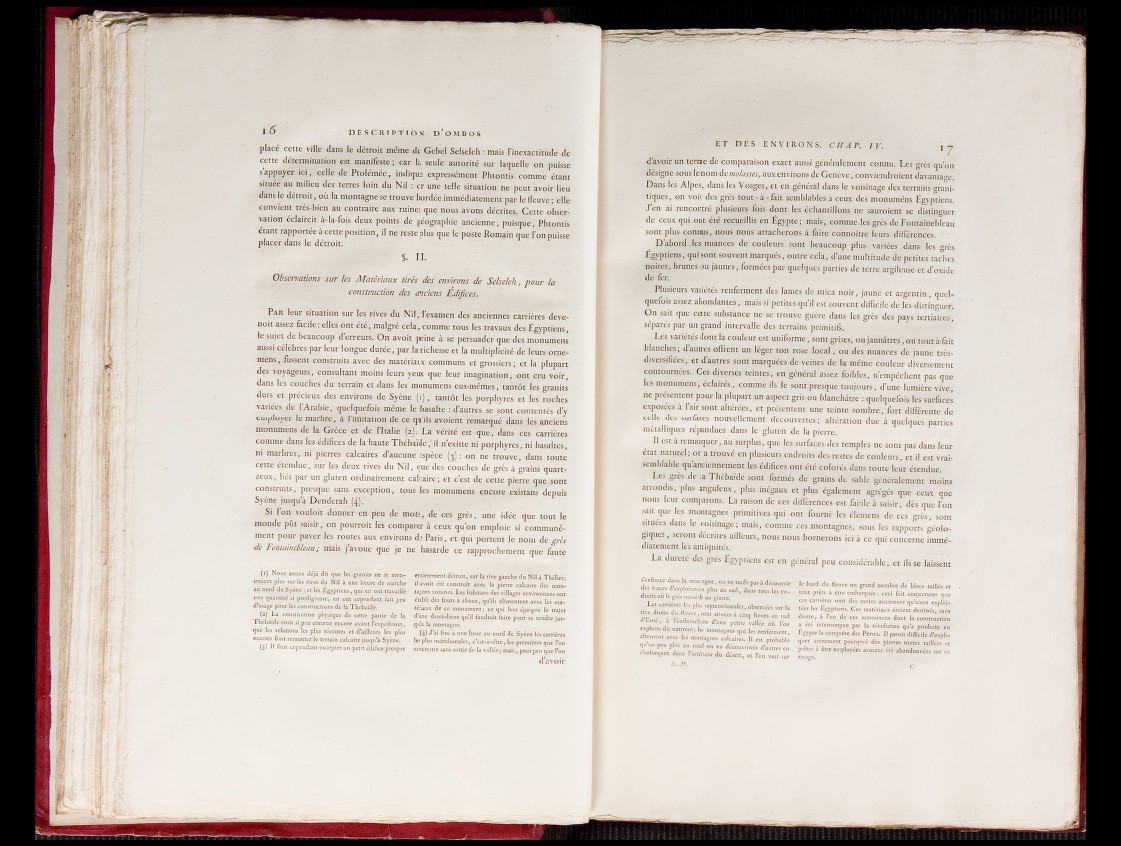
placé cette ville dans le détroit même de Gebel Selseleh : mais l’inexactitüde de
cette détermination est manifeste ; car la seule autorité sur laquelle on puisse
s’appuyer ici, celle de Ptolémée, indique expressément Phtontis. comme étant
située au milieu des terres loin du Nil : or une telle situation ne peut avoir lieu
dansle détroit, ou la montagne se trouve bordée immédiatement par le fleuve; elle
convient tres-bien au contraire aux ruines que nous avons décrites. Cette observation
éclaircit à-la-fois deux points de géographie ancienne, puisque, Phtontis
étant rapportée à cette position, il ne reste plus que le poste Romain que l’on puisse
placer dans le détroit.
S. I I .
Observations sur les Matériaux tirés des environs de Selseleh, pour la
construction des anciens Édifices.
P a r leur situation sur les rives du Nil, l’examen des anciennes carrières deve-
noit assez facile : elles ont été, malgré cela, comme tous les travaux des Égyptiens,
le sujet de beaucoup d erreurs. On avoit peine à se persuader que des monumens
aussi célèbres par leur longue durée, par la richesse et la multiplicité de leurs orne-
mens, fussent construits avec des matériaux communs et grossiers; et la plupart
des voyageurs, consultant moins leurs yeux que leur imagination, ont cru voir,
dans les couches du terrain et dans les monumens eux-mêmes, tantôt les granits
durs et précieux des environs de Syène ( i) , tantôt les porphyres et les roches
variées de l’Arabie, quelquefois même le basalte : d’autres se sont contentés d’y
employer le marbre, à limitation de ce qu’ils avoient remarqué dans les anciens
monumens de la Grèce et de 1 Italie (2). La vérité est que, dans ces carrières
comme dans les édifices de la haute Thébaïde, 'il n’existe ni porphyres, ni basaltes,
ni marbtes, ni pierres calcaires d aucune espèce (3) : on ne trouve, dans toute
cette étendue, sur les deux rives du Nil, que des couches de grès à grains quart-
zeux, liés par un gluten ordinairement calcaire; et c’est de cette pierre que sont
construits, presque sans exception, tous les monumens encore existans depuis
Syène jusqu’à Denderah (4).
Si l’on vouloit donner en peu de mots, de ces grès, une idée que tout le
monde pût saisir, on pourroit les comparer à ceux qu'on emploie si communément
pour paver les routes aux environs de Paris, et qui portent le nom de grès
de Fontainebleau ; mais j avoue que je ne hasarde ce rapprochement que faute
(1) Nous avons déjà dit que les granits ne se montraient
plus sur les rives du Nil à une heure de marche
au nord de Syène ; et les Égyptiens, qui en ont travaillé
une quantité si prodigieuse, en ont cependant fait peu
d’usage pour les constructions de la Thébaïde.
(2) La constitution physique de cette partie de la
Thébaïde étoit si peu connue encore avant l’expédition,
que les relations les plus récentes et d’ailleurs les plus
exactes font remonter le terrain calcaire jusqu’à Syène.
(3) H ^aut cependant excepter un petit édifice presque
entièrement détruit, sur la rive gauche du Nil à Thèbes;
il avoit été construit avec la pierre calcaire des‘montagnes
voisines. Les habitans des villages environnans ont
établi des fours à chaux, qu’ils alimentent avec les matériaux
de ce monument ; ce qui leur épargne le trajet
d’une demi-Jieue qu’il faudrait faire pour se rendre jus-
qu à la montagne.
(4) J ai fixé a une lieue au nord de Syène les carrières
les plus méridionales, c’est-à-dire, les premières que l’on
rencontre sans sortir de la valleej mais, pour peu que l’on
(lavoir
d’avoir un terme de comparaison exact aussi généralement connu. Les grès qu’on
désigne sous le nom de molasses, aux environs de Genève, conviendraient davantage.
Dans les Alpes, dans les Vosges, et en général dans le voisinage des terrains granitiques,
on voit des grès tout-à-fait semblables à ceux des monumens Égyptiens.
J en ai rencontie plusieurs fois dont les échantillons ne sauroient sc distinguer
de ceux qui ont ete recueillis en Égypte; mais, comme les grès de Fontainebleau
sont plus connus, nous nous attacherons à faire connoître leurs différences.
D abord les nuances de couleurs sont beaucoup plus variées dans les grès
Égyptiens, qui sont souvent marqués, outre cela, d’une multitude de petites taches
noires, brunes ou jaunes, formées par quelques parties de terre argileuse et d’oxide
de fer.
Plusieurs variétés renferment des lames de mica noir, jaune et argentin, quelquefois
assez abondantes, mais si petites qu’il est souvent difficile de les distinguer.
On sait que cette substance ne se trouve guère dans les grès des pays tertiaires,
séparés par un grand intervalle des terrains primitifs.
Les variétés dont la couleur est uniforme, sont grises, ou jaunâtres, ou tout-à-iàit
blanches; d’autres offrent un léger ton rose local, ou des nuances de jaune très-
diversifiées, et d’autres sont marquées de veines de la même couleur diversement
contournées. Ces diverses teintes, en général assez foibles, n’empêchent pas que
les monumens, éclairés, comme ils le sont presque toujours, d’une lumière vive,
ne présentent pour la plupart un aspect gris ou blanchâtre : quelquefois les surfaces
exposées à lair sont altérées, et présentent une teinte sombre, fort différente de
celle des surfaces nouvellement découvertes; altération due à quelques parties
métalliques répandues dans le gluten de la pierre.
Il est à remarquer, au surplus, que les surfaces des temples ne sont pas dans JCUr
état naturel; on a trouvé en plusieurs endroits des restes de couleurs, et il est vraisemblable
qu’anciennement les édifices ont été colorés dans toute leur étendue.
Les grès de la Thébaïde sont formés de grains de sable généralement moins
arrondis,.plus anguleux, plus inégaux et plus également agrégés que ceux que
nous leur comparons. La raison de ces différences est facile à saisir, dès que l'on
sait que les montagnes primitives qui ont fourni les élémens de ces grès, sont
situées dans le voisinage; mais, comme ces montagnes, sous les rapports géologiques
, seront décrites ailleurs, nous nous bornerons ici à ce qui concerne immédiatement
les antiquités.
La duiete des grès Égyptiens est en général peu considérable, et ils se laissent
s'enfonce dans la montagne, on ne tarde pas à découvrir
des traces d’exploitation plus au sud, dans tous les en-
droits où le grcs succède au granit.
Les carrières les plus septentrionales, observées sur la
rive droite du fleuve, sont situées à cinq lieues au sud
d E sné , à l'embouchure d'une petite vallée où l'on
exploite du natroun; les montagnes qui les renferment,
alternent avec les montagnes calcaires. Il est probable
qu un peu plus au nord on en découvrirait d’autres en
s enfonçant dans l’intérieur du désert, et l'on voit sur
A. D .
le bord du fleuve un grand nombre de blocs taillés et
tout prêts à être embarqués : ceci fait conjecturer que
ces carrières sont des moins anciennes qu’aient exploitées
les Egyptiens. Ces matériaux étoient destinés, sans
doute, à l’un de ces monumens dont la construction
a^ été interrompue par la révolution qu’a produite en
Egypte la conquête des Perses. Il paraît difficile d’expliquer
autrement pourquoi des pierres toutes taillées et
prêtes à être employées avoient été abandonnées sur ce
rivage.
C