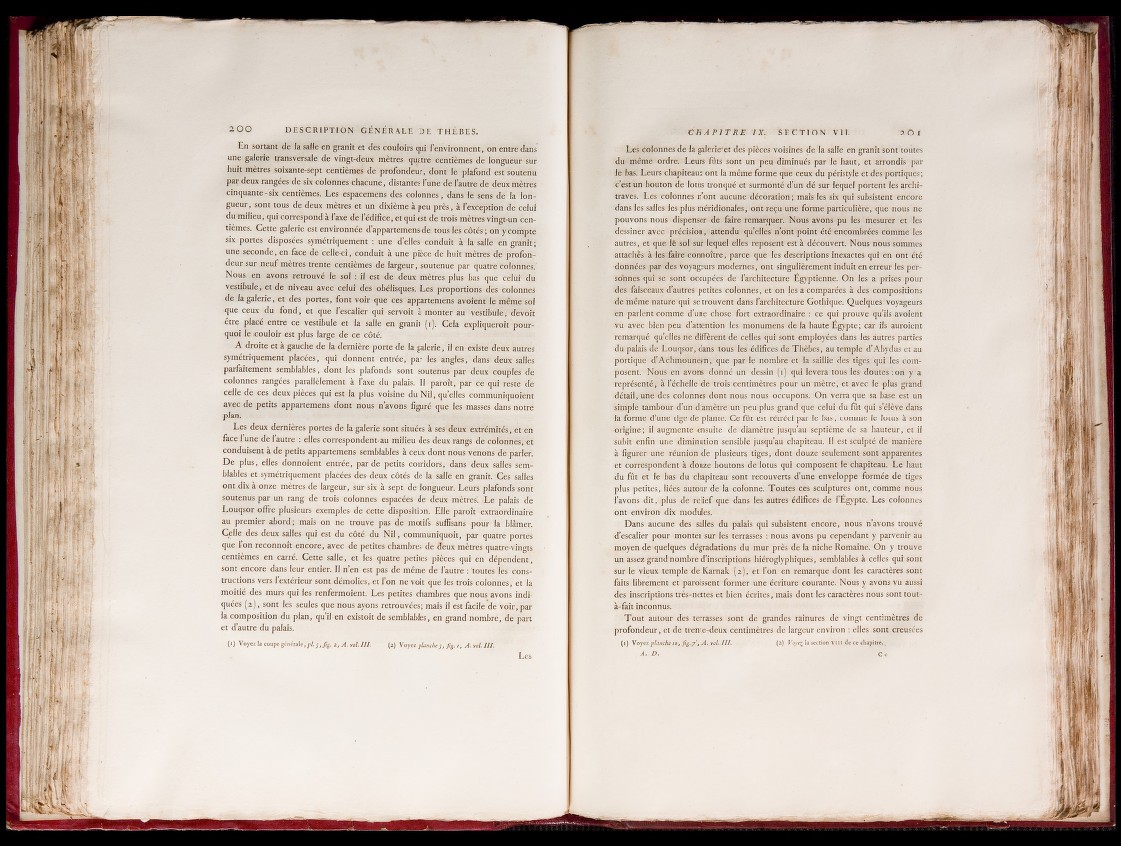
En sortant de la salle en granit et des couloirs qui l’environnent, on entre dans
une galerie transversale de vingt-deux métrés quatre centièmes de longueur sur
huit métrés soixante-sept centièmes de profondeur, dont le plafond est soutenu
par deux rangées de six colonnes chacune, distantes l’une de l’autre de deux mètres
cinquante-six centièmes. Les espacemens des colonnes, dans le sens de la longueur,
sont tous de deux mètres et un dixième à peu près, à l’exception de celui
du milieu, qui correspond à l’axe de l’édifice, et qui est de trois mètres vingt-un centièmes.
Cette galerie est environnée d’appartemens de tous les côtés ; on y compte
six portes disposées symétriquement : une d’elles conduit à la salle en granit ;
une seconde, en face de celle-ci, conduit à une pièce de huit mètres de profondeur
sur neuf mètres trente centièmes de largeur, soutenue par quatre colonnes.
Nous en avons retrouvé le sol : il est de deux mètres plus has que celui du
vestibule, et de niveau avec celui des obélisques. Les proportions des colonnes
de la galerie, et des portes, font voir que ces appartemens avoient le même sol
que ceux du fond, et que l’escalier qui servoit à monter au vestibule, devoit
etre place entre ce vestibule et la salle en granit (ij. Cela expliqueroit pourquoi
le couloir est plus large de ce côté.
A droite et à gauche de la dernière porte de la galerie, il en existe deux autres
symétriquement placées, qui donnent entrée, par les angles, dans deux salles
parfaitement semblables, dont les plafonds sont soutenus par deux couples de
colonnes rangées parallèlement à l’axe du palais. Il paroît, par ce qui reste de
celle de ces deux pièces qui est la plus voisine du Nil, quelles communiquoient
avec de petits appartemens dont nous n’avons figuré que les masses dans notre
plan.
Les deux dernières portes de la galerie sont situées à ses deux extrémités, et en
face 1 une de l’autre : elles correspondent.au milieu des deux rangs de colonnes, et
conduisent à de petits appartemens semblables à ceux dont nous venons de parler.
De plus, elles donnoient entrée, par de petits corridors, dans deux salles semblables
et symétriquement placées des- deux côtés de la salle en granit. Ces salles
ont dix à onze mètres de largeur, sur six à sept de longueur. Leurs plafonds sont
soutenus par un rang de trois colonnes espacées de deux mètres. Le palais de
Louqsor offre plusieurs exemples de cette disposition. Elle paroît extraordinaire
au premier abord; mais on ne trouve pas de motifs suffisans pour la blâmer.
Celle des deux salles qui est du côté du N il, communiquoit, par quatre portes
que Ion reconnoît encore, avec de petites chambres de deux mètres quatre-vingts
centièmes en carré. Cette salle, et les quatre petites pièces qui en dépendent,
sont encore dans leur entier. Il n’en est pas de même de l’autre : toutes les constructions
vers l’extérieur sont démolies, et l’on ne voit que les trois colonnes, et la
moitié des murs qui les renfermoient. Les petites chambres que nous avons indiquées
(2), sont lés seules que nous ayons retrouvées ; mais il est facile de voir, par
la composition du plan, qu’il en existoit de semblables, en grand nombre, de part
et d’autre du palais.
(1) Voyez la coupe générale, y>/, 2 , A . vol, I I I . (2) Voyez planche y , fig. z, A . ■vol. I I I .
Les
Les Colonnes de la galerie'et des pièces voisines de la salle en granit sont toutes
du même ordre. Leurs fûts sont un peu diminués par le haut, et arrondis par
le bas. Leurs chapiteaux ont la même forme que ceux du péristyle et des portiques;
c’est un bouton de lotus tronqué et surmonté d’un dé sur lequel portent les architraves.
Les colonnes n’ont aucune décoration ; mais les six qui subsistent encore
dans les salles les plus méridionales, ont reçu une forme particulière, que nous ne
pouvons nous dispenser de faire remarquer. Nous avons pu les mesurer et les
dessiner avec précision, attendu qu’elles n’ont point été encombrées comme les
autres, et que lè sol sur lequel elles reposent est à découvert. Nous nous sommes
attachés à les faire connoître, parce que les descriptions inexactes qui en ont été
•données par des voyageurs modernes, ont singulièrement induit en erreur les personnes
qui se sont occupées de l’architecture Égyptienne. On les a prises pour
des faisceaux d’autres petites colonnes, et on les a comparées à des compositions
de même nature qui se trouvent dans l’architecture Gothique. Quelques voyageurs
en parlent comme d’une chose fort extraordinaire : ce qui prouve qu’ils avoient
vu avec bien peu d’attention les monumens de la haute Égypte; car ils auroient
remarqué qu’elles ne diffèrent de celles qui sont employées dans les autres parties
du palais de Louqsor, dans tous les édifices de Thèbes, au temple d’Abydus et au
portique d’Achmouneyn, que par le nombre et la saillie des tiges qui les composent.
Nous en avons donné un dessin (i) qui lèvera tous les doutes : on y a
représenté, à l’échelle de trois centimètres pour un mètre, et avec le plus grand
détail, une des colonnes dont nous nous occupons. On verra que sa base est un
simple tambour d’un diamètre un peu plus grand que celui du fût qui s’élève dans
la forme d’une tige de plante. Ce fût est rétréci par le bas, comme le lotus à son
origine; il augmente ensuite de diamètre jusqu’au septième de sa hauteur, et il
subit enfin une diminution sensible jusqu’au chapiteau. Il est sculpté de manière
à figurer une réunion de plusieurs tiges, dont douze seulement sont apparentes
et correspondent à douze boutons de lotus qui composent le chapiteau. Le haut
du fût et le bas du chapiteau sont recouverts d’une enveloppe formée de tiges
plus petites, liées autour de la colonne. Toutes ces sculptures ont, comme nous
l’avons dit, plus de relief que dans les autres édifices de l’Egypte. Les colonnes
ont environ dix modules.
Dans aucune des salles du palais qui subsistent encore, nous n’avons trouvé
d’escalier pour monter sur les terrasses : nous avons pu cependant y parvenir au
moyen de quelques dégradations du mur près de la niche Romaine. On y trouve
un assez grand nombre d’inscriptions hiéroglyphiques, semblables à celles qui sont
sur le vieux temple de Karnak (2), et l’on en remarque dont les caractères sont
faits librement et paroissent former une écriture courante. Nous y avons vu aussi
des inscriptions très-nettes et bien écrites, mais dont les caractères nous sont tout-
à-fait inconnus.
Tout autour des terrasses sont de grandes rainures de vingt centimètres de
profondeur, et de trente-deux centimètres de largeur environ : elles sont creusées
(1) Voyez planche iQ t Jîg. 7 , A . vol. I I I . (2) Voye^ la section VI11 de ce chapitre.,