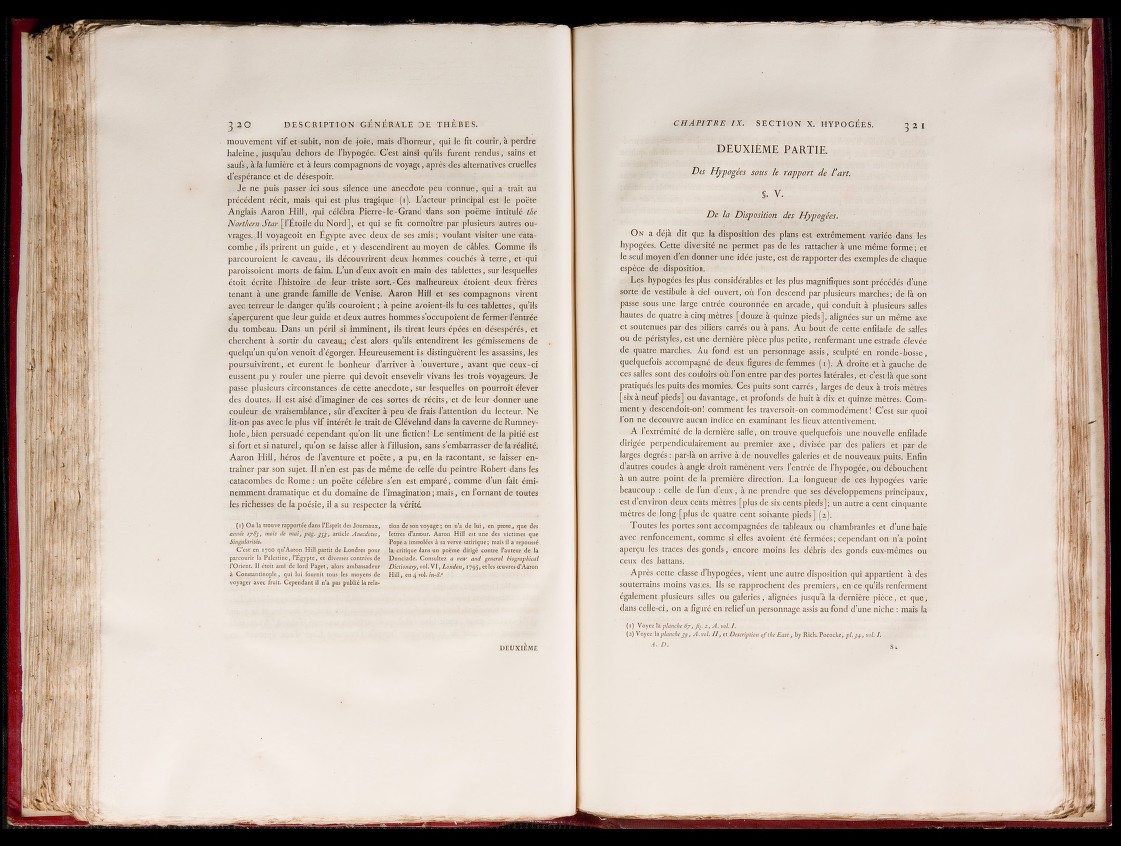
mouvement v if et'subit, non de joie, mais d’horreur, qui le fit courir, à perdre
haleine, jusqu’au dehors de l’hypogée. C’est ainsi qu’ils furent rendus, sains et
saufs, à la lumière et à leurs compagnons de voyage,après des alternatives cruelles
d’espérance et de désespoir.
Je ne puis passer ici sous silence une anecdote peu connue, qui a trait au
précédent récit, mais qui est plus tragique (1). L ’acteur principal est le poëte
Anglais Aaron Hill, qui célébra Pierre-le-Grand dans son poëme intitulé the
Northern Star [l’Etoile du Noid], et qui se fit connoître par plusieurs autres ouvrages..
Il voyageoit en Egypte avec deux de ses amis; voulant visiter unecata-
combe, ils,prirent un guide, et y descendirent au moyen de câbles. Comme ils
parcouroient le caveau, ils découvrirent deux hommes couchés à terre, et qui
paroissoient morts de faim. L ’un d’eux avoit en main des tablettes, sur lesquelles
étoit écrite l’histoire de leur triste sort. • Ces malheureux étoient deux frères
tenant à une grande famille de Venise. Aaron Hill et ses compagnons virent
avec terreur Je danger qu’ils couroient ; à peine avoient-ils lu ces tablettes, qu’ils
s’aperçurent que -leur guide et deux autres hommes s’occupoient de fermer l’entrée
du tombeau. Dans un péril si imminent, ils tirent leurs épées en désespérés, et
cherchent à sortir du caveau.; c’est alors qu’ils entendirent les gémissemens de
quelqu’un qu’on venoit d’égorger. Heureusement ils distinguèrent les assassins, les
poursuivirent, et eurent le bonheur d’arriver à l’ouverture, avant que ceux-ci
eussent pu y rouler une pierre qui devoit ensevelir vivans les trois voyageurs. Je
passe plusieurs circonstances de cette anecdote, sur lesquelles on pourroit élever
des doutes. Il est aisé d’imaginer de ces sortes de récits, et de leur donner une
couleur de vraisemblance, sûr d’exciter à peu de frais l ’attention du lecteur. Ne
lit-on pas avec le plus v if intérêt le trait de Cléveland dans la caverne de Rumney-
hole, bien persuadé cependant qu’on lit une fiction ! Le sentiment de la pitié est
si fort et si naturel, qu’on se laisse aller à l’illusion, sans s’embarrasser de la réalité,
Aaron Hill, héros de l’aventure et poëte, a pu, en la racontant, se laisser entraîner
par son sujet. II .n’en est pas de même de celle du peintre Robert dans les
catacombes de Rome; un poëte célèbre s’en est emparé, comme d’un fait éminemment
dramatique et du domaine de l’imagination ; mais, en l’ornant de toutes
les richesses de la poésie, il a su respecter la vérité.
(1) On la trouve rapportée dans l’Esprit des Journaux, tion de son voyage; on n’a de lu i, en. prose-, -que des
année 178 5 , mois de mai, pag. 3 3 3 , article Anecdotes, lettres d’amour. Aaron Hill est une des victimes que
Singularités. Pope a immolées à sa verve satirique; mais il a repoussé.
C ’est en 1700 qu’Aaron Hill partit de Londres pour la critique dans un poëme dirigé contre l’auteur de la
parcourir la Palestine, l’Egypte, et diverses contrées de Dunciade. Consultez a new and général biographical
l’Orient. Il étoit ami de lord Paget, alors ambassadeur Dictionary, vol. V I , London, 1795, et les oeuvres d’Aaron
à Constantinople, qui lui fournit tous les moyens de H ill, en 4 vol. in-8.0
voyager avec fruit. Cependant il n’a pas publié la rela-
D EU X IÈM E
DEUXIÈME PARTIE.
Des Hypogées sous le rapport de l ’art.
§. V.
D e la Disposition des Hypogées.
On a deja dit que la disposition des plans est extrêmement variée dans les
hypogées. Cette diversité ne permet pas de les rattacher à une même forme; et
le seul moyen d’en donner une idée juste, est de rapporter des exemples de chaque
espèce de disposition.
Les hypogées les plus considérables et les plus magnifiques sont précédés d’une
sorte de vestibule a ciel ouvert, ou Ion descend par plusieurs marches; de là on
passe sous une large entrée couronnée en arcade, qui conduit à plusieurs salles
hautes de quatre à cinq mètres [douze à quinze pieds], alignées sur un même axe
et soutenues par des piliers carrés ou à pans. Au bout de cette enfilade de salles
ou de péristyles, est une dernière pièce plus petite, renfermant une estrade élevée
de quatre marches. Au fond est un personnage assis, sculpté en ronde-bosse,
quelquefois accompagné de deux figures de femmes ( i ). A droite et à gauche de
ces salles sont des couloirs où l’on entre par des portes latérales, et c’est là que sont
pratiqués les puits des momies. Ces puits sont carrés, larges de deux à trois mètres
[six à neuf pieds] ou davantage, et profonds de huit à dix et quinze mètres. Comment
y descendoit-on ! comment les traversoit-on commodément ! C’est sur quoi
l’on ne découvre aucun indice en examinant les lieux attentivement.
A 1 extrémité de la dernière salle, on trouve quelquefois une nouvelle enfilade
dirigée perpendiculairement au premier axe , divisée par des paliers et par de
larges degrés : par-là on arrive à de nouvelles galeries et de nouveaux puits. Enfin
d’autres coudes à angle droit ramènent vers l’entrée de l’hypogée, ou débouchent
a un autre point de la première direction. La longueur de ces hypogées varie
beaucoup : celle de lun deux, à ne prendre que ses développemens principaux,
est d’environ deux cents mètres [plus de six cents pieds]; un autre a cent cinquante
mètres de long [plus de quatre cent soixante pieds] (2).
Toutes les portes sont accompagnées de tableaux ou chambranles et d’une baie
avec renfoncement,,comme si elles avoient été fermées; cependant on n’a point
aperçu les traces des gonds, encore moins les débris des gonds eux-mêmes ou
ceux des battans.
Après cette classe d’hypogées, vient une autre disposition qui appartient à des
souterrains moins vastes. Ils se rapprochent des premiers, en ce qu’ils renfennent
également plusieurs salles ou galeries, alignées jusqu’à la dernière pièce, et que,
dans celle-ci, on a figuré en relief un personnage assis au fond d’une niche : mais la
( i ) Voyez la planche 6 7 , fig. 2 , A . vol. I.
(2) Voyez la planche3 9 , A . vol. I I , et Description o f the E a s t, by Rich. Pococke, p l.3 4 , vol. I .