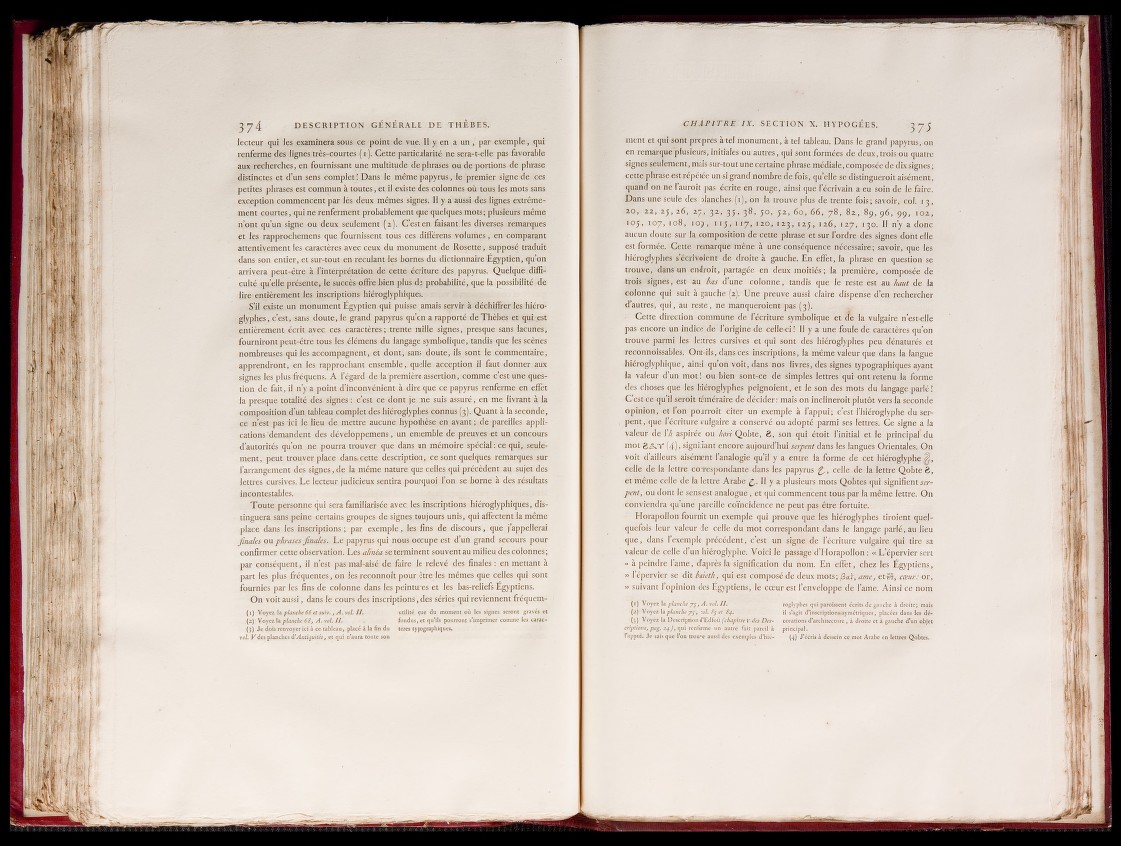
lecteur qui les examinera sous ce point de vue. 11 y, en a un , par exemple, qui
renferme des lignés très-courtes (t ). Cette particularité ne sera-t-elle pas favorable
aux recherches, en fournissant une multitude de phrases ou de portions de phrase
distinctes et d’un sens complet ! Dans le même papyrus, le premier signe de .ces
petites phrases est commun à toutes, et il existe des colonnes où tous les mots sans
exception commencent par lés deux mêmes signes. Il y a aussi des lignes extrêmement
courtes, qui ne renferment probablement que quelques mots ; plusieurs même
n’ont qu’un signe ou deux seulement (2). C’est en faisant.les diverses remarques
et les rapprochemens que fournissent tous ces différens volumes, en comparant
attentivement les caractères avec ceux du monument de Rosette, supposé traduit
dans son entier, et sur-tout en reculant les bornes du dictionnaire Egyptien, qu’on
arrivera peut-être à l’interprétation de cette écriture des, papyrus. Quelque difficulté
qu’elle présente, le succès offre bien plus de probabilité, que la possibilité de
lire entièrement les inscriptions hiéroglyphiques.
S’il existe un monument Égyptien qui puisse jamais servir à déchiffrer les hiéroglyphes
, c’est, sans doute, le grand papyrus qu’on a rapporté de Thèbes et qui.est
entièrement écrit avec ces caractères; trente mille signes, presque sans lacunes,
fourniront peut-être tous les élémens du langage symbolique, tandis que les scènes
nombreuses qui les accompagnent, et dont, sans doute, ils sont le commentaire,
apprendront, en les rapprochant ensemble, quelle acception il faut donner aux
signes les plus fféquens. A l’égard de la première assertion, comme c’est une question
de fait, il n’y a point d’inconvénient à dire que ce papyrus renferme en effet
la presque totalité des signes : c’est ce dont je me suis assuré, en me livrant à la
composition d’un tableau complet des hiéroglyphes connus (3). Quant à la seconde,
ce n’est pas ici le lieu de mettre aucune hypothèse en avant ; de pareilles applications
demandent des développemens, un ensemble de preuves et un concours
d’autorités qu’on ne pourra trouver que dans un mémoire spécial : ce qui, seulement,
peut trouver place dans, cette description, ce sont quelques remarques sur
l’arrangement des signes, de la même nature que celles qui précèdent au sujet des
lettres cursives. L e lecteur judicieux sentira pourquoi l’on se borne à des résultats
incontestables.
Toute personne qui sera familiarisée avec les inscriptions hiéroglyphiques, distinguera
sans peine certains groupes de signes toujours unis, qui affectent la même
place dans les inscriptions ; par exemple, les fins de discours, que j’appellerai
finales ou phrases finales. Le papyrus qui nous occupe est d’un grand secours pour
confirmer cette observation. Les alinéa se terminent souvent au milieu des colonnes ;
par conséquent, il n’est pas mal-aisé de faire le relevé des finales : en mettant à
part les plus fréquentes, on les reconnoît pour être les mêmes que celles qui sont
fournies par les fins de colonne dans les peintures et les bas-reliefs Egyptiens.
On voit aussi, dans le cours des inscriptions, des séries qui reviennent fréquent-
(1) Voyez la planche 66et suiv., A . vol. I I . utilité que du moment où les signes seront gravés et
(2) Voyez la planche 68, A . vol. I I . . fondus, et qu’ils pourront s’imprimer comme les carac-
(3) J e dois renvoyer ici à ce tableau, placé à la fin du tères typographiques.
vol. V des planches d’Antiquités, et qui n’aura toute son
ment et qui sont propres à tel monument, à tel tableau. Dans le grand papyrus, on
en remarque plusieurs, initiales ou autres, qui sont formées de deux, trois ou quatre
signes seulement, mais sur-tout une certaine phrase médiale, composée de dix signes ;
cette phrase est répétée un si grand nombre de fois, quelle se distingueroit aisément,
quand on ne l’auroit pas écrite en rouge, ainsi que l’écrivain a eu soin de le faire.
Dans une seule des planches (i), on la trouve plus de trente fois; savoir, col. 1 3 ,
20, 22, 2y, 26, 2 7, 32, 35 , 38, 50, y z , 60, 66, y 8, 82, 89, 96, 99, 10 2 ,
10 5, 10 7 , 108, 10 9 , 1 1 5 , 1 1 7 , 12 0 , 12 3 , 12 5 , 12 6 , 12 7 , 130. Il n’y a donc
aucun doute sur la composition de cette phrase et sur l’ordre des signes dont elle
est formée. Cette remarque mène à une conséquence nécessaire; savoir, que les
hiéroglyphes s’écrivoient de droite à gauche. En effet, la phrase en question se
trouve, dans un endroit, partagée en deux moitiés ; la première, composée de
trois signes, est au has d’une colonne, tandis que le reste est au haut de la
colonne qui suit à gauche (2). Une preuve aussi claire dispense d’en rechercher
d’autres, qui, au reste, ne manqueroient pas (3).
Cette direction commune de l’écriture symbolique et de la vulgaire n’est-elle
pas encore un indice de l’origine de celle-ci ! Il y a une foule de caractères qu’on
trouve parmi les lettres cursives et qui sont des hiéroglyphes peu dénaturés et
reconnoissables. Ont-ils, dans ces inscriptions, la même valeur que dans la langue
hiéroglyphique, ainsi qu’on voit, dans nos livres, des signes typographiques ayant
la valeur d’un mot ! ou bien sont-ce de simples lettres qui ont retenu la forme
des choses que les hiéroglyphes peignoient, et le son des mots du langage parlé!
C’est ce qu’il seroit téméraire de décider: mais on inclineroit plutôt vers la seconde
opinion, et l’on pourroit citer un exemple à l’appui; c’est l’hiéroglyphe du serpent,
que l’écriture vulgaire a conservé ou adopté parmi ses lettres. Ce signe a la
valeur de l’h aspirée ou hori Qobte, 2 , son qui étoit l’initial et le principal du
mot 23."ï‘ (4), signifiant encore aujourd’hui serpent dans les langues Orientales. On
voit d’ailleurs aisément l’analogie qu’il y a entre la forme de cet hiéroglyphe
celle de la lettre correspondante dans les papyrus celle de la lettre Qobte 8,
et même celle de la lettre Arabe £,. II y a plusieurs mots Qobtes qui signifient serpent,
ou dont le sens est analogue, et qui commencent tous par la même lettre. On
conviendra qu’une pareille coïncidence ne peut pas être fortuite.
Horapollon fournit un exemple qui prouve que les hiéroglyphes tiroient quelquefois
leur valeur de celle du mot correspondant dans le langage parlé, au lieu
que, dans l’exemple précédent, c’est un signe de l’écriture vulgaire qui tire sa
valeur de celle d’un hiéroglyphe. Voici le passage d’Horapollon : « L ’épervier sert
■> à peindre lame, d’après la signification du nom. En effet, chez les Égyptiens,
» l’épervier se dit baieth, qui est composé de deux mots; /3od, ame, et«8, coeur: or,
» suivant 1 opinion des Égyptiens, le coeur est l’enveloppe de l’ame. Ainsi ce nom
(1) Voyez la planche 7 5 , A . vol. I I . roglyphes qui paraissent écrits de gauche à droite; mais
(-) Voyez la planche y fi, col. 8fi et 84. il s’agit d’inscriptions* symétriques, placées dans les dé-
(3) Voyez la Description d’Edl'oû (chapitre v des Des- corations d’architecture, à droite et à gauche d’un objet
criptions, pag. 2 4 ) , qui renferme un autre fait pareil à principal.
1 appui. Je sais que l’on trouve aussi des exemples d’hié- (4) J ’écris à dessein ce mot Arabe en lettres Qobtes.