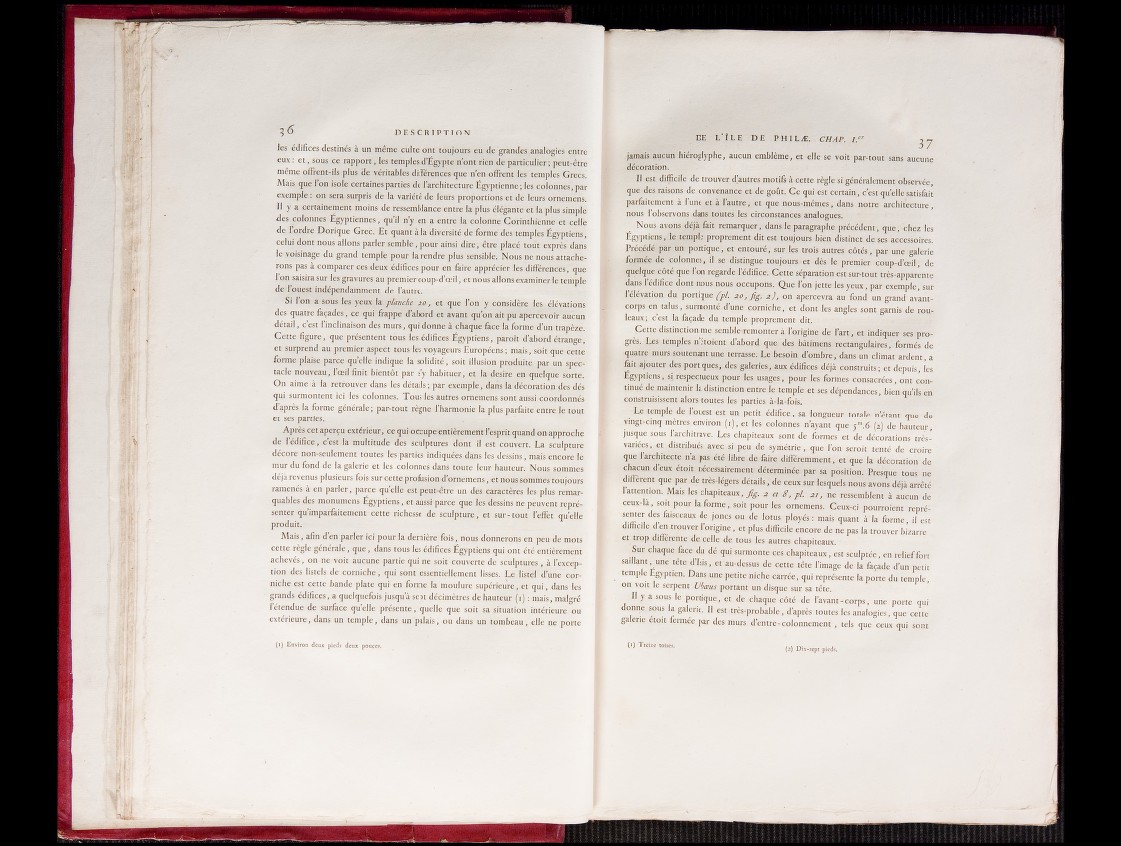
les édifices destinés à un même culte ont toujours eu de grandes analogies entre
eux : e t , sous ce rapport, les temples d’Égypte n’ont rien de particulier ; peutrêtre
même offrent-ils plus de véritables différences que n’en offrent les temples Grecs.
Mais que 1 on isole certaines parties de l’architecture Égyptienne ; les colonnes, par
exemple : on sera surpris de la variété de leurs proportions et de leurs ornemens.
Il y a certainement moins de ressemblance entre la plus élégante et la plus simple
des colonnes Égyptiennes, qu’il n’y en a entre la colonne Corinthienne et celle
de Tordre Dorique Grec. Et quant à la diversité de forme des temples Égyptiens,
celui dont nous allons parler.semble, pour ainsi dire, être placé tout exprès dans
le voisinage du grand temple pour la rendre plus sensible. Nous ne nous attacherons
pas à comparer ces deux édifices pour en faire apprécier les différences, que
1 on saisira sur les gravures au premier coup-d’oeil, et nous allons examiner le temple
de l’ouest indépendamment de l’autre.
Si Ion a sous les yeux la planche 2 0 , et que l’on y considère les élévations
des quatre façades, ce qui frappe d’abord et avant qu'on ait pu apercevoir aucun
détail, c est 1 inclinaison des murs, qui donne à chaque face la forme d’un trapèze.
Cette figure, que présentent tous les édifices Égyptiens, paroît d’abord étrange,
et surprend au premier aspect tous les voyageurs Européens; mais, soit que cette
forme plaise parce qu’elle indique la solidité, soit illusion produite par un spectacle
nouveau, l’oeil finit bientôt par s’y habituer, et la desire en quelque sorte.
On aime à la retrouver dans les détails; par exemple, dans la décoration des dés
qui surmontent ici les colonnes. Tous les autres ornemens sont aussi coordonnés
d après la forme générale ; par-tout règne l’harmonie la plus parfaite entre le tout
et ses parties.
Après cet aperçu extérieur, ce qui occupe entièrement l’esprit quand on approche
de l’édifice, c’est la multitude des sculptures dont il est couvert. La sculpture
décore non-seulement toutes les parties indiquées dans les dessins, mais encore le
mur du fond de la galerie et les colonnes dans toute leur hauteur. Nous sommes
déjà revenus plusieurs fois sur cette profusion d’ornemens, -et nous sommes toujours
ramenés à en parler, parce quelle est peut-être un des caractères les plus remarquables
des monumens Égyptiens, et aussi parce que les dessins ne peuvent représenter
qu’imparfaitement cette richesse de sculpture, et sur-tout l’effet qu’elle
produit.
Mais, afin den parler ici pour la dernière fois, nous donnerons en peu de mots
cette règle générale, que, dans tous les édifices Égyptiens qui ont été entièrement
achevés, on ne voit aucune partie qui ne soit couverte de sculptures, à l’exception
des listels de corniche, qui sont essentiellement lisses. Le listel d’une corniche
est cette bande plate qui en fonne la moulure supérieure, et qui, dans les
grands édifices, a quelquefois jusqua sept décimètres de hauteur (i) : mais, malgré
l’étendue de surface qu’elle présente, quelle que soit sa situation intérieure ou
extérieure, dans un temple, dans un palais, ou dans un tombeau, elle ne porte
(1) Environ deux pieds deux pouces.
jamais aucun hiéroglyphe, aucun emblème, et elle se voit par-tout sans aucune
décoration.
Il est difficile de trouver d’autres motifs à cette règle si généralement observée,
que des raisons de convenance et de goût. Ce qui est certain, c’est quelle satisfait
parfaitement à Tune et à l’autre, et que nous-mêmes, dans notre architecture,
nous l’observons dans toutes les circonstances analogues.
Nous avons déjà fait remarquer, dans le paragraphe précédent, que, chez les
Égyptiens, le temple proprement dit est toujours bien distinct de ses accessoires.
Précédé par un portique, et entouré, sur les trois autres côtés, par une galerie
formée de colonnes, il se distingue toujours-et dès le premier coup-d’oeil, de
quelque côté que 1 on regarde l’édifice. Cette séparation est sur-tout très-apparente
dans l’édifice dont nous nous occupons. Que Ton jette les yeux, par exemple, sur
1 élévation du portique (pl. 2 0 , Jig . 2 ) , on apercevra au fond un grand avant-
corps en talus, surmonté d’une corniche, et dont les angles sont garnis de rouleaux;
cest la façade du temple proprement dit.
Cette distinction me semble remonter à l’origine de l’art, et indiquer ses progrès.
Les temples netoient d abord que des bâtimens rectangulaires, formés de
quatre murs soutenant une terrasse. Le besoin d’ombre, dans un climat ardent, a
fait ajouter des portiques, des galeries, aux édifices déjà construits; et depuis, les
Égyptiens, si. respectueux pour les usages, pour les formes consacrées, ont continué
de maintenir la distinction entre le temple et ses dépendances, bien qu’ils en
construisissent alors toutes les parties à-la-fois.
Le temple de l’ouest est un petit édifice, sa longueur totale n’étant que de
vingt-cinq mètres environ (1), et les colonnes n’ayant que ym.ô (2) de hauteur,
jusque sous l’architrave. Les chapiteaux sont de formes et de décorations très-
variées, et distribués avec si peu de symétrie, que Ton seroit tenté de croire
que 1 architecte na pas été libre de faire différemment, et que la décoration de
chacun d eux étoit nécessairement déterminée par sa position. Presque tous ne
différent que par de très-légers détails, de ceux sur lesquels nous avons déjà arrêté
¡’attention. Mais les chapiteaux, Jig . 2 et 8 , p l. 2 1 , ne ressemblent à aucun de
ceux-la, soit pour la forme, soit pour les ornemens. Ceux-ci pourroient représenter
des faisceaux de joncs ou de lotus ployés : mais quant à ’ la forme, il est
difficile d en .trouver l’origine, et plus difficile encore de ne pas la trouver bizarre
et trop différente de celle de tous les autres chapiteaux.
Sur chaque face clu dé qui surmonte ces chapiteaux, est sculptée, en relief fort
saillant une tête d’Isis, et au-dessus de cette tête l’image de la façade d’un petit
temple Egyptien. Dans une petite niche carrée, qui représente la porte du temple,
on voit le serpent Uboeus portant un disque sur sa tête.
Il y a sous le portique, et de chaque côté de l’avant - corps, une porte qui
donne sous la galerie. Il est très-probable, d’après toutes les analogies, que cette
gaerie étoit fermée par des murs d’entre-colonnement , tels que ceux qui sont
(1) Treize toises.
(2) Dix-sept pieds.