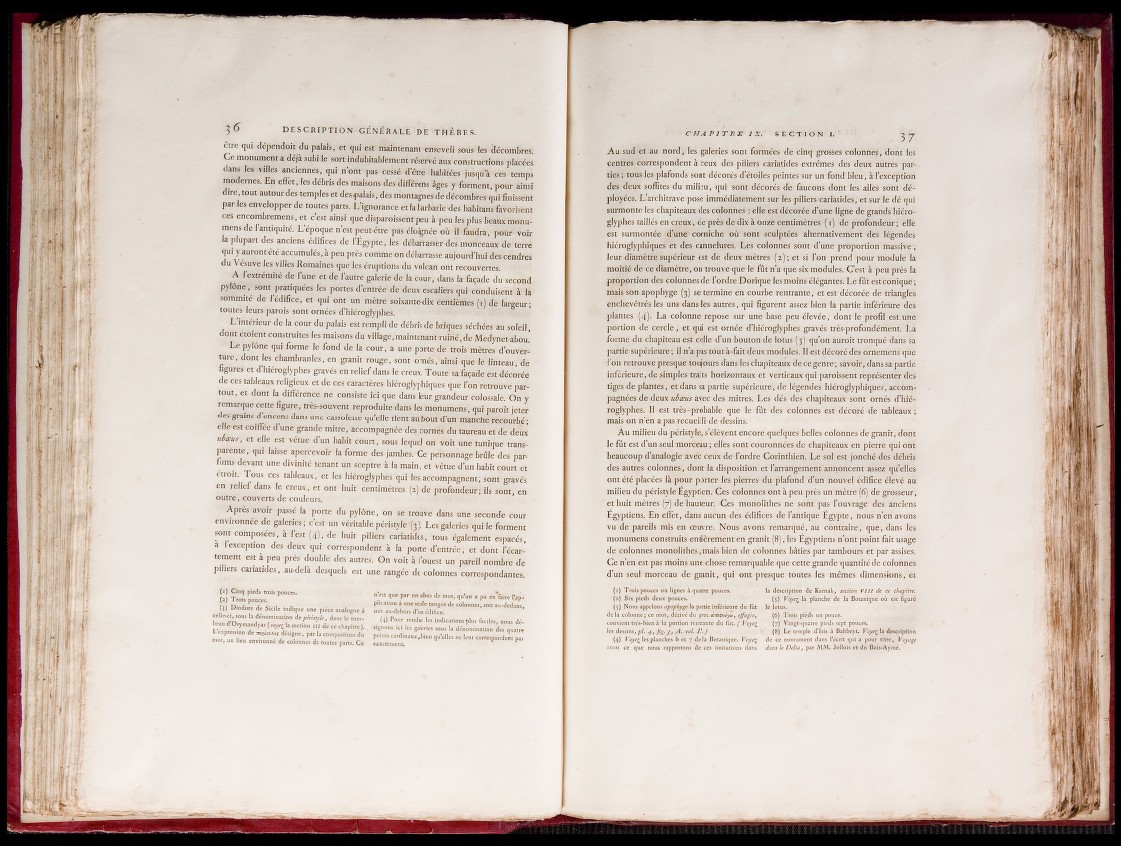
ctre qui dépendoit du palais, et qui est maintenant enseveli sous les clécombres.
Ce monument a déjà subi le sort indubitablement réservé aux constructions placées
dans les villes anciennes, qui nom pas cessé d’être habitées jusqu’à ces temps
modernes. En effet, les débris des maisons des différens âges y forment, pour ainsi
dire, tout autour des temples et dessalais, des montagnes de décombres qui finissent
par les envelopper de toutes parts. L ’ignorance et la barbarie des habitans fàvorisent
ces encombremens, et c’est ainsi que disparoissent peu à peu les plus beaux monu-
mens de l’antiquité. L ’époque n’est peut-être pas éloignée où il faudra, pour voir
la plupart des anciens édifices de 1 Egypte, les débarrasser des monceaux de terre
qui y auront été accumulés, à peu près comme on débarrasse aujourd’hui des cendres
du Vésuve les villes Romaines que les éruptions du volcan ont recouvertes.
A l’extrémité de l’une et de l’autre galerie de la cour, dans la façade du second
pylône r sont pratiquées les portes d’entrée de deux escaliers qui conduisent à la
sommité de 1 édifice, et qui ont un mètre soixante-dix centièmes (t) de largeur;
toutes leurs parois sont ornées d’hiéroglyphes.
L intérieur de la cour du palais est rempli de débris de briques séchées au soleil,
dont étoient construites les maisons du village,maintenant ruiné, de Medynet-abou.
Le pylône qui forme le fond de la cour, a une porte de trois mètres d’ouverture,
dont les chambranles, en granit rouge, sont ornés, ainsi que te linteau, de
figures et d’hiéroglyphes gravés en relief dans le creux. Toute sa façade est décorée
de ces tableaux religieux et de ces caractères hiéroglyphiques que l’on retrouve partout,
et dont la différence ne consiste ici que dans leur grandeur colossale. On y
remarque cette figure, très-souvent reproduite dans les monumens, qui parott jeter
des grains d’encens dans une cassolette qu’elle tient au bout d’un manche recourbé ;
elle est corffee d une grande mitre, accompagnée des cornes du taureau et de deux
ubaus, et elle est vêtue d’un habit court, sous lequel on voit une tunique transparente,
qui laisse apercevoir la forme des jambes. Ce personnage brûle des parfums
devant une divinité tenant un sceptre à la main, et vêtue d’un habit court et
étroit. Tous ces tableaux, et les hiéroglyphès qui les accompagnent; sont gravés
en relief dans le creux, et ont huit centimètres (2) de profondeur; ils sont, en
outre, couverts de couleurs.
Apres avoir passé la porte du pylône, on se trouve dans une seconde cour
environnée de galeries; c’est un véritable péristyle (3). Les galeries qui le forment
sont composées, à l’est (4), de huit piliers cariatidés, tous également espacés,
a 1 exception des deux qui correspondent à la porte d’entrée, et dont lecar-
tement est à peu près double des autres. On voit à l’ouest un pareil nombre de
piliers cariatides, au-delà desquels est une rangée de colonnes correspondantes.
(2) Trois pouces™'' *>° aCK’ n f st 1UC Par un a-)l:î du mot, qu’on a pu en’ faire l’api
i \ j q- -I ■ J- . plication à une seule rangée de colonnes, soit au-dedans,
(3) Diodore de Sicile indique une piece analogue à soit au-dehors d'un édifice.
beau d’Os<v 'S dans le ton,- (4) Pour rendre les indications plus faciles, nous débeau
d Osymandyas la section I I I de ce chapitre). . signons ici les galeries sous la dénomination des quatre
m o T u n lT Pa" la imposition du points cardinaux, bien qu’elles ne leur correspondent pas
moi, un lieu environne de colonnes de toutes parts. Ce exactement.
A u sud et au nord, les galeries sont formées de cinq grosses colonnes, dont les
centres correspondent à ceux des piliers cariatides extrêmes des deux autres parties
; tous les plafonds sont décorés d’étoiles peintes sur un fond bleu, à l’exception
des deux soffites du milieu, qui sont décorés de faucons dont les.ailes sont déployées.
L ’architrave pose immédiatement sur les piliers cariatides, et sur le dé qui
surmonte les chapiteaux des colonnes : elle est décorée d’une ligne de grands hiéroglyphes
taillés en creux, de près de dix à onze centimètres ( 1) de profondeur; elle
est surmontée d’une corniche où sont sculptées alternativement des légendes
hiéroglyphiques et des cannelures. Les colonnes sont d’une proportion massive ;
leur diamètre supérieur est de deux mètres ( 2 ) ; et si l’on prend pour module la
moitié de ce diamètre, on trouve que le fût n’a que six modules. C’est à peu près la
proportion des colonnes de l’ordre Dorique les moins élégantes. Le fût est conique ;
mais son apophyge (3) se termine en courbe rentrante, et est décorée de triangles
enchevêtrés les uns dans les autres, qui figurent assez bien la partie inférieure des
plantes (4). La colonne repose sur une base peu élevée, dont le profil est.une
portion de cercle, et qui est ornée d’hiéroglyphes gravés très-profondément. La
forme du chapiteau est celle d’un bouton de lotus (y) qu’on auroit tronqué dans sa
partie supérieure ; il n’a pas tout-à-fait deux modules. Il est décoré des omemens que
l’on retrouve presque toujours dans les chapiteaux de ce genre; savoir, dans sa partie
inférieure, de simples traits horizontaux et verticaux qui paroissent représenter des
tiges de plantes, et dans sa partie supérieure, de légendes hiéroglyphiques, accompagnées
de deux uboeus avec des mitres. Les dés des chapiteaux sont ornés d’hic-
roglyphes. Il est très-probable que le fût des colonnes est décoré de tableaux ;
mais on n’en a pas recueilli de dessins.
Au milieu du péristyle, s’élèvent encore quelques belles colonnes de granit, dont
le fût est d’un seul morceau ; elles sont couronnées de chapiteaux en pierre qui ont
beaucoup d’analogie avec ceux de l’ordre Corinthien. Le sol est jonché des débris
des autres colonnes, dont la disposition et l’arrangement annoncent assez qu’elles
ont été placées là pour porter les pierres du plafond d’un nouvel édifice élevé au
milieu du péristyle Égyptien. Ces colonnes ont à peu près un mètre (6) de grosseur,
et huit mètres (7) de hauteur. Ces monolithes ne sont pas l’ouvrage des anciens
Egyptiens. En effet, dans aucun des édifices de l’antique Egypte, nous n’en avons
vu de pareils mis en oeuvre. Nous avons remarqué, au contraire, que, dans les
monumens construits entièrement en granit (8), les Egyptiens n’ont point fait usage
de colonnes monolithes, mais bien de colonnes bâties par tambours et par assises.
Ce n’en est pas iftoins une chose remarquable que cette grande quantité de colonnes
d’un seul morceau de granit, qui ont presque toutes les mêmes dimensions, et
(1) Trois pouces six lignes à quatre pouces. la description de Karnak, section V i n de ce chapitre.
(2) Six pieds deux pouces. (ç) Voyeç la planche de la Botanique où est figuré
(3) Nous appelons apophyge la partie inférieure du fut le lotus.
de la colonne ; ce mot, dérivé du grec cwnxpevyut ejfugio, (6) Trois pieds un pouce.
convient très-bien à la portion rentrante du fut. ( Voye£ (7) Vingt-quatre pieds sept pouces.
les dessins,/?/. 4 , fig- 3> A . vol. I I . ) (8) Le temple d’Isis à Bahbeyt. Voye^ln description
(4) Koyeç les planches 6 et 7 de la Botanique. Voye% de ce monument dans l’écrit qui a pour titre, Voyage
aussi ce que nous rapportons de ces imitations dans dans le Delta, par MM. Jollois et du Bois-Aymé.