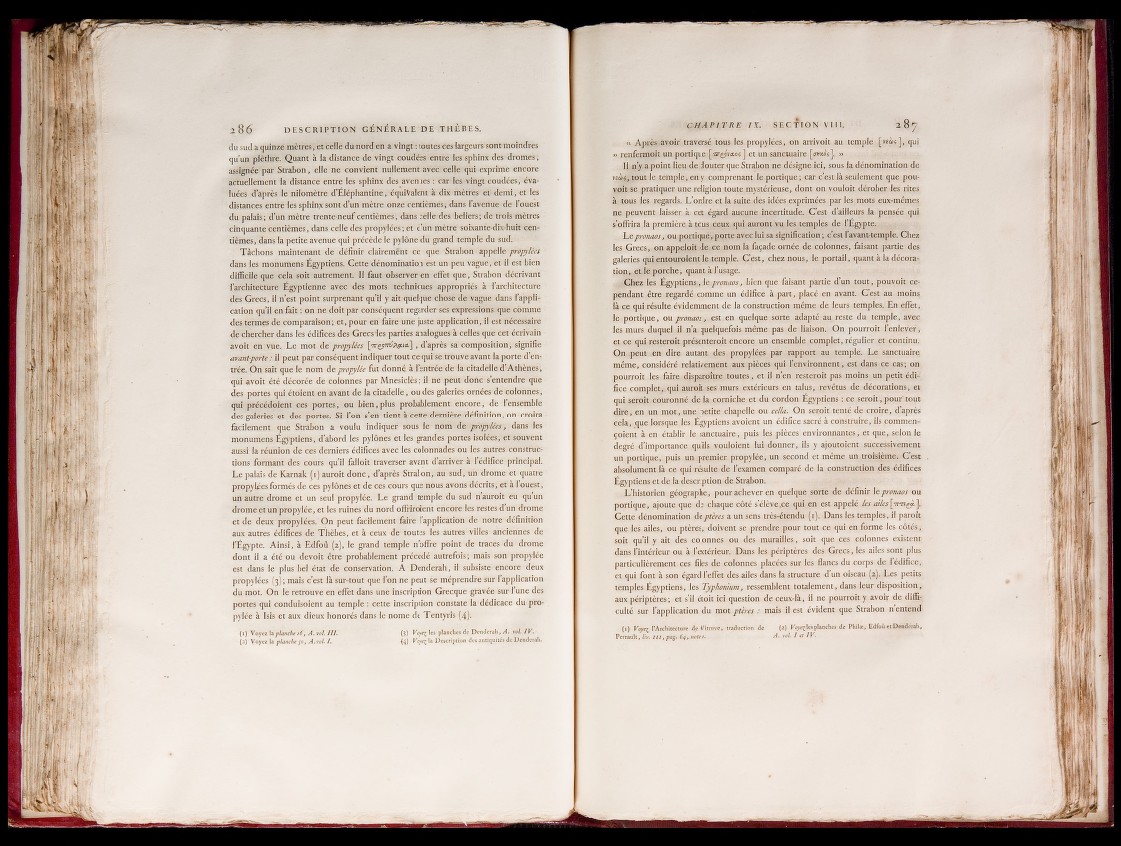
du sud a quinze mètres, et celle du nord en a vingt : toutes ces largeurs sont moindres
qu’un plèthre. Quant à la distance de vingt coudées entre les sphinx des dromes;
assignée par Strabon, elle ne convient nullement avec celle qui exprime encore
actuellement la distance entre les sphinx des avenues : car les vingt coudées, évaluées
d’après le nilomètre d’Éléphantine, équivalent à dix mètres et demi, et les
distances entre les sphinx sont d’un mètre onze centièmes, dans l’avenue de l’ouest
du palais; d’un mètre trente-neuf centièmes, dans celle des beliers; de trois mètres
cinquante centièmes, dans celle des propylées; et d’un mètre soixante-dix-huit centièmes,
dans la petite avenue qui précède le pylône du grand temple du sud.
Tâchons maintenant de définir clairement ce que Strabon appelle propylées
dans les monumens Égyptiens. Cette dénomination est un peu vague, et il est bien
difficile que cela soit autrement. Il faut observer en effet que, Strabon décrivant
l’architecture Égyptienne avec des mots techniques appropriés à l’architecture
des Grecs, il n’est point surprenant qu’il y ait quelque chose de vague dans l’application
qu’il en fait ; on ne doit par conséquent regarder ses expressions que comme
des termes de comparaison; et, pour en faire une juste application, il est nécessaire
de chercher dans les édifices des Grecsles parties analogues à celles que cet écrivain
avoit en vue. Le mot de propylées [ v r , d’après sa composition, signifie
avant-porte : il peut par conséquent indiquer tout ce qui sè trouve avant la porte d’entrée.
On sait que le nom de propylée fut donné à l’entrée de la citadelle d Athènes,
qui avoit été décorée de colonnes par Mnesiclès ; il ne peut donc s’entendre que
des portes qui étoient en avant de la citadelle, ou des galeries ornées de colonnes,
qui précédoient ces portes, ou bien,plus probablement encore, de 1 ensemble
des galeries et des portes. Si l’on s’ en tient à cette dernière définition, on croira
facilement que Strabon a voulu indiquer sous le nom de propylées, dans les
monumens Égyptiens, d’abord les pylônes et les grandes portes isolées, et souvent
aussi la réunion de ces derniers édifices avec les colonnades ou les autres constructions
formant des cours qu’il falloit traverser avant d’arriver à 1 édifice principal.
Le palais de Karnak (i ) auroit donc, d’après Strabon, au sud, un drome et quatre
propylées formés de ces pylônes et de ces cours que nous avons décrits, et a 1 ouest,
un autre drome et un seul propylée. Le grand temple du sud n auroit eu qu un
drome et un propylée, et les ruines du nord of&iroient encore les restes d un drome
et de deux propylées. On peut facilement faire 1 application de notre définition
aux autres édifices de Thèbes, et à ceux de toutes les autres villes anciennes de
l’Égypte. Ainsi, à Edfoû (z), le grand temple n’offre point de traces du drome
dont il a été ou devoit être probablement précédé autrefois; mais son propylée
est dans le plus bel état de conservation. A Denderah, il subsiste encore deux
propylées (3) ; mais c’est là sur-tout que l’on ne peut se méprendre sur l’application
du mot. On le retrouve en effet dans une inscription Grecque gravée sur 1 une des
portes qui conduisoient au temple : cette inscription constate la dédicace du propylée
à Isis et aux dieux honorés dans le nome de Tentyris (4).
(1) V o yezU planche i ( , A . vol. I I I . (3) Voyci les planches de Denderah, A . vol. IV .
(2) Voyez la plancheyo, A.vol. / . 14) Eoyej la Description des antiquités de Denderah.
u Après avoir traversé tous les propylées, on arrivoit au temple ['»e»«], qui
» renfermoit un portique [zzvyWoç ] et un sanctuaire [cnixçs]. »
Il n ’y a point lieu de douter que Strabon ne désigne ici, sous la dénomination de
veà(, tout le temple, en y comprenant le portique ; car c’est là seulement que pouvoir
se pratiquer une religion toute mystérieuse, dont on vouloit dérober les rites
à tous les regards. L ’ordre et la suite des idées exprimées par les mots eux-mêmes
ne peuvent laisser à cet égard aucune incertitude. C’est d’ailleurs la pensée qui
s’offrira la première à tous ceux qui auront vu les temples de 1 Egypte.
'Lapronaos, ou portiqué, porte avec lui sa signification ; c’est l’avant-temple. Chez
les Grecs, on appeloit de ce nom la façade ornée de colonnes, faisant partie des
galeries qui entouraient le temple. C’est, chez nous, le portail, quant à la décoration,
et le porche; quant à l’usage.
Chez les Égyptiens, le pronaos, bien que faisant partie d’un tout, pouvoit cependant
être regardé comme un édifice à part, placé en avant. C’est au moins
là ce qui résulte évidemment de la construction même de leurs temples. En effet,
le portique, ou pronaos, est en quelque sorte adapté au reste du temple/avec
les murs duquel il n’a quelquefois même pas de liaison. On pourroit l’enlever,
et ce qui resteroit présenteroit encore un ensemble complet, régulier et continu.
On peut en dire autant des propylées par rapport au temple. Le sanctuaire
même, considéré relativement aux pièces qui l'environnent, est dans ce cas; on
pourroit les faire disparoître toutes, et il n’en resteroit pas moins un petit édifice
complet, qui auroit ses murs extérieurs en talus, revêtus de décorations, et
qui seroit couronné de la corniche et du cordon Égyptiens ; ce seroit, pour’ tout
dire, en un mot, une petite chapelle ou cella. On seroit tenté de croire, d’après
cela, que lorsque les Égyptiens avoient un édifice sacré à construire, ils commen-
çoient à en établir le sanctuaire, puis les pièces environnantes, et que, selon le
degré d’importance qu’ils vouloient lui donner, ils y ajoutoient successivement
un portique, puis un premier propylée, un second et même un troisième. G est
absolument là ce qui résulte de l’examen comparé de la construction des édifices
Égyptiens et de la description de Strabon.
L ’historien géographe; pour achever en quelque sorte de définir le pronaos ou
portique, ajoute que de chaque côté s’élève,ce qui en est appelé les ailes\ymçy.'\.
Cette dénomination deptères a un sens très-étendu (1). Dans les temples, il paroft
que les ailes, ou ptères, doivent se prendre pour tout ce qui en forme les côtés,
soit qu’il y ait des colonnes ou des murailles, soit que ces colonnes existent
dans l’intérieur ou à l’extérieur. Dans les périptères des Grecs, les ailes sont plus
particulièrement ces files de colonnes placées sur les flancs du corps de 1 édifice,
et qui font à son égard l’effet des ailes dans la structure d un oiseau (z). Les petits
temples Égyptiens, les Typhonium, ressemblent totalement, dans leur disposition,
aux périptères; et s’il étoit ici question de ceux-là, il ne pourroit y avoir de difficulté
sur l’application du mot ptères : mais il est évident que Strabon n entend
(1) Voyez l’Architecture de Vitruve, traduction de (2) Voyez les planches de Philæ, Edfou et Denderah,
Perrault, liv. I i i ,p a g . 64, note r. A . vol. I et IV -