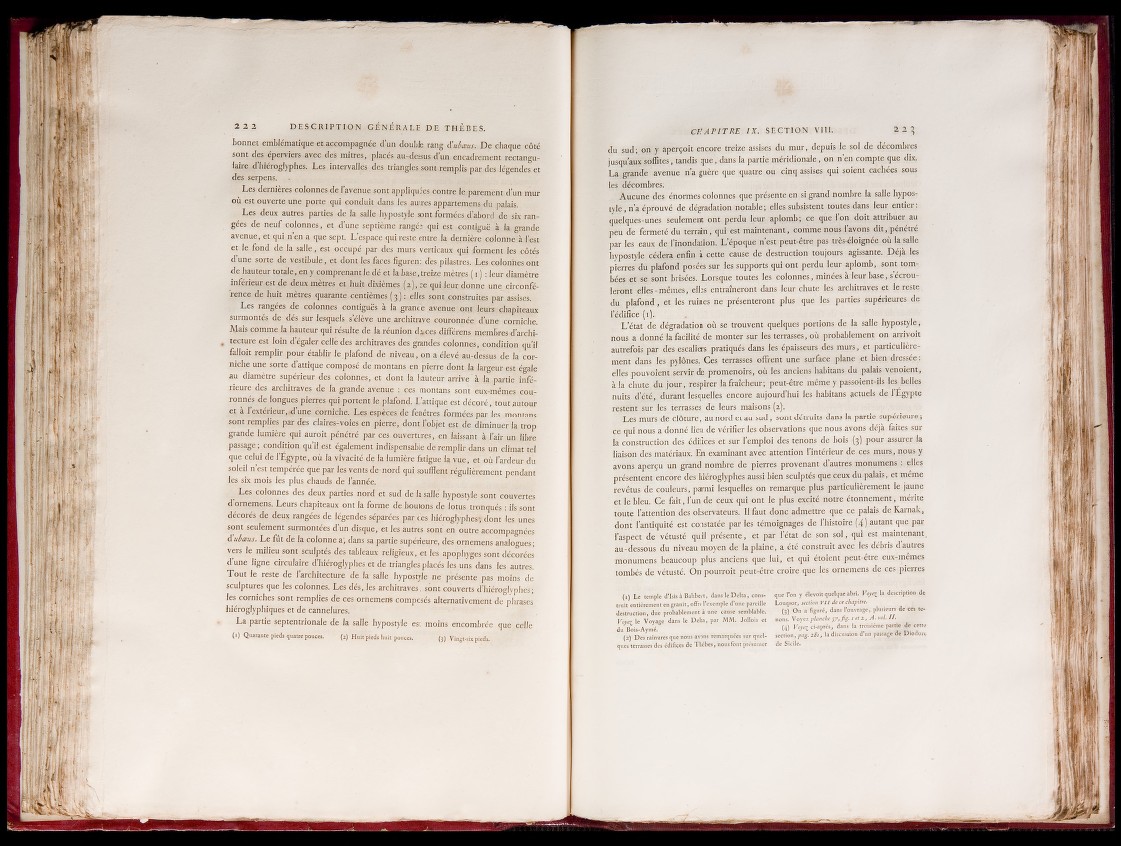
bonnet emblématique et. accompagnée d’un double rang d'uboeus. De chaque côté
sont des eperviers avec des mitres, places au-dessus dun encadrement rectangu-
laiie d hiéroglyphes. Les intervalles des triangles sont remplis par des légendes et
des serpens.
Les dernieres colonnes de 1 avenue sont appliquées contre le parement d’un mur
où est ouverte une porte qui conduit dans les autres appartemens du palais.
Les deux autres parties de la salle hypostyle sont formées d’abord de six rangées
de neuf colonnes, et d’une septième rangée qui est contiguë à la grande
avenue, et qui n’en a que sept. L ’espace qui reste entre la dernière colonne à l’est
et le fond de la salle, est occupé par des murs verticaux qui forment les côtés
d une sorte de vestibule, et dont les faces figurent des pilastres. Les colonnes ont
de hauteur totale, en y comprenant le dé et la base, treize mètres ( i ) : leur diamètre
inferieui est de deux métrés et huit dixièmes (2], ce qui leur donne une circonférence
de huit mètres quarante centièmes ( 3 ) :,elles sont construites par assises.
Les rangées de colonnes contiguës à la grande avenue ont leurs chapiteaux
surmontés de dés sur lesquels s’élève une architrave couronnée d’une corniche.
Mais comme la hauteur qui résulte de la réunion de»ces différens membres d’archi-
• tecture est loin d’égaler celle des architraves des grandes colonnes, condition qu'il
fallait remplir pour établir le plafond de niveau, on a élevé au-dessus de la corniche
une sorte dattique composé de mon tans en pierre dont la largeur est égale
au diamètre supérieur des colonnes, et dont la hauteur arrive à la partie inférieure
des architraves de la grande avenue : ces montans sont eux-mêmes couronnés
de longues pierres qui portent le plafond. L ’attique est décoré, tout autour
et à 1 extérieur, d ’une corniche. Les espèces de fenêtres formées par les montans
sont remplies par des claires-voies en pierre, dont l’objet est de diminuer la trop
grande lumière qui auroit pénétré par ces ouvertures, en laissant à l’air un libre
passage ; condition qu’il est également indispensable de remplir dans un climat tel
que celui de l’Égypte, où la vivacité de la lumière fatigue la vue, et où l’ardeur du
soleil n’est tempérée que par les vents de-nord qui soufflent régulièrement pendant
les six mois les plus chauds de l’année.
Les colonnes des deux parties nord et sud de la salle hypostyle sont couvertes
d omemens. Leurs chapiteaux ont la forme de boutons de lotus tronqués : ils sont
décorés de deux rangées de légendes séparées par des hiéroglyphes* dont les unes
sont seulement surmontées d’un disque, et les autres sont en outre accompagnées
d ubæus. Le fut de la colonne a', dans sa partie supérieure, des ornemens analogues ;
vers le milieu sont sculptés des tableaux religieux, et les apophyges sont décorées
d’une ligne circulaire d’hiéroglyphes et de triangles placés les uns dans les autres.
Tout le reste de 1 architecture de la salle hypostyle ne présente pas moins de
sculptures que les colonnes. Les dés, les architraves, sont couverts d’hiéroglyphes ;
les corniches sont remplies de ces ornemens composés alternativement de phrases
hiéroglyphiques et de cannelures.
La partie septentrionale de la salle hypostyle est moins encombrée que celle
<i) Quarante pieds quatre pouces. (a) Huit pieds huit pouces. (3) Vingt-six pieds.
du sud; on y aperçoit encore treize assises du mur, depuis le sol de décombres
jusqu’aux soffites, tandis que, dans la partie méridionale, on n’en compte que dix.
La grande avenue n’a guère que quatre ou cinq assises qui soient cachées sous
les décombres.
Aucune des énormes colonnes que présente en si grand nombre la salle hypostyle,
n’a éprouvé de dégradation notable; elles subsistent toutes dans leur entier,
quelques-unes seulement ont perdu leur aplomb; ce que Ion doit attribuei au
peu de fermeté du terrain, qui est maintenant, comme nous l’avons dit, pénétré
par les eaux de l’inondation. L ’époque n’est peut-être pas très-éloignée où la salle
hypostyle cédera enfin à cette cause de destruction toujours agissante. Déjà les
pierres du plafond posées sur les supports qui ont perdu leur aplomb, sont tombées
et se sont brisées. Lorsque toutes les colonnes, minces a leur base, s écrouleront
elles-mêmes, elles entraîneront dans leur chute les architraves et le reste,
du plafond, et les ruines ne présenteront plus que les parties supérieures de
l’édifice (1).
L ’état de dégradation où se trouvent quelques portions de la salle hypostyle,
nous a donné la facilité de monter sur les terrasses, où probablement on arrivoit
autrefois par des escaliers pratiqués dans les épaisseurs des murs, et particulièrement
dans les pylônes. Ces terrasses offrent une surface plane et bien dressée ;
elles pouvoient servir de promenoirs, où les anciens habitans du palais venoient,
à la chute du jour, respirer la fraîcheur; peut-être même y passoient-ils les belles
nuits d’été, durant lesquelles encore aujourd’hui les habitans actuels de 1 Egypte
restent sur les terrasses de leurs maisons (2)'.
Les murs de clôture, au nord et au sud, sont détruits dans la partie supérieure;
ce qui nous a donné lieu de vérifier les observations que nous avons déjà faites sur
la construction des édifices et sur l’emploi des tenons de bois (3) pour assurer la
liaison des matériaux. En examinant avec attention l’intérieur de ces murs, nous y
avons aperçu un grand nombre de pierres provenant d autres monumens . elles
présentent encore des hiéroglyphes aussi bien sculptes que ceux du palais, et meme
revêtus de couleurs, parmi lesquelles on remarque plus particulièrement le jaune
et le bleu. Ce fait, l’un de ceux qui ont le plus excité notre étonnement, mérite
toute l’attention des observateurs. Il faut donc admettre que ce palais de Karnak,
dont l’antiquité est constatée par les témoignages de l’histoire (4 ) autant que par
l’aspect de vétusté qu’il présente, et par l’état de son sol, qui est maintenant,
au-dessous du niveau moyen de la plaine, a été construit avec les débris d autres
monumens beaucoup plus anciens que lui, et qui étoient peut-être eux-memes
tombés de vétusté. On pourroit peut-être croire que les ornemens de ces pierres
(1) L e temple d'Isis à Bahbeÿt, dans le D elta, cons- que l’on y élevolt quelque abri. Voye* la description de
truit entièrement en granit, offre l’exemple d’une pareille Louqsor, section V II de ce chapitre.
destruction, due probablement à une cause semblable. (3) On a figuré, dans l’ouvrage, plusieurs de ces te-
Voyer le Voyage dans le Delta, par MM. Jollois et nons. Voyez planche ¡y , f g . i e n , A .vo l. II .
du Bois-Aymé. (4) Koyeg ci-après, dans la troisième partie de cette
(2) Des rainures que nous avons remarquées sur quel- section, pag. 2 S 1, la discussion dun passage de Dtodore
ques terrasses des édifices de Thèbes, nous font présumer de Sicile.