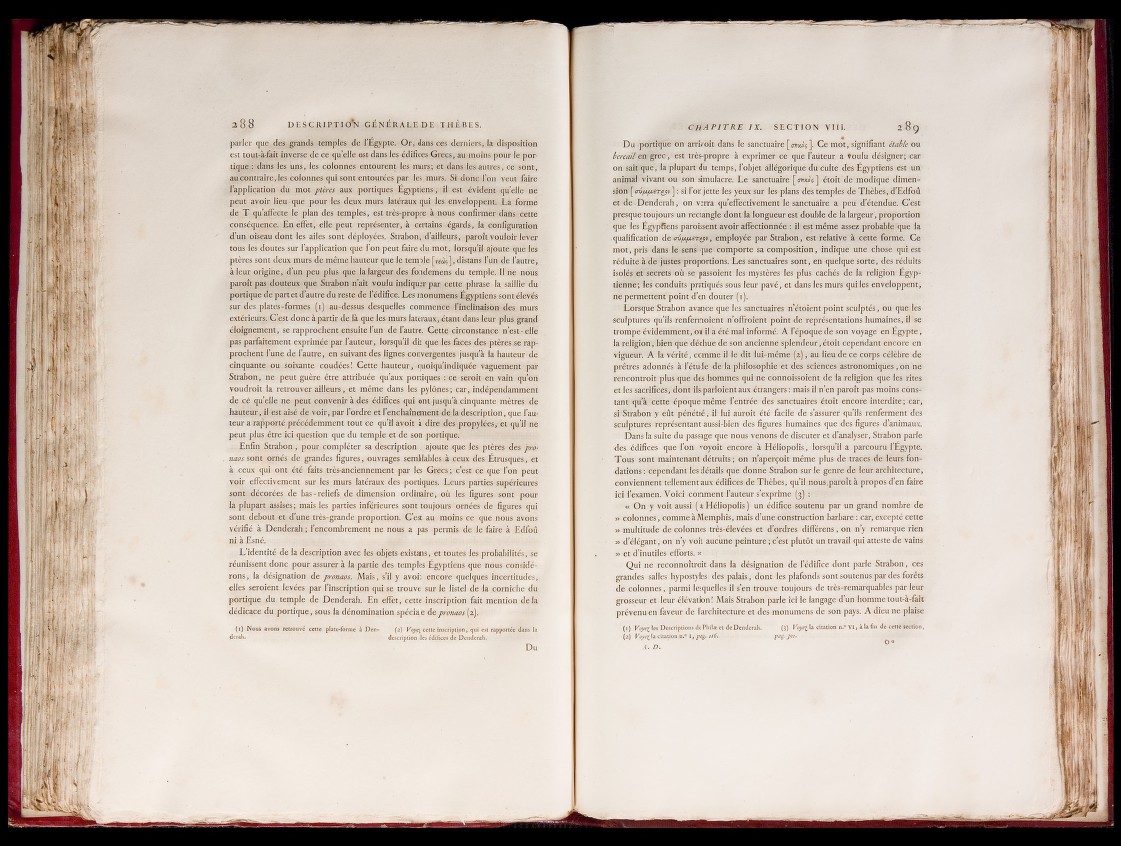
parler que des grands temples de l’Egypte. Or, dans ces derniers, la disposition
est tout-à-fait inverse de ce qu’elle est dans les édifices Grecs, au moins pour le portique
: dans les uns, les colonnes entourent les murs; et dans les autres, ce sont,
au contraire, les colonnes qui sont entourées par les murs. Si donc l’on veut faire
l’application du mot ptères aux portiques Égyptiens, il est évident qu’elle ne
peut avoir lieu que pour les deux murs latéraux qui les enveloppent. La forme
de T qu’affecte le plan des temples, est très-propre à nous confirmer dañs cette
conséquence. En effet, elle peut représenter, à certains égards, la configuration
d’un oiseau dont les ailes sont déployées. Strabon, d’ailleurs, paroît vouloir lever
tous les doutes sur l’application que l’on peut faire du mot, lorsqu’il ajoute que les
ptères sont deux murs de même hauteur que le temple [vsàs], distans l’un de l’autre,
à leur origine, d’un peu plus que la largeur des fondemens du temple. Il ne nous
paroît pas douteux que Strabon n’ait voulu indiquer par cette phrase la^ saillie du
portique de part et d’autre du reste de l’édifice. Les monumens Égyptiens sont élevés
sur des plates-formes (i) au-dessus desquelles commence 1’inclinaison des murs
extérieurs. C’est donc à partir de là que les murs latéraux, étant dans leur plus grand
éloignement, se rapprochent ensuite l’un de l’autre. Cette circonstance n’est-elle
pas parfaitement exprimée par l’auteur, lorsqu’il dit que les faces des ptères se rapprochent
l’une de l’autre, en suivant des lignes convergentes jusqu’à la hauteur de
cinquante ou soixante coudées! Cette hauteur, quoiqu’indiquée vaguement par
Strabon, ne peut guère être attribuée qu’aux portiques : ce seroit en vain qu’on
voudrait la retrouver ailleurs, et même dans les pylônes; car, indépendamment
de cé qu’elle ne peut convenir à des édifices qui ont jusqu’à cinquante mètres de
hauteur, il est aisé de voir, par l’ordre et l’enchaînement de la description, que l’auteur
a rapporté précédemment tout ce qu’il avoit à dire des propylées,- et qu’il ne
peut plus être ici question que du temple et de son portique.
Enfin Strabon , pour compléter sa description , ajoute que les ptères des 'pronaos
sont ornés de grandes figures, ouvrages semblables à ceux des Étrusques, et
à ceux qui ont été faits très-anciennement par les Grecs ; c’est ce que l’on peut
voir effectivement sur les murs latéraux des portiques. Leurs parties supérieures
sont décorées de bas-reliefs de dimension ordinaire, où les figures sont pour
la plupart assises; mais les parties inférieures sont toujours ornées de figures qui
sont debout et d’une très-grande proportion. C’est au moins ce que nous avons
vérifié à Denderah ; l’encombrement ne nous a pas permis de le faire à Edfoû
ni à Esné.
L ’identité de la description avec les objets existans, et toutes les probabilités, se
réunissent donc pour assurer à la partie des temples Égyptiens que nous considérons,
la désignation de pronaos. Mais, s’il y avoit encore quelques incertitudes,
elles seraient levées par l’inscription qui se trouve sur le listel de la corniche du
portique du temple de Denderah. En effet, cette inscription fait mention delà
dédicace du portique, sous la dénomination spéciale de pronaos (2).
(1) Nous avons retrouvé cette plate-forme à Den- (2) Voyez cette inscription, qui est rapportée dans la
de rah . description des édifices de Denderah.
C H A P I T R E IX. S E C T IO N VI I I . 2 8 9
#
Du portique on arrivoit dans le sanctuaire h M : Ce mot, signifiant étable ou
bercail t n grec, est très-propre à exprimer ce que l’auteur a toulu désigner; car
on sait que, la plupart du temps, l’objet allégorique du culte des Égyptiens est un
animal vivant ou son simulacre. Le sanctuaire [ tmaîç ] étoit de modique dimension
[ ¡nf s p . t r ] : si l’on jette les yeux sur les plans des temples de Thèbes, d’Edfoû
et d e . Denderah, on verra qu’effectivement le sanctuaire a peu d’étendue. G’est
presque toujours un rectangle dont la longueur est double de la largeur , proportion
que les Égypfiens paraissent avoir affectionnée : il est même assez probable que la
qualification de ovpfitrçyv, employée par Strabon, est relative à cette forme. Ce
mot, pris dans le sens que comporte sa composition, indique une chose qui est
réduite à de justes proportions. Les sanctuaires sont, en quelque sorte, des réduits
isolés et secrets où se passoient les mystères les plus cachés de la religion Égyptienne;
les conduits pratiqués sous leur pavé, et dans les murs qui les enveloppent,
ne permettent point d’en douter (1).
Lorsque Strabon avance que les sanctuaires n’étoient point sculptés, ou que les
sculptures qu’ils renfermoient n’offraient point de représentations humaines, il se
trompe évidemment, ou il a été mal informé. A l’époque de son voyage en Égypte,
la religion, bien que déchue de son ancienne splendeur, étoit cependant encore en
vigueur. A la vérité, comme il le dit lui-même (2), au lieu de ce corps célèbre de
prêtres adonnés à l’étude de la philosophie et des sciences astronomiques , on ne
rencontrait plus que des hommes qui ne connoissoient de la religion que les rites
et les sacrifices, dont ils parloient aux étrangers ; mais il n’en paroît pas moins constant
qu’à cette époque même l’entrée des sanctuaires étoit encore interdite ; car,
si Strabon y eût pénétré, il lui auroit été facile de s’assurer qu’ils renferment des
sculptures représentant aussi-bien des figures humaines que des figures d’animaux.
Dans la suite du passage que nous venons de discuter et d’analyser, Strabon parle
des édifices que l’on voyoit encore à Héliopolis , lorsqu’il a parcouru l’Egypte.
Tous sont maintenant détruits ; on n’aperçoit même plus de traces de leurs fondations
: cependant les détails que donne Strabon sur le genre de leur architecture,
conviennent tellement aux édifices de Thèbes, qu’il nous .paroît à propos d’en faire
ici l’examen. Voici comment l’auteur s’exprime (3) :
« On y voit aussi ( à Héliopolis ) un édifice soutenu par un grand nombre de
» colonnes, comme àMemphis, mais d’une construction barbare : car, excepté cette
» multitude de colonnes très-élevées et d’ordres différens, on n’y remarque rien
» d’élégant, on n’y voit aucune peinture ; c’est plutôt un travail qui atteste de vains
et d’inutiles efforts. »
Qui ne reconnoîtroit dans la désignation de l’édifice dont parle Strabon, ces
grandes salles hypostyles des palais, dont les plafonds sont soutenus par des forêts
de colonnes, parmi lesquelles il s’en trouve toujours de très-remarquables par leur
grosseur et leur élévation! Mais Strabon parle ici le langage d’un homme tout-à-fait
prévenu en faveur de l'architecture et des monumens de son pays. A dieu ne plaise
( 1 ) Voyei les Descriptions de Philæ et de Denderah. (3) Voyrt_ la citation n." V I, à la fin de cette section,
(2) VoyC7 la citation n.“ I , psg. 116. p a g .joi.
0«
A . D .