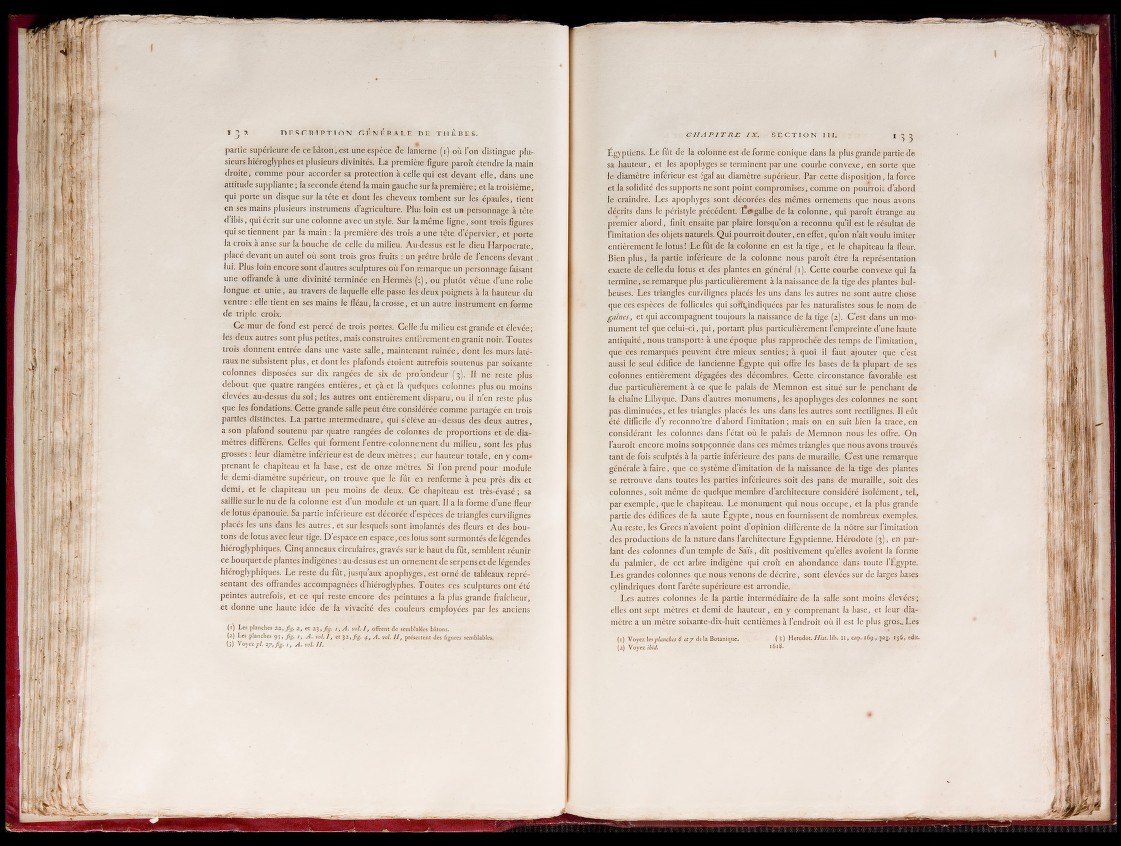
f i l
i l il f i
fil M l
l ™ ü i
W M
S I
r a i
■
M i I
l l l
; I l I
1 1
' 11l i l
I f !If-Ip
| j f j
l i t
l lw fi#
f f im -
I I ,
# § .!
f i S rSl
If i #
§ & $ > il
i l
i f
partie supérieure de cefrâton,est une espèce de lanterne (1) où l’on distingue plusieurs
hiéroglyphes et plusieurs divinités. La première figure paroît étendre la main
droite, comme pour accorder sa protection à celle qui est devant elle, dans une
attitude suppliante ; la seconde étend la main gauche sur la première ; et la troisième,
qui porte un disque sur la tète et dont les cheveux tombent sur les épaules, tient
en ses mains plusieurs instrumens d’agriculture. Plus loin est un personnage à tête
d ibis, qui écrit sur une colonne avec un style. Sur la même ligne, sont trois figures
qui se tiennent par la main : la première des trois a une tête d’épctvier, et porte
la croix a anse sur la bouche de celle du milieu. Au-dessus est le dieu Harpocrate,
placé devant un autel où sont trois gros fruits : un prêtre brûle de l’encens devant
lui. Plus loin encore sont d’autres sculptures où l’on remarque un personnage faisant
une offrande a une divinité terminée en Hermès (2), ou plutôt vêtue d’une robe
longue et unie, au travers de laquelle elle passe les deux poignets à la hauteur du
ventre : elle tient en ses mains le fléau, la crosse, et Un autre instrument en forme
de triple croix.
Ce mur de fond est percé de trois portes. Celle du milieu est grande et élevée;
les deux autres sont plus petites, mais construites entièrement en granit noir. Toutes
trois donnent entrée dans une vaste salle, maintenant ruinée, dont les. murs latéraux
ne subsistent plus, et dont les plafonds étoient autrefois soutenus par soixante
colonnes disposées sur dix rangées de six de profondeur (3). Il ne reste plus
debout que quatre rangées entières, et çà et là quelques colonnes plus ou moins
élevées au-dessus du sol; les autres ont entièrement disparu, ou il n’en reste plus
que les fondations. Cette grande salie peut être considérée comme partagée en trois
parties distinctes. L a partie intermédiaire, qui s’élève au-dessus des deux autres,
a son plafond soutenu par quatre rangées de colonnes de proportions et de diamètres
différens. Celles qui forment l’entre-colonnement du milieu, sont les plus
grosses : leur diamètre inférieur est de deux mètres ; leur hauteur totale, en y comprenant
le chapiteau et la base, est de onze mètres. Si l’on prend pour module
le demi-diamètre supérieur, on trouve que le fût en renferme à peu près dix et
demi, et le chapiteau un peu moins de deux. Ce chapiteau est très-évasé ; sa
saillie sur le nu de la colonne est d’un module et un quart. Il a la forme d’une fleur
de lotus épanouie. Sa partie inférieure est décorée d’espèces de triangles curvilignes
placés les uns dans les autres, et sur lesquels sont implantés des fleurs et des boutons
de lotus avec leur tige. D’espace en espace, ces lotus sont surmontés de légendes
hiéroglyphiques. Cinq anneaux circulaires, gravés sur le haut du fût, semblent réunir
ce bouquet de plantes indigènes ; au-dessus est un ornement de serpens et de légendes
hiéroglyphiques. Le reste du fût, jusqu’aux apophyges, est orné de tableaux représentant
des offrandes accompagnées d’hiéroglyphes. Toutes ces sculptures ont été
peintes autrefois, et ce qui reste encore des peintures a la plus grande fraîcheur,
et donne une haute idée de la vivacité des couleurs employées par les anciens
(1) Les planches 2 2 , Jig. 2 , et 2 3 , fig. i , A . vol. 1 , offrent de semblables bâtons.
(2) Les planches 95, fig, i , A . vol. I , et 32 > j%> A . vol. I I , présentent cles figures semblables.
(3) Voyez pl. 27, fig. i , A . vol. I I .
Égyptiens. Le fût de la colonne est de forme conique dans la plus grande partie de
sa hauteur, et les apophyges se terminent par une courbe convexe, en sorte que
le diamètre inférieur est égal au diamètre supérieur. Par cette disposition, la force
et la solidité des supports ne sont point compromises, comme on pourroit d’abord
le craindre. Les apophyges sont décorées des mêmes ornemens que nous avons
décrits dans le péristyle précédent. L»galbe de la colonne, qui paroît étrange au
premier abord, finit ensuite par plaire lorsqu’on a reconnu qu’il est le résultat de
l’imitation des objets naturels. Qui pourroit douter, en effet, qu’on n’ait voulu imiter
entièrement le lotus! Le fût de la colonne en est la tige, et le chapiteau la fleur.
Bien plus, la partie inférieure de la colonne nous paroît être la représentation
exacte de celle du lotus et des plantes en général (i). Cette courbe convexe qui .la
termine, se remarque plus particulièrement à la naissance de la tige des plantes bulbeuses.
Les triangles curvilignes placés les uns dans les autres ne sont autre chose
que ces espèces de follicules qui soRt.indiquées par les naturalistes sous le nom de
gaines, et qui accompagnent toujours la naissance de la tige (2). C’est dans un monument
tel que celui-ci, qui, portant plus particulièrement l’empreinte d’une haute
antiquité, nous transporte à une époque plus rapprochée des temps de l’imitation,
que ces remarques peuvent être mieux senties ; à quoi il faut ajouter que c’est
aussi le seul édifice de l’ancienne Egypte qui offre les bases de la plupart de ses
colonnes entièrement dégagées des décombres. Cette circonstance favorable est
due particulièrement à ce que le palais de Memnon est situé sur le penchant de
la chaîne Libyque. Dans d’autres monumens, les apophyges des colonnes ne sont
pas diminuées, et les triangles placés les uns dans les autres sont rectilignes. Il eût
été difficile d’y reconnoître d’abord 1 imitation ; mais on en suit bien la trace, en
considérant les colonnes dans l’état où le palais de Memnon nous les offre. On
l’auroit encore moins soupçonnée dans ces mêmes triangles que nous avons trouvés
tant de fois sculptés à la partie inférieure des pans de muraille. C’est une remarque
générale à faire, que ce système d’imitation de la naissance de la tige des plantes
se retrouve dans toutes les parties inférieures soit des pans de muraille, soit des
colonnes, soit même de quelque membre d’architecture considéré isolément, tel.,
par exemple, que le chapiteau. Le monument qui nous occupe, et la plus grande
partie des édifices de la haute Egypte, nous en fournissent de nombreux exemples.
Au reste, les Grecs n’avoient point d’opinion-différente de la nôtre sur l imitation
des productions de la nature dans l’architecture Égyptienne. Hérodote (3), en parlant
des colonnes d’un temple de Sais, dit positivement qu’elles avoient la forme
du palmier, de cet arbre indigène qui croît en abondance dans toute l’Egypte.
Les grandes colonnes que nous venons de décrire, sont élevées sur de larges bases
cylindriques dont l’arête supérieure est arrondie.
Les autres colonnes de la partie intermédiaire de la salle sont moins élevées--;
elles ont sept mètres et demi de hauteur, en y comprenant la base, et leur diamètre
a un mètre soixante-dix-huit centièmes à l’endroit où il est le plus gros... Les
(1) Voyez les planches e e t ? de la Botanique. , . ( 3) Herodot. Hist.Mb. I I , cap. 169 , pag. 15 6 , edit.
(2) Voyez ïbid. 16 1S .