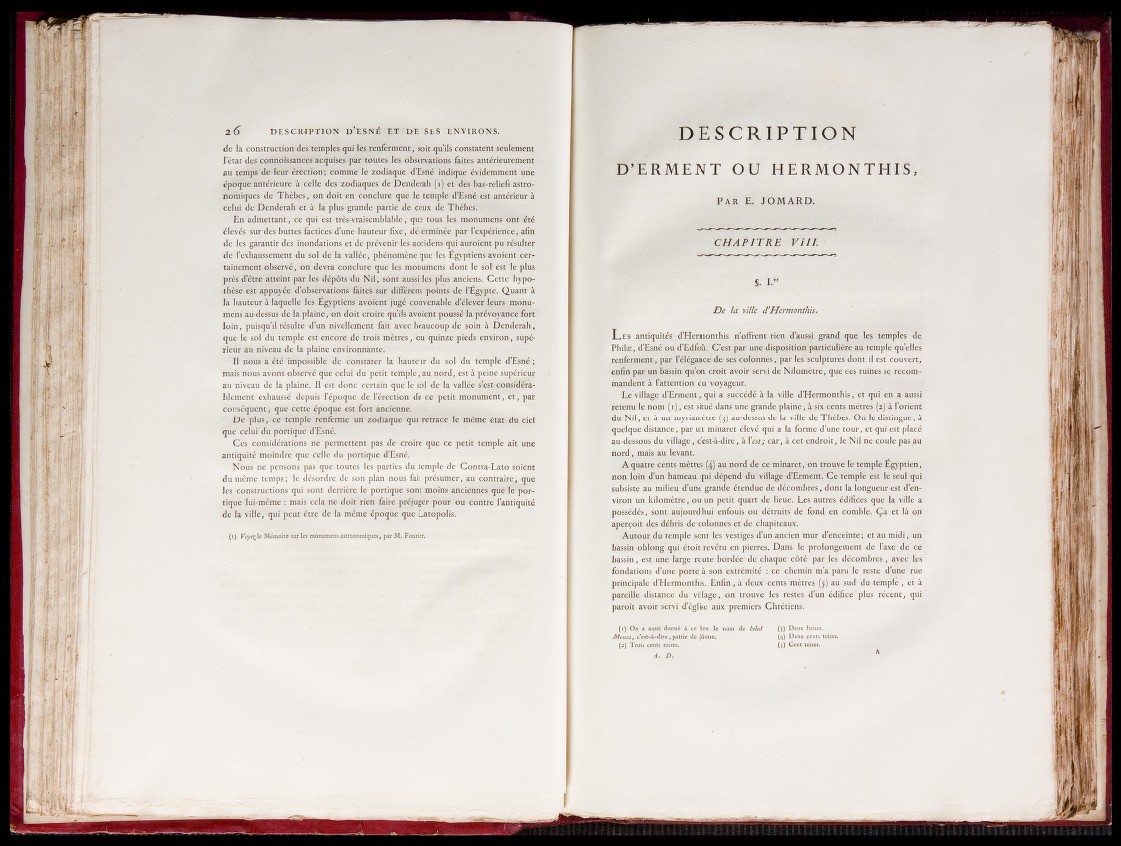
de la construction des temples qui les renferment, soit qu’ils constatent seulement
l’état des connoissances acquises par toutes les observations faites antérieurement
au temps de leur érection; comme le zodiaque d’Esné indique évidemment une
époque antérieure à celle des zodiaques de Denderah (i) et des bas-reliefs astronomiques
de Thèbes, on doit en conclure que le temple d’Esné est antérieur à
celui de Denderah et à la plus grande partie de ceux de Thèbes.
En admettant, ce qui est très-vraisemblable, que tous les monumens ont été
élevés sur des buttes factices d’une hauteur fixe, déterminée par l’expérience, afin
de les garantir des inondations et de prévenir les accidens qui auroient pu résulter
de l’exhaussement du sol de la vallée, phénomène que les Egyptiens avoient certainement
observé, on devra conclure que les monumens dont le sol est le plus
près d’être atteint par les dépôts du Nil, sont aussi les plus anciens. Cette hypothèse
est appuyée d’observations faites sur différens points de l’Egypte. Quant à
la hauteur à laquelle les Egyptiens avoient jugé convenable d’élever leurs monumens
au-dessus de la plaine, on doit croire qu’ils avoient poussé la prévoyance fort
loin, puisqu’il résulte d’un nivellement fait avec beaucoup de soin à Denderah,
que le sol du temple est encore de trois mètres, ou quinze pieds environ, supérieur
au niveau de la plaine environnante.
Il nous a été impossible de constater la hauteur du sol du temple d’Esné ;
mais nous avons observé que celui du petit temple, au nord, est à peine supérieur
au niveau de la plaine. Il est donc certain que le sol de la vallée s’est considérablement
exhaussé depuis l’époque de l’érection de ce petit monument, et, par
conséquent, que cette époque est fort ancienne.
De plus, ce temple renferme un zodiaque qui retrace le même état du ciel
que celui du portique d’Esné.
Ces considérations ne permettent pas de croire que ce petit temple ait une
antiquité moindre que celle du portique d’Esné.
Nous ne pensons pas que toutes les parties du temple de Contra-Lato soient
du même temps; le désordre de son plan nous fait présumer, au contraire, que
les constructions qui sont derrière le portique sont moins anciennes que le portique
lui-même : mais cela ne doit rien faire préjuger pour ou contre l’antiquité
de la ville, qui peut être de la même époque que Latopolis.
(i) Voyelle Mémoire sur les monumens astronomiques, par M. Fourier.
D’ E RMEN T OU HE RMONTHI S ,
P A R E . JO M A R D .
c h a p i t r e mm
§. j p f
D e la ville d’Hermonthis.
L e s antiquités d’Hermonthis n’offrent rien d’aussi grand que les temples de
Philæ, d’Esné ou d’Edfoû. C ’est par une disposition particulière au temple qu’elles
renferment, par l’élégance de ses colonnes, par les sculptures dont il est couvert,
enfin par un bassin qu’on croit avoir servi de Nilomètre, que ces ruines se recommandent
à l’attention du voyageur.
Le village d’Erment, qui a succédé à la ville d’Hermonthis, et qui en a aussi
retenu le nom (i), est situé dans une grande plaine, à six cents mètres (2) à l’orient
du Nil, et à un myriamètre (3) au-dessus de la ville de Thèbes. On le distingue, à
quelque distance, par un minaret élevé qui a la forme d’une tour, et qui est placé
au-dessous du village, c’est-à-dire, à l’est; car, à cet endroit, le Nil ne coule pas au
nord, mais au levant.
A quatre cents mètres (4) au nord de ce minaret, on trouve le temple Égyptien,
non loin d’un hameau qui dépend du village d’Erment. Ce temple est le seul qui
subsiste au milieu d’une grande étendue de décombres, dont la longueur est d’environ
un kilomètre, ou un petit quart de lieue. Les autres édifices que la ville a
possédés, sont aujourd’hui enfouis ou détruits de fond en comble. Çà et là on
aperçoit des débris de colonnes et de chapiteaux.
Autour du temple sont les vestiges d’un ancien mur d’enceinte; et au midi, un
bassin oblong qui étoit revêtu en pierres. Dans le prolongement de l’axe de ce
bassin, est une large route bordée de chaque côté par les décombres, avec les
fondations d’une porte à son extrémité : ce chemin m’a paru le reste d’une rue
principale d’Hermonthis. Enfin , à deux cents mètres (5) au sud du temple , et à
pareille distance du village, on trouve les restes d’un édifice plus récent, qui
paroît avoir servi d’église aux premiers Chrétiens.
(1) On a aussi donné à ce lieu le nom de beled (3) Deux lieues.
Mousa, c’est-à-dire , patrie de Moïse. (4) Deux cents toises.
(2) Trois cents toises. (5) Cent toises.
I D. A