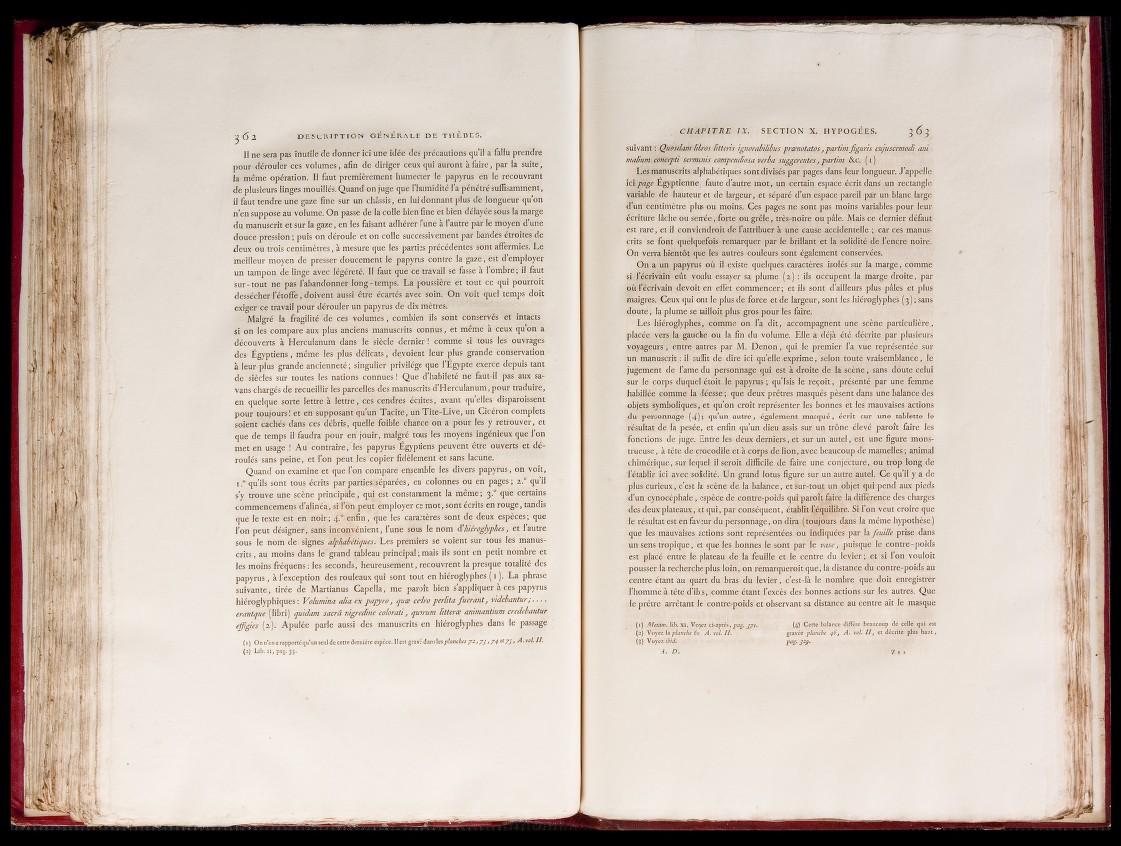
Il ne sera pas inutile de donner ici une idée des précautions qu’il a fallu prendre
pour dérouler ces volumes, afin de diriger ceux qui auront à faire, par la suite,
la même opération. Il faut premièrement humecter le papyrus en le recouvrant
de plusieurs linges mouillés. Quand on juge que l’humidité l’a pénétré suffisamment,
il faut tendre une gaze fine sur un châssis, en lui donnant plus de longueur qu’on
n’en suppose au volume. On passe de la colle tien fine et bien délayée sous la marge
du manuscrit et sur la gaze, en les faisant adhérer l’une à l’autre par le moyen d’une
douce pression ; puis on déroule et on colle successivement par bandes étroites de
deux ou trois centimètres, à mesure que les parties précédentes sont affermies. Le
meilleur moyen de presser doucement le papyrus contre la gaze, est d’employer
un tampon de linge avec légéreté. Il faut que ce travail se fasse à l’ombre ; il faut
sur-tout ne pas l’abandonner long-temps. La poussière et tout ce qui pourroit
dessécher l’étoffe, doivent aussi être écartés avec soin. On voit quel temps doit
exiger ce travail pour dérouler un papyrus de dix mètres.
Malgré la fragilité de ces volumes, combien ils sont conservés et intacts
si on les compare aux plus anciens manuscrits connus, et même à ceux qu on a
découverts à Herculanum dans le siècle dernier ! comme si tous les ouvrages
des Égyptiens, même les plus délicats, devoient leur plus grande conservation
à leur plus grande ancienneté ; singulier privilège que l’Ègypte exerce depuis tant
de siècles sur toutes les nations connues ! Que d’habileté ne faut-il pas aux sa-
vans chargés de recueillir les parcelles des manuscrits d’Herculanum, pour traduire,
en quelque sorte lettre à lettre, ces cendres écrites, avant qu’elles disparoissent
pour toujours 1 et en supposant qu’un Tacite, un Tite-Live, un Cicéron complets
soient cachés-dans ces débris, quelle foible chance on a pour les y retrouver, et
que de temps il faudra pour en jouir, malgré tous les moyens ingénieux que l’on
met en usage ! Au contraire, les papyrus Égyptiens peuvent être ouverts et déroulés
sans peine, et l’on peut les copier fidèlement et sans lacune.
Quand on examine et que l’on compare ensemble les divers papyrus, on voit,
i.° qu’ils sont tous écrits par parties sëparées, en colonnes ou en pages; z.° quil
s’y trouve une scène principale, qui est constamment la même; 3.0 que certains
commencemens d’alinéa, si l’on peut employer ce mot, sont écrits en rouge, tandis
que le texte est en noir; 4-° enfin, que les caractères sont de deux espèces; que
l’on peut désigner, sans inconvénient, l’une sous le nom d’hiéroglyphes, et 1 autre
sous le nom de signes alphabétiques. Les premiers se voient sur tous les manuscrits
, au moins dans le grand tableau principal ; mais ils sont en petit nombre et
les moins fréquens: les seconds, heureusement, recouvrent la presque totalité des
papyrus , à l’exception des rouleaux qui sont tout en hiéroglyphes ( 1 ). La phrase
suivante, tirée de Martianus Capella, me paroît bien s’appliquer à ces papyrus
hiéroglyphiques : Volumina alta ex papyro, quee cedro perlita fuerant, videbantur; . . . .
erantque (libri) quidam sacra nigredine colorati, quorum litteroe animantium credebantur
effigies (2). Apulée parle aussi des manuscrits en hiéroglyphes dans le passage
(1) Onn’enarapportéqu’unseulde cette dernière espèce. 11 est grave demies planches 7 2 , 7 3 , 7 4 “ 7 5 , A . vol. I I .
(2) Lib. l l .p a g .3 5 .
suivant : Quosdam libros litteris ignorabilibus preenotatos, pariimfiguris cujuscemodi oui
malium concepti sermonis compcndiosa verba suggerentes, partim &c. (1)
Les manuscrits alphabétiques sont divisés par pages dans leur longueur. J ’appelle
ici page Egyptienne, faute d’autre mot, un certain espace écrit dans un rectangle
variable de hauteur et de largeur, et séparé d’un espace pareil par un blanc large
d’un centimètre plus ou moins. Ces pages ne sont pas moins variables pour leur
écriture lâche ou serrée, forte ou grêle, très-noire ou pâle. Mais ce dernier défaut
est rare, et il conviendroit de l’attribuer à une cause accidentelle ; car ces manuscrits
se font quelquefois remarquer par le brillant et la solidité de l’encre noire.
On verra bientôt que les autres couleurs sont également conservées.
On a un papyrus où il existe quelques caractères isolés sur la marge, comme
si l’écrivain eût voulu essayer sa plume (2) : ils occupent la marge droite, par
où l’écrivain devoit en effet commencer; et ils sont d’ailleurs plus pâles et plus
maigres. Ceux qui ont le plus de force et de largeur, sont les hiéroglyphes ( 3 ) ; sans
doute, la plume se tailloit plus gros pour les faire.
Les hiéroglyphes, comme on l’a dit, accompagnent une scène particulière,
placée vers la gauche ou la fin du volume. Elle a déjà été décrite par plusieurs
voyageurs, entre autres par M. Denon, qui le premier l’a vue représentée sur
un manuscrit : il suffit de dire ici qu’elle exprime, selon toute vraisemblance, le
jugement de l’ame du personnage qui est à droite de la scène, sans doute celui
sur le corps duquel étoit le papyrus ; qu’Isis le reçoit, présenté par une femme
habillée comme la déesse ; que deux prêtres masqués pèsent dans une balance des
objets symboliques, et qu’on croit représenter les bonnes et les mauvaises actions
du personnage (4); qu’un autre, également masqué, écrit sur une tablette le
résultat de la pesée, et enfin qu’un dieu assis sur un trône élevé paroît faire les
fonctions de juge. Entre les deux derniers, et sur un autel, est une figure monstrueuse
, à tête de crocodile et à corps de lion, avec beaucoup de mamelles ; animal
chimérique, sur lequel il seroit difficile de faire une conjecture, ou trop long de
l’établir ici avec solidité. Un grand lotus figure sur un autre autel. Ce qu’il y a de
plus curieux, c’est la scène de la balance, et sur-tout un objet qui pend aux pieds
d’un cynocéphale, espèce de contre-poids qui paroît faire la différence des charges
des deux plateaux, et qui, par conséquent, établit l’équilibre. Si l’on veut croire que
le résultat est en faveur du personnage, on dira (toujours dans la même hypothèse)
que les mauvaises actions sont représentées ou indiquées par la feuille prise dans
un sens tropique, et que les bonnes le sont par le vase, puisque le contre-poids
est placé entre le plateau de la feuille et le centre du levier ; et si l’on vouloit
pousser la recherche plus loin, on remarqueroit que, la distance du contre-poids au
centre étant au quart du bras du levier, c’est-là le nombre que doit enregistrer
l’homme/à tête d’ibis, comme étant l’excès des bonnes actions sur les autres. Que
le prêtre arrêtant le contre-poids et observant sa distance au centre ait le masque
(1) Metam. Iib. x i. Voyez ici-après, pag. 371. (4) Cette balance diffère beaucoup de celle qui est
(2) Voyez ia planche 60, A . vol. I I . gravée planche f.6, A . vol. I I , et décrite plus haut,
(3) Voyez ibid. .. pag. J2 ÿ .
A . D . 7 z 2