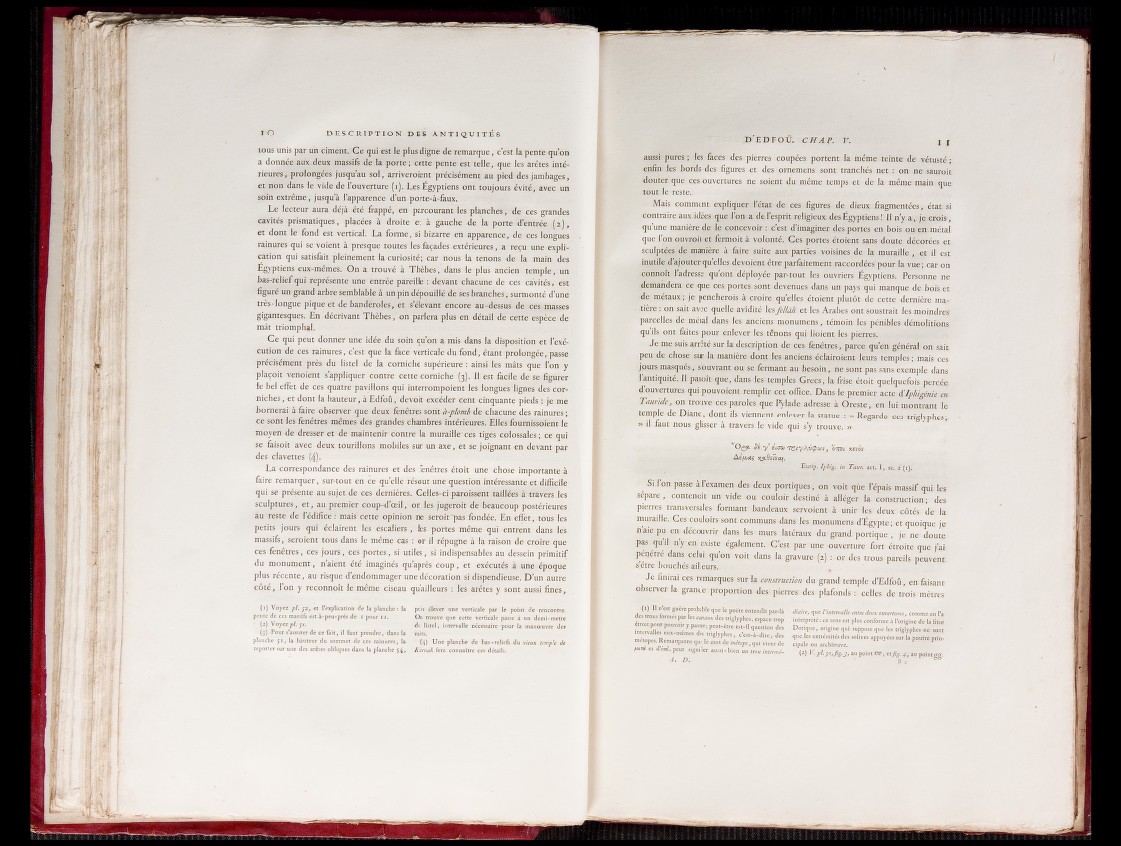
tous unis par un ciment. Ce qui est le plus digne de remarque, c’est la pente qu’on
a donnée aux deux massifs de la porte; cette pente est telle, que les arêtes intérieures
, prolongées jusqu’au sol, arriveraient précisément au pied des jambages,
et non dans le vide de l’ouverture (i). Les Égyptiens ont toujours évité, avec un
soin extrême, jusqu’à l’apparence d’un porte-à-faux.
Le lecteur aura déjà été frappé, en parcourant les planches, de ces grandes
cavités prismatiques, placées à droite et à gauche de la porte d’entrée (2 ) ,
et dont le fond est vertical. La fonne, si bizarre en apparence, de ces longues
rainures qui se voient à presque toutes les façades extérieures, a reçu une explication
qui satisfait pleinement la curiosité ; car nous la tenons de la main des
Égyptiens eux-mêmes. On a trouvé à Thèbes, dans le plus ancien temple, un
bas-relief qui représente une entrée pareille : devant chacune de ces cavités, est
figuré un grand arbre semblable à un pin dépouillé de ses branches, surmonté d’une
très-longue pique et de bandèroles, et s’élevant encore au-dessus de ces masses
gigantesques. En décrivant Thèbes, on parlera plus en détail de cette espèce de
mât triomphal.
Ce qui peut donner une idée du soin qu’on a mis dans la disposition et l’exécution
de ces rainures, c’est que la face verticale du fond, étant prolongée, passe
précisément près du listel de la corniche supérieure : ainsi les mâts que l’on y
plaçoit venoient s’appliquer contre cette corniche (3). Il est facile de se figurer
le bel effet de ces quatre pavillons qui interrompoient les longues lignes des corniches
, et dont la hauteur, à Edfoû, devoit excéder cent cinquante pieds : je me
bornerai à faire observer que deux fenêtres sont à-plomb de chacune des rainures ;
ce sont les fenêtres mêmes des grandes chambres intérieures. Elles fournissoient le
moyen de dresser et de maintenir contre la muraille'ces tiges colossales; ce qui
se faisoit avec deux tourillons mobiles sur un axe, et se joignant en devant par
des clavettes (4).
La correspondance des rainures et des fenêtres étoit une chose importante à
faire remarquer, sur-tout en ce qu’elle résout une question intéressante et difficile
qui se présente au sujet de ces dernières. Celles-ci paroissent taillées à travers les
sculptures, et, au premier coup-d’oeil, on les jugerait de beaucoup postérieures
âu reste de l’édifice: mais cette opinion ne serait "pas fondée. En effet, tous les
petits jours qui éclairent les escaliers , les portes même qui entrent dans les
massifs, seroient tous dans le même cas : or il répugne à la raison de croire que
ces fenêtres, ces jours, ces portes, si utiles, si indispensables au dessein primitif
du monument, n’aient été imaginés qu’après coup, et exécutés à une époque
plus récente, au risque d’endommager une décoration si dispendieuse. D ’un autre
coté, Ion y reconnoît le même ciseau qu’ailleurs : les arêtes y sont aussi fines,
(1) Voyez p l. $ 2 , et l’explication de la planche: la puis clever une verticale par le .point de rencontre,
pente de ces massifs est à-peu-près de i pour 1 1 . On trouve que cette verticale passe à un demi-metre
(2) Voyez pl. jv . du listel, intervalle nécessaire pour la manoeuvre des
(3) Pour s’assurer de ce fait, il faut prendre, dans la mâts.
planche 5 1 , la hauteur du sommet de ces rainures, la (4) Une planche de bas-reliefs du vieux temple de
reporter sur une des aretes obliques dans ia planche Karnak fera connoître ces détails.
aussi pures ; lés faces des pierres coupées portent la même teinte de vétusté ;
enfin les bords des figures et des ornemens sont tranchés net : on ne saurait
douter que ces ouvertures ne soient du même temps et de la njême main que
tout le reste.
Mais comment expliquer l’état de ces figures de dieux fragmentées, état si
contraire aux idées que l’on a de l’esprit religieux des Égyptiens! Il n’y a, je crois,
qu’une manière de le concevoir : c’est d’imaginer des portes en bois ou en métal
que l’on ouvrait et fermoit à volonté. Ces portes étoient sans doute décorées et
sculptées de manière à faire suite aux parties voisines de la muraille , et il est
inutile d’ajouter qu’elles devoient être parfaitement raccordées'pour la vue; car on
connoît 1 adresse quont déployée par-tout les ouvriers Égyptiens. Personne ne
demandera ce que ces portes sont devenues dans un pays qui manque de bois et
de métaux ; je pencherais à croire qu’elles étoient plutôt de cette dernière ma-,
tiere : on sait avec quelle avidité lesfellâli et les Arabes ont soustrait les moindres
parcelles de métal dans les anciens monumens, témoin les pénibles démolitions
quils ont faites pour enlever les tênons qui lioient les pierres.
Je me suis arrête sur la description de ces fenêtres, parce qu’en général on sait
peu de chose sur la manière dont les anciens éclairaient leurs temples ; mais ces
jours masqués, s ouvrant ou se fermant au besoin, ne sont pas sans exemple dans
l’antiquité. II paraît que, dans les temples Grecs, la frise étoit quelquefois percée
d’ouvertures qui pouvoient remplir cet office. Dans le premier acte d'Iphigénie en
Tauride, on trouve ces paroles que Fylade adresse à Oreste, en lui montrant le
temple de Diane, dont ils.viennent enlever la statue : » Regarde ces triglyphes;
» il faut nous glisser à travers le vide qui s’y trouve. »
O g y . S t . y eiavo 'T & ty X v ipm , otcdi x.evov
AefAdç j&Oeîvctf.
Eurip. Iphig. in Taur. act. I , sc. 2 (1).
I Si l’on passe à l’examen des deux portiques, on voit qùe l’épais massif qui les
sépare, contenoit un vide ou couloir destiné à alléger la construction; des
pierres transversales formant bandeaux servoient à unir lés deux côtés de la
muraille. Ces couloirs sont communs dans les monumens d’Égypte; et quoique je
haie pu en découvrir dans les murs latéraux du grand portique , je ne doute
pas qu’il n’y en existe également. C ’est par une ouverture fort étroite que j’ai-
peijétré dans celui qu’on voit dans la gravure (2) : or des trous pareils peuvent
sétre bouchés ailleurs.
Je finirai ces remarques sur la construction du grand temple d’Edfoû, en faisant
observer la grande proportion des pierres des plafonds : celles de trois mètres
M M H guère probable que le poë.e entendit par-là diaire, que l ’intervalle entre deux ouverturer, comme on l’a
des on t formes par les canaux des triglyphes, espace trop Interprété : ce sens es. plus conforme à l’origine de la frise
h t u: t >,pT r:per trecst,-nr s" ° " B W S s L » » w U . w Ê
métooes Re ',KmK es mg yp ',e s’ c “ t-a-dtre,- des que les extrémités des solives appuyées sur la poutre prlnmetopes
Remarquons que le mot de métope, qui vient de cipale on architrave. P
et d ™ , peut signifier aussi-bien un trou intertné- (a) V. pl. fo , f ig . j , au point e e , et Jtg. 4 ; au point açr.
A . D . • r .