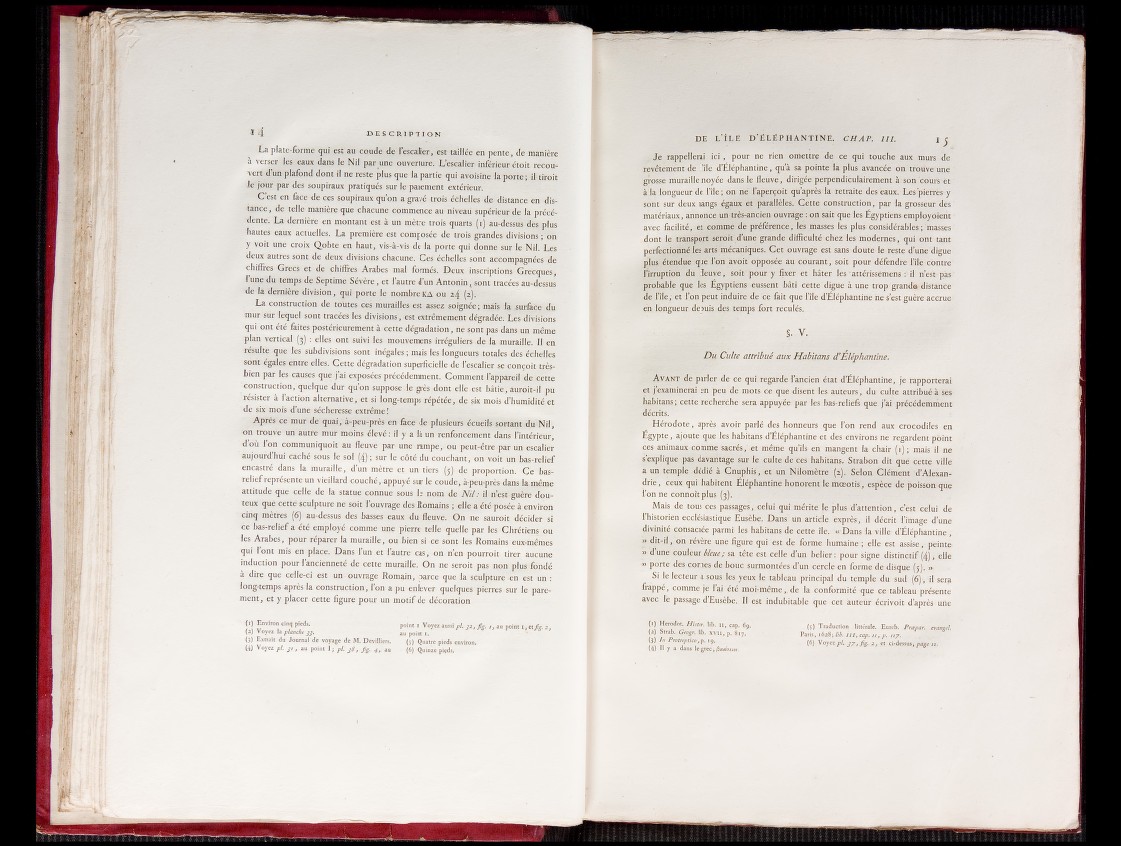
Laplate-fonne qui est au coude de l’escalier, est taillée en pente, de manière
à verser les eaux dans le Nil par une ouverture. L ’escalier inférieur étoit recouvert
d’un plafond dont il ne reste plus que la partie qui avoisine la porte ; il tiroit
le jour par des soupiraux pratiqués sur le parement extérieur.
C est en face de ces soupiraux quon a gravé trois échelles de distance en distance
, de telle manière que chacune commence au niveau supérieur de la précédente.
La dernière en montant est à un mètre trois quarts (i) au-dessus des plus
hautes eaux actuelles. La première est composée de trois grandes divisions ; on
y voit une croix Qobte en haut, vis-à-vis de la porte qui donne sur le Nil. Les
deux autres sont de deux divisions chacune. Ces échelles sont accompagnées de
chiffres Grecs et de chiffres Arabes mal formés. Deux inscriptions Grecques,
1 une du temps de Septime Sévère, et l’autre d’un AntoninS sont tracées au-dessus
de la dernière division, qui porte le nombre K A ou 2 4 (2 )-
La construction de toutes ces murailles est assez soignée; mais la surface du
mur sur lequel sont tracées les divisions, est extrêmement dégradée. Les divisions
qui ont été faites postérieurement à cette dégradation, ne sont pas dans un même
plan vertical (3) : elles ont suivi les mouvemens irréguliers de la muraille. Il en
■résulte que les subdivisions sont inégales ; mais les longueurs totales des échelles
sont égalés entie elles. Cette dégradation superficielle de l’escalier se conçoit très-
bien par les causes que j ai exposées précédemment. Comment l’appareil de cette
construction, quelque dur qu’on suppose.le grès dont elle est bâtie, auroit-il pu
résister à l’action alternative, et si long-temps répétée, de six mois d’humidité et
de six mois d’une sécheresse extrême!
Après ce mur de quai, à-peu-près en face de plusieurs écueils sortant du Nil,
on trouve un autre mur moins élevé : il y a là un renfoncement dans l’intérieur,
d’où l’on communiquoit au fleuve par une rampe, ou peut-être par un escalier
aujourdhui caché sous le sol (4) ; sur le côté du couchant, on voit un bas-relief
encastré dans la muraille, d’un mètre et un tiers (5) de proportion. Çe bas-
relief représente un vieillard couché, appuyé sur le coude, à-peu-près dans la même
attitude que celle de la statue connue sous le nom de N il ; il n’est guère douteux
que cette sculpture ne soit l’ouvrage des Romains ; elle a été posée à environ
cinq mètres (6) au-dessus des basses eaux du fleuve. On ne sauroit décider si
ce bas-relief a été employé comme une pierre telle quelle par les Chrétiens ou
les Arabes, pour reparer la muraille, ou bien si ce sont lés Romains eux-mêmes
qui 1 ont mis en place. Dans 1 un et l’autre cas, on n’en pourroit tirer aucune
induction pour l’ancienneté de cette muraille. On ne seroit pas non plus fondé
à dire que celle-ci est un ouvrage Romain, parce que la sculpture en est un :
long-temps après la construction, l’on a pu enlever quelques pierres sur le parement,
et y placer cette figure pour un motif de décoration
f i ) Environ cinq pieds.
(2) Voyez la planche 33.
(3) Extrait du Journal de voyage de M. Devilliers.
(4) Voyez pl. 3 1 , au point I ; p l. 3 8 , fig. 4 , au
point 1. Voyez aussi p l. 3 2 , fig.
au point 1.
(5) Quatre pieds environ.
(6) Quinze pieds.
, au point 1 > et fig. 1
Je rappellerai ic i , pour ne rien omettre de ce qui touche aux murs de
revêtement de l’île d’Éléphantine, qu’à sa pointe la plus avancée on trouve une
grosse muraille noyée dans le fleuve, dirigée perpendiculairement à son cours et
à la longueur de l’île; on né l’aperçoit qu’après la retraite des eaux. Les pierres y
sont sur deux rangs égaux et parallèles. Cette construction, par la grosseur des
matériaux, annonce un très-ancien ouvrage ; on sait que les Egyptiens employôient
avec facilité, et comme de préférence, les masses les plus considérables ; masses
dont le transport seroit d’une grande difficulté chez les modernes, qui ont tant
perfectionné les arts mécaniques. Cet ouvrage est sans doute le reste d’une digue
plus étendue que l’on àvoit opposée au courant, soit pour défendre l’île contre
l’irruption du fleuve, soit pour y fixer et hâter les attérissëmens : il n’est pas
probable que les Egyptiens èussent bâti cette digue à une trop grands distance
de l’île, et l’on peut induire de ce fait que l’île d’Éléphantine ne s’est guère accrue
en longueur depuis des temps fort reculés.
§. V.
D u Culte attribué aux Habitant d’Eléphantine.
Avant de parler de ce qui regarde l’ancien état d’Éléphantine, je rapporterai
et j’examinerai en peu de mots ce que disent les auteurs, du culte attribué à ses
habitans ; cette recherche sera appuyée par les bas-reliefs que j’ai précédemment
décrits.
Hérodote, après avoir parlé des honneurs que l’on rend aux crocodiles en
Egypte, ajoute que les habitans d’Éléphantine et des environs ne regardent point
ces animaux comme sacrés, .et même qu’ils en mangent la chair (i); mais il ne
s’explique pas davantage sur le culte de ces habitans. Strabon dit que cette ville
a un temple dedie à Cnuphis, et un Nilomètre (2). Selon Clément d’Alexandrie
, ceux qui habitent Éléphantine honorent le moeotis, espèce de poisson que
l’on ne connoît plus (3).
Mais de tous ces passages, celui qui mérite le plus d’attention, c’est celui de
1 historien ecclesiastique Eusebe. Dans un article exprès, il décrit l’image d’une
divinité consacrée parmi les habitans de cette île. « Dans la ville d’Éléphantine ,
» dit-il, on revere une figure qui est de forme humaine ; elle est assise, peinte
» dune couleur bleue; sa. tête est celle d’un belier: pour signe distinctif (4), elle
-» porte des cornes de bouc surmontées d’un cercle en forme de disque (5). »
Si le lecteur a sous les yeux le tableau principal du temple du sud (6), il sera
fiappe, comme je lai été moi-même,, de la conformité que ce tableau présente
avec le passage dEusèbe. Il est indubitable que cet auteur écrivoit d’après une
(I) Herodot. Histor. lîb. I l , cap. 69. ( ,) Traduction littérale. Euseb. Pr*p ar. evamet.
<-> itrab- G,0f - Iib- X V I I , p . 817. Paris, 16:18; lib. 1 1 1 , cap. u , p. , , 7 .
3 Jn Prctrep.ico p. ,9. {6) Voyez7,/. J 7 , f g . a , et ci-dessus, page ,0.
(4) y a dans le grec, fiaoÍAuov.