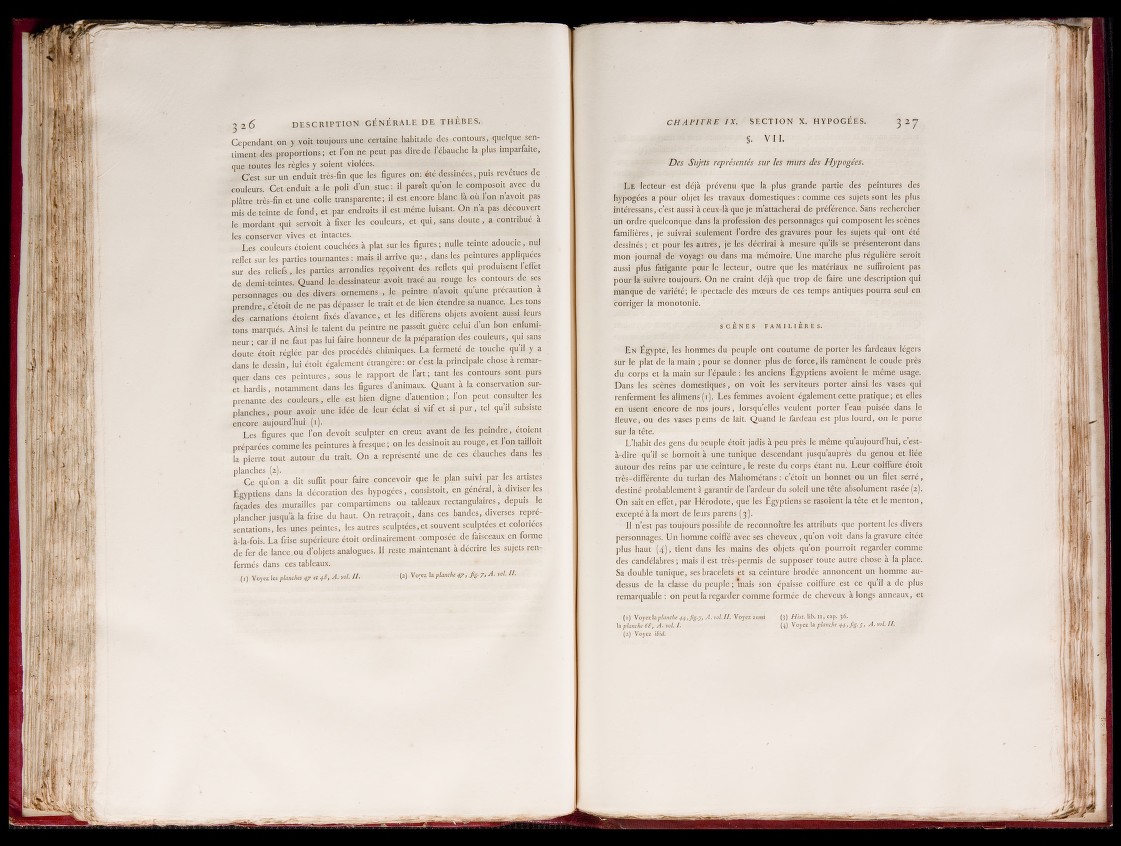
Cependant on y voit toujours une certaine habitude des contours, quelque sentiment
des proportions ; et l’on ne peut pas dire de l’ébauche la plus imparfaite,
que toutes les règles y soient violées.
C’est sur un enduit très-fin que les figures ont été dessinées, puis revêtues de
couleurs. Cet enduit a le poli d’un stuc: il paroît qu’on le composoit avec du
plâtre très-fin et une colle transparente; il est encore blanc là où l’on n’avoit pas
mis de teinte de fond, et par endroits il est même luisant. On n’a pas découvert
le mordant qui servoit à fixer les couleurs, et qui, sans doute, a contribue à
les conserver vives et intactes. ■■ ..“iSsi
Les couleurs étoient couchées à plat sur les figures ; nulle teinte adoucie, nul
reflet sur les parties tournantes : mais il arrive que, dans les peintures appliquées
sur des reliefs, les parties arrondies reçoivent des reflets qui produisent l’effet
de demi-teintes. Quand le.dessinateur avoit tracé au rouge les contours de ses
personnages ou des . divers ornemens , le peintre n’avoit qu’une précaution à
prendre, c’étoit de ne pas dépasser le trait et de bien étendre sa nuance. Les tons
des carnations étoient fixés d’avance, et les différens objets avoient aussi leurs
tons marqués. Ainsi le talent du peintre ne passoit guère celui d’un bon enlumineur
; car il ne faut pas lui faire honneur de la préparation des couleurs, qui sans
doute étoit réglée par des procédés chimiques. La fermeté de touche qu’il y a
dans le dessin, lui étoit également énangère : or c est la principale chose a remarquer
dans ces peintures, sous le rapport de l’art; tant les contours sont purs
et hardis, notamment dans les figures d’animaux. Quant à la conservation surprenante
des couleurs, elle est bien digne d’attention; l’on peut consulter les
planches, pour avoir une idée de leur éclat si v if et si pur, tel quil subsiste
encore aujourdhui (i). t m
Les figures que Ton devoit sculpter en creux avant de les peindre, etoient
préparées comme les peintures à fresque ; on les dessmoit au rouge, et l’on tailloit
la pierre tout autour du trait. On a représenté une de ces ébauches dans les
planches (2). . . . .
Ce qu’on a dit suffit pour faire concevoir que le plan s u i v i par les artistes
Égyptiens dans la décoration des hypogées, cqnsistoit, en général, à diviser les :
façades des murailles par compartimens ou tableaux rectangulaires, depuis le
plancher jusqu’à la frise du haut. On retraçoit, dans ces bandes, diverses représentations,
les unes peintes, les autres sculptées, et souvent sculptées et coloriées
à-la-fois. La frise supérieure étoit ordinairement composée de faisceaux en forme .
de fer de lance.ou d’objets analogues. Il reste maintenant à décrire les sujets renfermés
dans ces tableaux.
( ,) Voyez f a flanches & et 4 8 , A . ,o l . I I . U) Voyez U p la n c h 4 7 , fig -7 , A . vol. I I .
C H A P I T R E I X . S E C T I O N X . H Y P O G É E S .
§. V i l .
Des Sujets représentés sur les murs des Hypogées.
L e lecteur est déjà prévenu que la plus grande partie des peintures des
hypogées a pour objet les travaux domestiques : comme ces sujets sont les plus
intéressans, c’est aussi à ceux-là que je m’attacherai de préférence. Sans rechercher
un ordre quelconque dans la profession des personnages qui composent les scènes
familières, je suivrai seulement l’ordre des gravures pour les sujets qui ont été
dessinés; et pour les autres, je les décrirai à mesure qu’ils se présenteront dans
mon journal de voyage où dans ma mémoire. Une marche plus régulière seroit
aussi plus fatigante pour le lecteur, outre que les matériaux ne suffiroient pas
pour la suivre toujours. On ne craint déjà que trop de faire une description qui
manque de variété; le spectacle des moeurs de ces temps antiques pourra seul en
corriger la monotonie.
S C È N E S F A M I L I È R E S .
E n Égypte, les hommes du peuple ont coutume de porter les fardeaux légers
Sur le plat de la main ; pour se donner plus de force, ils ramènent le coude près
du corps et la main sur l’épaule ; les anciens Égyptiens avoient le même usage.
Dans les scènes domestiques, on voit les serviteurs porter ainsi les vases qui
renferment les alhnens (1). Les femmes avoient également cette pratique ; et elles
en usent encore de nos jours, lorsqu’elles veulent porter l’eau puisée dans le
fleuve, ou des vases pleins de lait. Quand le fardeau est plus lourd, on le porte
sur la tête.
L ’habit dès gens du peuple étoit jadis à peu près le même qu’aujourd’hui, c’est-
à-dire qu’il se bornoit à une tunique descendant jusqu’auprès du genou et liée
autour des reins par une ceinture, le reste du corps étant nu. Leur coiffure étoit
très-différente du turban des Mahométans : c’étoit un bonnet ou un filet serré,
destiné probablement à garantir de l’ardeur du soleil une tête absolument rasée (2).
On sait en effet, par Hérodote, que les Égyptiens se rasoient la tête et le menton,
excepté à la mort de leurs païens (3).
Il n’est pas toujours possible de reconnoître les attributs que portent les divers
personnages. Un homme coiffé avec ses cheveux , qu’on voit dans la gravure citée
plus haut (4), tient dans les mains des objets qu’on pourroit regarder comme
des candélabres ; mais il est très-permis de supposer toute autre chose à la place.
Sa double tunique, ses bracelets et sa ceinture brodée annoncent un homme au-
dessus de la classe du peuple ; mais son épaisse coiffure est ce qu’il a de plus
remarquable: on peut la regarder comme formée de cheveux à longs anneaux, et
(1) Voyez la planche A . vol. I I . Voyez aussi (3 ) Hist. Iib. I I , cap. 3 6.
la planche 68, A . vol. 1. (4) Voyez la plancjie * f4 ,f ig .;, A . vol. II .
(2) Voyez ibid.