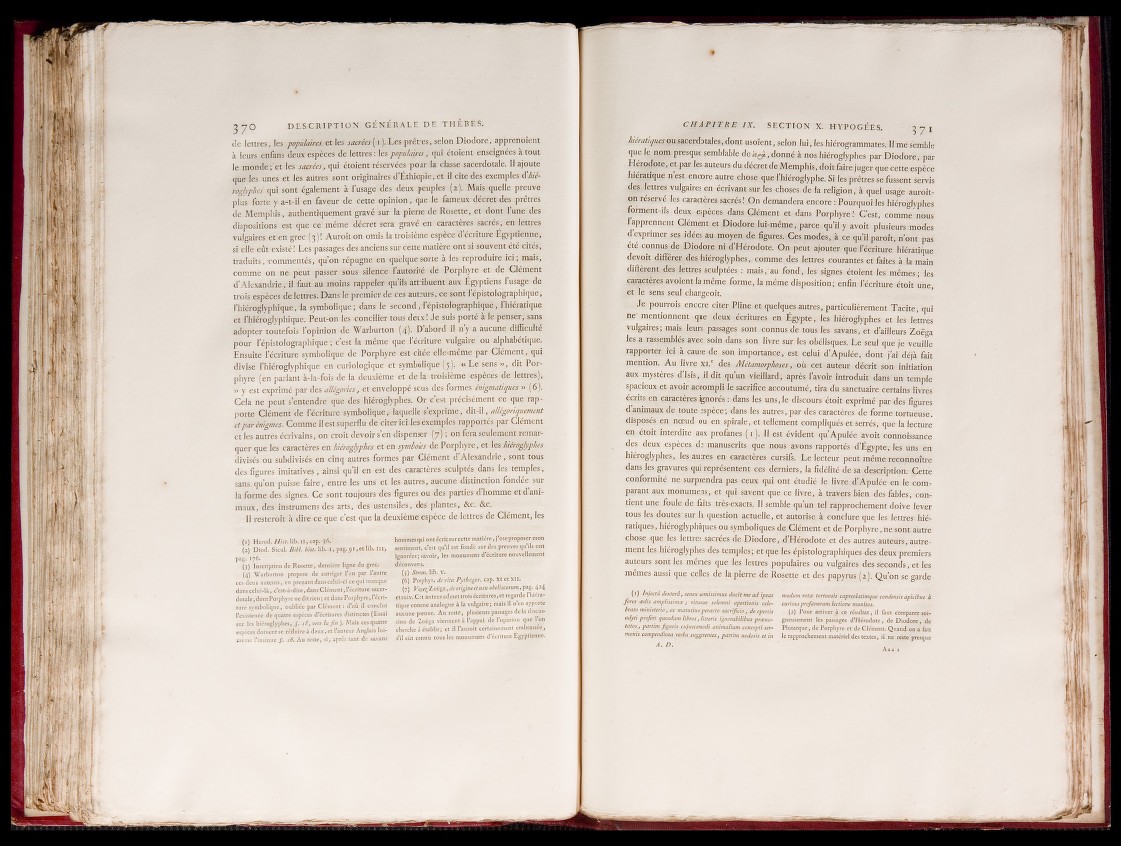
de lettres, les populaires et les sacrées ( i ). Les pretres, selon Diodore, appi enoient
à leurs enfans deux espèces de lettres: les populaires, qui étoient enseignées à tout
le monde ;'et les sacrées, qui étoient réservées pour la classe sacerdotale. Il ajoute
que les unes et les autres sont originaires d’Éthiopie, et il cite des exemples £ hiéroglyphes
qui sont également à l’usage des deux peuples (2). Mais quelle preuve
plus forte y a-t-il en faveur de cette opinion, que le fameux décret des prêtres
de Memphis, authentiquement gravé sur la pierre de Rosette, et dont 1 une des
dispositions est que ce même décret sera gravé en caractères sacrés, en lettres
vulgaires et en grec (3)1 Auroit-on omis la troisième espece d écriture Égyptienne,
si elle eût existé! Les passages des anciens sur cette matière ont si souvent été cités,
traduits, 'commentés, qu’on répugne en quelque sorte a les reproduire ici, mais,
comme on ne- peut passer sous silence 1 autorité de Porphyre et de Clement
d’Alexandrie, il faut au moins rappeler qu’ils attribuent aux Égyptiens l’usage de
trois espèces de lettres. Dans le premier de ces auteurs, ce sont lepistolographique,
l’hiéroglyphique, la symbolique; dans le second, lepistolographique, l’hiératique
et l’hiéroglyphique. Peut-on les -concilier tous deux! Je suis porte a le penser, sans
adopter toutefois l’opinion de Warburton (4). D’abord il n’y a aucune difficulté
pour l’épistolographique ; c’est la même que l’écriture vulgaire ou alphabétique.
Ensuite l’écriture symbolique de Porphyre est citee elle-meriie par Clement, qui
divise l’hiéroglyphique en curiologique et symbolique (y). « L e sens», dit Pôi-
phyre (en parlant à-la-fois de la deuxième et de la troisième especes de lettres],
» y est exprimé par des allégories, et enveloppe sous des formes énigmatiques » (6).
Cela ne peut s’entendre que des hiéroglyphes. Or cest précisément ce que rapporte
Clément de l’écriture symbolique,- laquelle s’exprime, dit-il, allégoriquement
et par énigmes. Comme il est superflu de citer ici les exemples rapportés par Clément
et les autres écrivains, on croit devoir s en dispenser (7) > on fera seulement remarquer
que les caractères en hiéroglyphes et en symboles de Porphyre, et les hiéroglyphes
divisés ou subdivisés en cinq autres formes par Clement d Alexandrie , sont tous
des figures imitatives, ainsi qu’il en est des caractères sculptes dans les temples,
sans.qu’on puisse faire, entre les uns et les autres, aucune distinction fondée sur
la forme des signes. Ce sont toujours des figures ou des parties d homme et d animaux,
des instrumens des arts, des ustensiles, des plantes, &c. &c.
11 resteroit à dire ce que c’est que la deuxième espèce de lettres de Clément, les
hommes qui ont écrit sur cette matière, j’ose proposer mon
sentiment, c’est qu’ il est fondé sur des preuves qu’ils ont
ignorées; savoir, les monumens d’écriture nouvellement
découverts.
(5) Strom. Iib. Y.
(6) Porphyr. de vita Pythagor. cap. X I et X I I .
(7) V°y*l Zoëga, de origine et usu obeliscorum, pag. 424
etsuiv. Cet auteuradmet trois écritures, et regarde l’hiératique
comme analogue à la vulgaire; mais il n’en apporte
aucune preuve. Au reste, plusieurs passages de la discussion
de Zoëga viennent à l’appui de l’opinion que 1 on
cherche à établir; et il l’auroit certainement embrassee^
s’il eût connu tous les monumens d’écriture Égyptienne.
( 1 ) Herod. Hist. Iib. I I , cap. 3 6 .
(2) Diod. Sicul. Bibl. hist. Iib. 1 , pag. 9 1 , et Iib. i i îy
pag. 176.
(3) Inscription de Rosette, dernière ligne du grec.
(4) "Warburton propose de corriger l’un par l’autre
ces deux auteurs, en prenant dans celui-ci ce qui manque
dans celui-là, c’est-à-dire, dans Clément, l’écriture sacerdotale
¿dont Porphyre ne dit rien; et dans Porphyre,! écriture
symbolique, oubliée par Clément : d’où il conclut
l’existence de quatre espèces d’écritures distinctes (Essai
sur les hiéroglyphes, j\ 18 , vers la fin ). Mais ces quatre
espèces doivent se réduire à deux, et l’auteur Anglais lui-
même l’insinue j\ 16. Au reste, si, après tant de savans
hiératiques ou sacerdotales, dont usoient, selon lui, les hiérogrammates. Il me semble
que le nom presque semblable de kgj., donné à nos hiéroglyphes par Diodore, par
Hérodote, et par les auteurs du décret de Memphis, doit faire juger que cette espèce
hiératique n est encore autre chose que l’hiéroglyphe. Si les prêtres se fussent servis
des lettres vulgaires en écrivant sur les choses de la religion, à quel usage auroit-
on réservé les caractères sacrés! On demandera encore : Pourquoi les hiéroglyphes
forment-ils deux espèces dans Clément et dans Porphyre! C’est, comme nous
1 apprennent Clément et Diodore lui-même, parce qu’il y avoit plusieurs modes
d’exprimer ses idées au moyen de figures. Ces modes, à ce qu’il paroît, n’ont pas
été connus de Diodore ni d’Hérodote. On peut ajouter que l’écriture hiératique
devoit différer des hiéroglyphes, comme des lettres courantes et faites à la main
différent des lettres sculptées : mais, au fond, les signes étoient les mêmes; les
caractères avoient la même forme, la même disposition; enfin l’écriture étoit une,
et le sens seul changeoit.
Je pourvois encore citer Pline et quelques autres, particulièrement Tacite, qui
ne' mentionnent que deux écritures en Egypte, les hiéroglyphes et les lettres
vulgaires; mais leurs passages sont connus de tous les savans, et d’ailleurs Zoëga
les a rassemblés avec soin dans son livre sur les obélisques. Le seul que je veuille
rapporter ici à cause de son importance, est celui d’Apulée, dont j’ai déjà fait
mention. Au livre xi.e des Métamorphoses, où cet auteur décrit son initiation
aux mystères dlsis, il dit qu’un vieillard, après l’avoir introduit dans un temple
spacieux et avoir accompli le sacrifice accoutumé, tira du sanctuaire certains livres
écrits en caractères ignores : dans les uns, le discours étoit exprimé par des figures
danimaux de toute espèce; dans les autres, par des caractères de forme tortueuse,
disposés en noeud ou en spirale, et tellement compliqués et serrés, que la lecture
en étoit interdite aux profanes ( 1 ). Il est évident qu’Apulée avoit connoissance
des deux espèces de manuscrits que nous avons rapportés d’Égypte, les uns en
hiéroglyphes, les autres en caractères cursifs. Le lecteur peut même reconnoître
dans les gravures qui représentent ces derniers, la fidélité de sa description. Cette
conformité ne surprendra pas ceux qui ont étudié le livre d’Apulée en le comparant
aux monumens, et qui savent que ce livre, à travers bien des fables, contient
une foule de faits tres-exacts. Il semble qu’un tel rapprochement doive lever
tous les doutes sur la question actuelle, et autorise à conclure que les lettres hiératiques,
hiéroglyphiques ou symboliques de Clément et de Porphyre, ne sont autre
chose que les lettres sacrées de Diodore, d’Hérodote et des autres auteurs, autrement
les hiéroglyphes des temples; et que les épistolographiques des deux premiers
auteurs sont les memes que les lettres populaires ou vulgaires des seconds, et les
memes aussi que celles de la pierre de Rosette et des papyrus (2). Qu’on se garde
( 1 ) Injecté ¿extern, senex comissimus ducit me ad ipsas modum roue tortuosis caprcolatimquc conduisis apicibus à
fores oedis amplissimoe rituque solemni apertionis cele- curiosa profanorum lectione munitos.
brato ministerio, ac matutino peracto sacrficio, de opertis (2) Pour arriver à ce résultât, il faut comparer soi-
adyti profert quosdarn libros, litteris ignorabilibus præno- gneusement les passages d’Hérodote, de Diodore, de
tatos, partim figuris cujuscemodi animalium concepti ser- Plutarque, de Porphyre et de Clément. Quand on à fait
monis compendiosa verba suggerentes, partim nodosis et in le rapprochement matériel des textes, il ne reste presque
A . D .
A a a 2