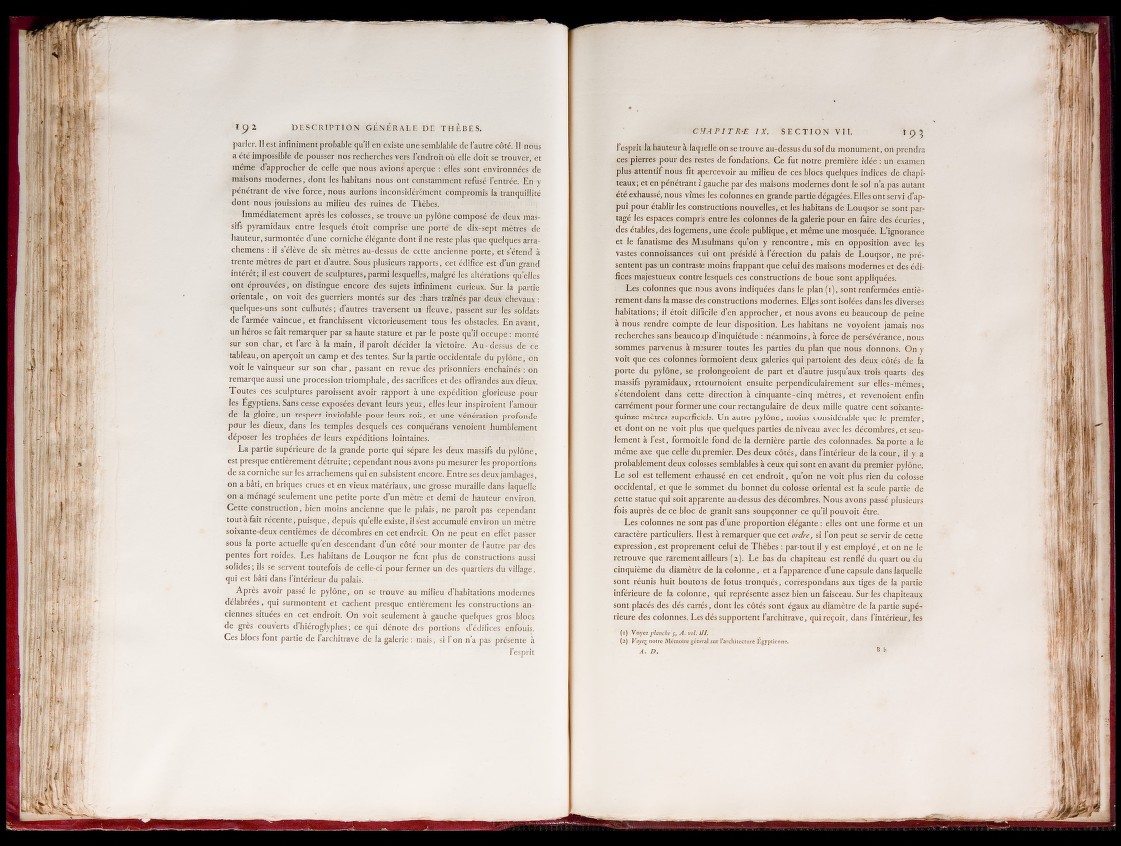
parler. H est infiniment probable qu’il en existe une semblable de l’autre côté. Il nous
a été impossible de pousser nos recherches vers l’endroit où elle doit se trouver, et
même d’approcher de celle que nous avions aperçue : elles sont environnées de
maisons modernes, dont les habitans nous ont constamment refusé l’entrée. En y
pénétrant de vive force, nous aurions inconsidérément compromis la tranquillité
dont nous jouissions au milieu des ruines de Thèbes.
Immédiatement après les colosses, se trouve un pylône composé de deux massifs
pyramidaux entre lesquels étoit comprise une porte de dix-sept mètres de
hauteur, surmontée d’une corniche élégante dont il ne reste plus que quelques arra-
chemens : il s’élève de six mètres au-dessus de cette ancienne porte, et s’étend à
trente mètres de part et d’autre. Sous plusieurs rapports, cet édifice est d’un grand
intérêt; il est couvert de sculptures,parmi lesquelles,malgré les altérations qu’elles
ont éprouvées, on distingue encore des sujets infiniment curieux. Sur la partie
orientale, on voit des guerriers montés sur des chars tramés par deux chevaux ;
quelques-uns sont culbutés; d’autres traversent un fleuve, passent sur les soldats
de l’armée vaincue, et franchissent victorieusement tous les obstacles. En avant,
un héros se fait remarquer par sa haute stature et par le poste qu’il occupe : monté
sur son char, et l’arc à la main, il paroît décider la victoire. Au - dessus de ce
tableau, on aperçoit un camp et des tentes. Sur la partie occidentale du pylône, 011
voit le vainqueur sur son char, passant en revue des prisonniers enchaînés : on
remarque aussi une procession triomphale, des sacrifices et des offrandes aux dieux.
Toutes ces sculptures paroissent avoir rapport à une expédition glorieuse pour
les Egyptiens. Sans cesse exposées devant leurs yeux, elles leur inspiroient l’amour
de la gloire, un respect inviolable pour leurs rois, et une vénération profonde
pour les dieux, dans les temples desquels ces conquérans venoient humblement
déposer les trophées de" leurs expéditions lointaines.
L a partie supérieure de la grande porte qui sépare les deux massifs du pylône,
est presque entièrement détruite ; cependant nous avons pu mesurer les proportions
de sa corniche sur les arrachemens qui en subsistent encore. Entre ses deux jambages,
on a bâti, en briques crues et en vieux matériaux, une grosse muraille dans laquelle
on a ménagé seulement une petite porte d’un mètre et demi de hauteur environ.
Cette construction, bien moins ancienne que le palais, ne paroît pas cependant
tout-a-fait recente, puisque, depuis qu’elle existe, il s’est accumulé environ un mètre
soixante-deux centièmes de décombres en cet endroit. On ne peut en effet passer
sous la porte actuelle qu’en descendant d’un côté pour monter de l’autre par des
pentes fort roides. Les habitans de Louqsor ne font plus de constructions aussi
solides; ils se servent toutefois de celle-ci pour fermer un des quartiers du village,
qui est bâti dans l’intérieur du palais.
Apres avoir passé le pylône, on se trouve au milieu d’habitations modernes
delabrees, qui surmontent et cachent presque entièrement les constructions anciennes
situées en cet endroit. On voit seulement à gauche quelques gros blocs
de gres couverts dhiéroglyphes; ce qui dénote des portions d’édifices enfouis.
Ces blocs font partie de 1 architrave de la galerie : mais, si l'on n’a pas présente à
1 esprit la hauteur à laquelle on se trouve au-dessus du sol du monument, on prendra
ces pierres pour des restes de fondations. Ce fut notre première idée : un examen
plus attentif nous fit apercevoir au milieu de ces blocs quelques indices de chapiteaux;
et en pénétrant à gauche par des maisons modernes dont le sol n’a pas autant
ete exhausse, nous vîmes les colonnes en grande partie dégagées. Elles ont servi d’appui
pour établir les constructions nouvelles, et les habitans de Louqsor se sont partagé
les espaces compris entre les colonnes de la galerie pour en faire des écuries,
des étables, des logemens, une école publique, et même une mosquée. L ’ignorance
et le fanatisme des Musulmans qu’on y rencontre, mis en opposition avec les
vastes connoissances qui ont présidé à l’érection du palais de Louqsor, ne présentent
pas un contraste moins frappant que celui des maisons modernes et des édifices
majestueux contre lesquels ces constructions de boue sont appliquées.
Les colonnes que nous avons indiquées dans le plan (1), sont renfermées entièrement
dans la masse des constructions modernes. Elles sont isolées dans les diverses
habitations; il étoit difficile d’en approcher, et nous avons eu beaucoup de peine
à nous rendre compte de leur disposition. Les habitans ne voyoient jamais nos
recherches sans beaucoup d’inquiétude ; néanmoins, à force de persévérance, nous
sommes parvenus à mesurer toutes les parties du plan que nous donnons. On y
voit que ces colonnes formoient deux galeries qui partoient des deux côtés de la
porte du pylône, se prolongeoient de part et d’autre jusqu’aux trois quarts des
massifs pyramidaux, retournoient ensuite perpendiculairement sur elles-mêmes;
s’étendoient dans cette direction à cinquante-cinq mètres, et revenoient enfin
carrément pour former une cour rectangulaire de deux mille quatre cent soixante-
quinze mètres superficiels. Un autre pylône, moins considérable que le premier,
et dont on ne voit plus que quelques parties de.niveau avec les décombres, et seulement
à 1 est, formoit le fond de la dernière partie des colonnades. Sa porte a le
même axe que celle du premier. Des deux côtés, dans l’intérieur de la cour, il y a
probablement deux colosses semblables à ceux qui sont en avant du premier pylône.
Le sol est tellement exhaussé en cet endroit, qu’on ne voit plus rien du colosse
occidental/et que le sommet du bonnet du colosse oriental est la seule partie de
.cette statue qui soit apparente au-dessus des décombres. Nous avons passé plusieurs
fois auprès de ce bloc de granit sans soupçonner ce qu’il pouvoit être.
Les colonnes ne sont pas d’une proportion élégante : elles ont une forme et un
caractère particuliers. Il est à remarquer que cet ordre, si l’on peut se servir de cette
expression, est proprement celui de Thèbes : par-tout il y est employé, et on ne le
retrouve que .rarement ailleurs (2). Le bas du chapiteau est renflé du quart ou du
cinquième du diamètre de la colonne, et a l’apparence d’une capsule dans laquelle
sont réunis huit boutons de lotus tronqués, correspondans aux tiges de la partie
inférieure de la colonne, qui représente assez bien un faisceau. Sur les chapiteaux
sont placés des dés carrés, dont les côtés sont égaux au diamètre de la partie supérieure
des colonnes. Les dés supportent l’architrave, qui reçoit, dans l’intérieur, les
(1) Voyez planche ' A . vol. I I I .
(2) Voye^ notre Mémoire général sur l’architecture Egyptienne.
A . D . B !•