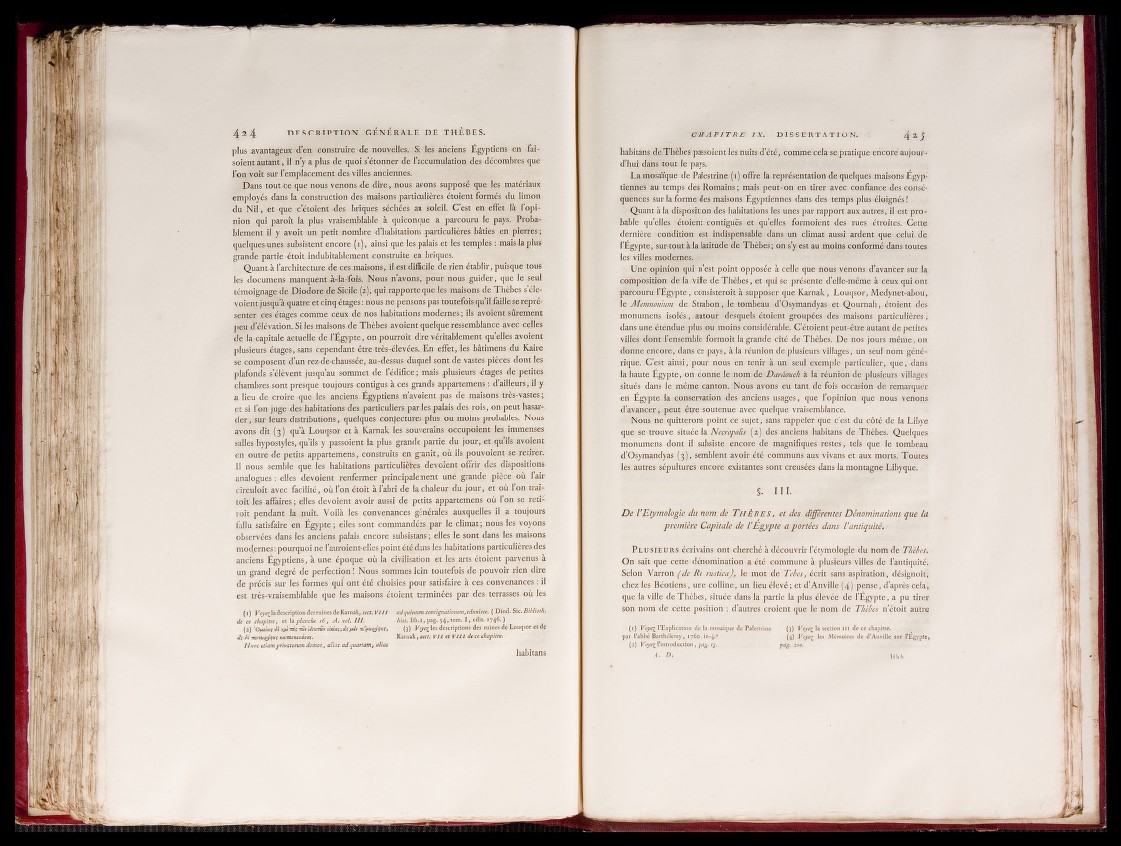
plus avantageux d’en construire de nouvelles. Si les anciens Égyptiens en Fai-
soient autant, il n’y a plus de quoi s’étonner de l’accumulation des décombres que
l’on voit sur l’emplacement des villes anciennes.
Dans tout-ce que nous venons de dire, nous avons supposé que les matériaux
employés dans la construction des maisons particulières étoient formés du limon
du Nil, et que -cetôient-des briques séchées au soleil. C’est en effet là l’opinion
qui paroît la plus vraisemblable à quiconque a parcouru le pays. Probablement
il y avoit un petit nombre d’habitations particulières bâties en pierres ;
quelques-unes subsistent encore (r)., ainsi que les palais et les temples : mais-laplus
grande partie étoit indubitablement construite en briques.
Quant a l’architecture de ces maisons, il est difficile de rien établir, puisque tous
les documens manquent à-la-fois. Nous n’avons, pour nous guider, que le seul
témoignage de Diodore de Sicile (2), qui rapporte que les maisons de Thèbes s’éle-
voient jusqu’à quatre et cinq étages : nous ne pensons pas toutefois qu’il faille se représenter
ces étages comme ceux de nos habitations modernes ; ils avoient sûrement
peu d’élévation. Si les maisons de Thèbes avoient quelque ressemblance avec celles
de la-capitale actuelle de l’Égypte, on pourroit dire véritablement qu’elles avoient
plusieurs étages, sans cependant être très-élevées. En effet, les bâtimens du Kaire
se composent d’un rez-de-chaussée, au-dessus duquel sont de vastes pièces dont les
plafonds s’élèvent jusqu’au sommet de l’édifice ; mais plusieurs étages de petites
chambres sont presque toujours contigus à ces grands appartemens : d’ailleurs, il y
a lieu de croire que les anciens Égyptiens n’avoient pas de maisons très-vastes;
et si l’on juge des habitations des particuliers par les palais des rois, on peut hasarder
, sur leurs distributions, quelques conjectures plus ou moins probables. Nous
avons dit (3) qu’à Louqsor et à Kamak les souverains occupoient les immenses
salles hypostyles, qu’ils y passoient la plus grande partie du jour, et quils avoient
en outre de petits appartemens, construits en granit, où ils pouvoient se retirer.
11 nous semble que les habitations particulièies dévoient offrir des dispositions
analogues : elles devoient renfermer principalement uné grande pièce ou 1 air
circuloit avec facilité, où l’on étoit à l’abri de la chaleur du jour, et où 1 on trai-
toit les affaires ; elles devoient avoir aussi de petits appartemens ou 1 on se reti-
roit pendant la nuit. Voilà les convenances générales auxquelles il a toujours
fallu satisfaire en Égypte ; elles sont commandées par le climat ; nous les voyons
observées dans les anciens palais encore subsistans ; elles le sont dans les maisons
modernes : pourquoi ne l’auroient-elles point été dans les habitations particulières des
anciens Égyptiens/à une époque où la civilisation et les arts étoient parvenus à
un grand degré de perfection ! Nous sommes loin toutefois de pouvoir rien dire
de précis sur les formes qui ont été choisies pour satisfaire à ces convenances : il
est très-vraisemblable que les maisons étoient terminées par des terrasses où les
(1) Voye^ la description des ruines de Karnak, sect. V I I I adquintamcontignationem,eduxisse. ( Dïod. Sic .Biblioth.
de ce chapitre, et la planche 16, A . vol. I I I . Awf. lib. I , pag. 54, tom. I , edit. 1746. )
(2) 'Opelue JtwTdlTWiSitfnh oiviaijâiyii WlfuçÿqvÇ) (3) Voye^les descriptions des ruines de Louqsor et dç
ai •7 rvn t iç y v t ç x/L’n te x tu éa ttf. Karnak, s e c t . V I I e t V I I I d e c e e h a p it r s .
Hune etiamvrivatorum domos,, alias ad quartam, alias
habitans
habitans de Thèbes passoient les nuits d’été, comme cela se pratique encore aujourd’hui
dans tout le pays.
La mosaïque de Palestrine ( i ) offre la représentation de quelques maisons Égyptiennes
au temps des Romains ; mais peut-on en tirer avec confiance des conséquences
sur la forme des maisons Égyptiennes dans des temps plus éloignés !
Quant à la disposition des habitations les unes par rapport aux autres, il est probable
qu’elles étoient contiguës et qu’elles formoient des rues étroites. Cette
dernière condition est indispensable dans un climat aussi ardent que celui de
l’Égypte, sur-tout à la latitude de Thèbes; on s’y est au moins conformé dans toutes
les villes modernes.
Une opinion qui n est point opposée a celle que nous Venons d avancer sur la
composition de la ville de Thèbes, et qui se présente d’elle-même à ceux qui ont
parcouru l’Égypte , consisteroit à supposer que Karnak, Louqsor, Medynet-abou,
le Memnoniitm de Strabon, le tombeau d’Osymandyas et Qournah, étoient des
monumens isolés, autour desquels étoient groupées des maisons particulières ;
dans une étendue plus ou moins considérable. C’étoient peut-être autant de petites
villes dont l’ensemble formoit la grande cité de Thèbes. De nos jours même, on
donne encore, dans ce pays, à la réunion de plusieurs villages, un seul nom générique.
C’est ainsi, pour nous en tenir à un seul exemple particulier, que, dans
la haute Égypte, on donne le nom de Darâoueli à la réunion de plusieurs villages
situés dans le même canton. Nous avons eu tant de fois occasion de remarquer
en Égypte la conservation des anciens usages, que l’opinion que nous venons
d’avancer, peut être soutenue avec quelque vraisemblance.
Nous ne quitterons point ce sujet, sans rappeler que c’est du côté de la Libye
que se trouve située la Necropolis (2) des anciens habitans de Thèbes. Quelques
monumens dont il subsiste encore de magnifiques restes, tels que le tombeau
d’Osymandyas (3), semblent avoir été communs aux vivans et aux morts. Toutes
les autres sépultures encore existantes sont creusées dans la montagne Libyque.
§. I I I .
D e l'Etymologie du nom de T h è b e s , et des différentes Dénominations que la
première Capitale de l ’Egypte a portées dans l ’antiquité, ■
P l u s i e u r s écrivains ont cherché à découvrir l’étymologie -du nom de Thèbes,
On sait que cette dénomination a été commune à plusieurs villes de l’antiquité,
Selon Varron (de Re rusùca), le mot de Tebes, écrit sans aspiration, désignoit,-
chez les Béotiens, une colline, un lieu élevé; etd’Anville (4 ) pense, d’après cela,
que la ville de Thèbes, située dans la partie la plus élevée de l’Égypte, a pu tirer
son nom de cette position : d’autres croient que le nom de Thèbes n’étoit autre
(1) Voye^ l’Explication de la mosaïque de Palestrine ( 3 ) Voyt1 la section I I I de ce chapitre.
par l’abbé Barthélémy, 1760, in-4.0 (4) Voye^ les Mémoires de d’Anville sur l’Egypte,
(2) Voye^ l’introduction, pag, ry. pag. 200,
A- D‘ H h h