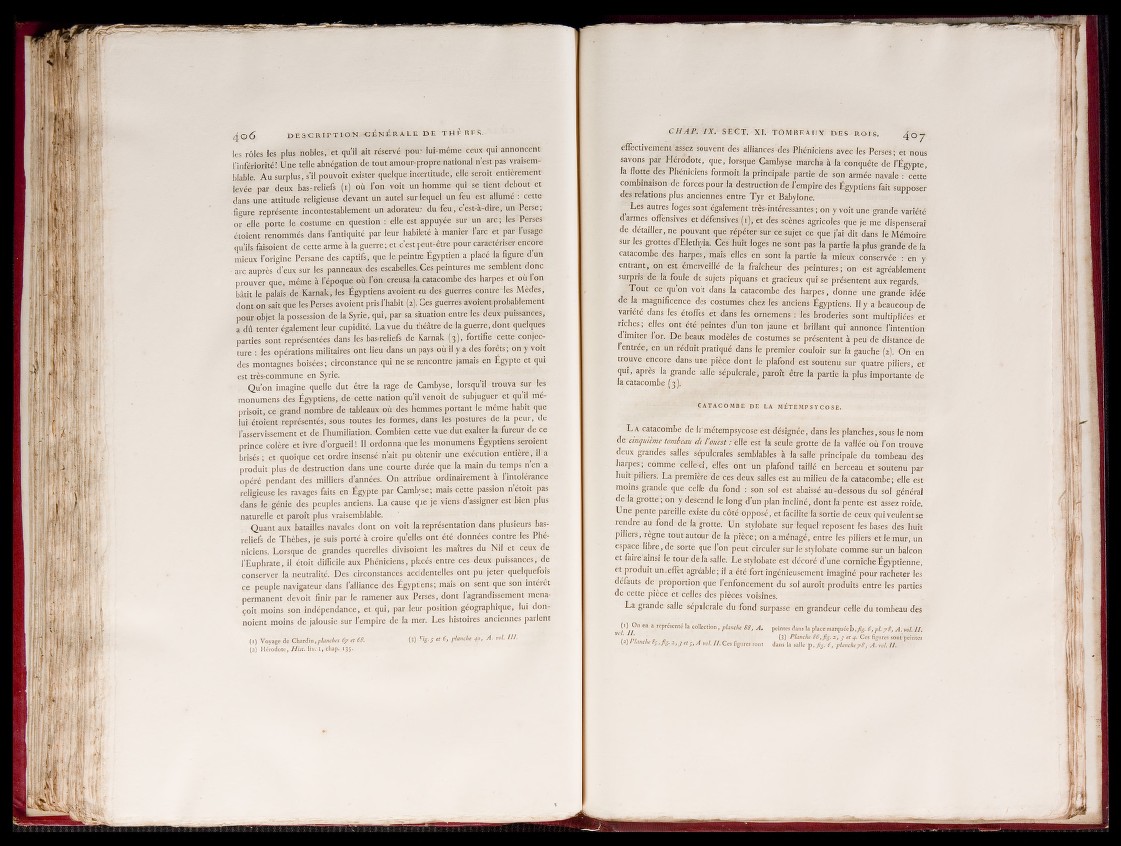
les rôles les plus nobles, et qu’il ait réservé pour lui-même ceux qui annoncent
l’infériorité! Une telle abnégation de tout amour-propre national n’est pas vraisemblable.
Au surplus, s’il pouvoit exister quelque incertitude, elle seroit entièrement
levée par deux bas-reliefs (i) où l’on voit un homme qui se tient debout et
dans une attitude religieuse devant un autel sur lequel un feu est allumé : cette
figure représente incontestablement un adorateur du feu, cest-à-dire, un Perse;
or elle porte le costume en question : elle est appuyée sur un arc ; les Perses
ctoient renommés dans l’antiquité par leur habileté à manier lare et par 1 usage
qu’ils faisoient de cette arme à la guerre; et c’est peut-être pour caractériser encore
mieux l’origine Persane des captifs, que le peintre Égyptien a placé la figure d’un
■ arc auprès d’eux sur les panneaux des escabelles. Ces peintures me semblent donc
prouver que, même à l’époque où l’on creusa la catacombe des harpes et où l’on
bâtit le palais de Karnak, les Égyptiens avoient eu des guerres contre les Mèdes,
dont on sait que les Perses avoient pris l’habit (2). Ces guerres avoient probablement
pour objet la possession de la Syrie, qui, par sa situation entre les deux puissances,
a dû tenter également leur cupidité. La vue du théâtre de la guerre, dont quelques
parties sont représentées dans les bas-reliefs de Karnak (3), fortifie cette conjecture
: les opérations militaires ont lieu dans un pays où il y a des forêts; on y voit
des montagnes boisées ; circonstance qui ne se rencontre jamais en Égypte et qui
est très-commune en Syrie.
Qu’on imagine quelle dut être la rage de Cambyse, lorsqu’il trouva Sur les
monumens des Égyptiens, de cette nation qu’il venoit de subjuguer et qu il mé-
prisoit, ce grand nombre de tableaux où des hommes portant le même habit que
lui étoient représentés, sous toutes les formes, dans les postures de la peur, de
l’asservissement et de l’humiliation. Combien cette vue dut exalter la fureur de ce
prince colère et ivre d’orgueil ! Il ordonna que les monumens Égyptiens seroient
brisés ; et quoique cet ordre insensé n’ait pu obtenir une exécution entière , il a
produit plus de destruction dans une courte durée que la main du temps n en a
opéré pendant des milliers d’années. On attribue ordinairement à l’intolérance
religieuse les ravages faits en Égypte par Cambyse; mais cette passion nétoit pas
dans le génie des peuples anciens. La cause que je viens d assigner est bien plus
naturelle et paroît plus vraisemblable.
Quant aux batailles navales dont on voit la représentation dans plusieurs bas-
reliefs de Thèbes, je suis porté à croire qu’elles ont ete données contre les Phéniciens.
Lorsque de grandes querelles divisoient les maîtres du Nil et ceux de
J’Euphrate, il étoit difficile aux Phéniciens, placés entre ces deux puissances, de
conserver la neutralisé. Des circonstances accidentelles ont pu jeter quelquefois
ce peuple navigateur dans l’alliance des Égyptiens; mais on sent que son intérêt
permanent devoit finir par le ramener aux Perses, dont 1 agrandissement mena-
' çoit moins son indépendance, et qui, par leur position géographique, lui don-
noient moins de jalousie sur l’empire de la mer. Les histoires anciennes parlent
(,) Voyage de Chardin,plancha f y et 68. (3) Fig.; et 6, planche +o, A. vol. ¡ I I .
(a) Hérodote, Hist. liv. I, chap. 135-
effectivement assez souvent des alliances des Phéniciens avec les Perses ; et nous
savons pai- Hérodote, que, lorsque Cambyse marcha à la conquête de i’Égypte,
la flotte des Phéniciens formoit la principale partie de son armée navale : cette
combinaison de forces pour la destruction de l’empire des Égyptiens fait supposer
des relations plus anciennes entre Tyr et Babylone.
^ Les autres loges sont également très-intéressantes ; on y voit une grande variété
d’armes offensives et défensives (t), et des scènes agricoles que je me dispenserai
de détailler, ne pouvant que répéter sur ce sujet ce que j’ai dit dans le Mémoire
sur les giottes d’Elethyia. Ces huit loges ne sont pas la partie la plus grande de la
catacombe des harpes, mais elles en sont la partie la mieux conservée : en y
entrant, on est émerveillé de la fraîcheur des peintures; on est agréablement
surpris de la foule de sujets piquans et gracieux qui se présentent aux regards.
Tout ce qu’on voit dans la catacombe des harpes, donne une grande idée
de la magnificence des costumes chez les anciens Égyptiens. Il y a beaucoup de
variété dans les étoffes et dans les ornemens : les broderies sont multipliées et
riches; elles ont été peintes d’un ton jaune et brillant qui annonce l’intention
d imiter l’or. De beaux modèles de costumes se présentent à peu de distance de
1 entrée, en un réduit pratiqué dans le premier couloir sur la gauche (2). On en
trouve encore dans une pièce dont le plafond est soutenu sur quatre piliers, et
qui, après la grande salle sépulcrale, paroît être la partie la plus importante de
la catacombe (3).
c a t a c o m b e d e l a m é t e m p s y c o s e .
L a catacombe de la'métempsycose est désignée, dans les planches, sous le nom
de cinquième tombeau de l'ouest : elle est la seule grotte de la vallée où l’on trouve
deux grandes salles sépulcrales semblables à la salle principale du tombeau des
harpes; comme celle-ci, elles ont un plafond taillé en berceau et soutenu par
huit piliers. La premiere de ces deux salles est au milieu de la catacombe ; elle est
moins grande que celle du fond : son sol est abaissé au-dessous du sol général
de la grotte ; on y descend le long d’un plan incliné, dont la pente est assez roide.
Une pente pareille existe du côté opposé, et facilite la sortie de ceux qui veulent se
rendre au fond de la grotte. Un stylobate sur lequel reposent les bases des huit
piliers, règne tout autour de la pièce; on aménagé, entre les piliers et le mur, un
espace libre, de sorte que l’on peut circuler sur le stylobate comme sur un balcon
et faire ainsi le tour de la salle. Le stylobate est décoré d’une corniche Égyptienne,
et produit un.effet agréable ; il a été fort ingénieusement hnaginé pour racheter les
défauts de proportion que l’enfoncement du sol auroît produits entre les parties
de cette pièce et celles des pièces voisines.
La grande salle sépulcrale du fond surpasse en grandeur celle du tombeau des
J O O . a rcPr&cnté R collection, planche 88, A . peintes dans la place m arq u é eb .Jÿ . 6 ,pl. 7 S, A . vol. I I .
/ . p . . _ _ (3) Planche 86, f i g. z , j et 4. Ces figures sont peintes
[2.) / lanche e ;,f ig . A , vol. I I . Ces figures sont dans la salle p ,fig . 6 , planche7 8 . A . vol. IL