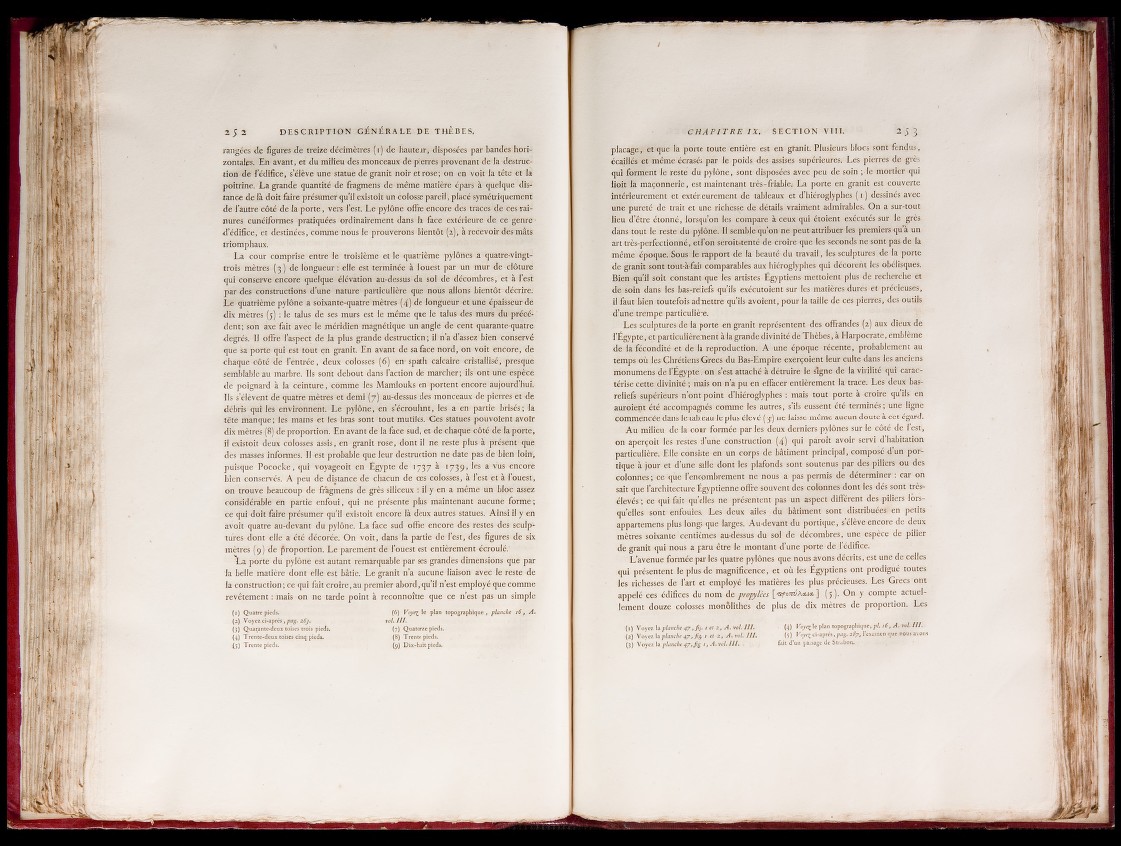
D E S C R I P T I O N G É N É R A L E D E T B È B E 5 ,
rangées de figures de treize décimètres (i) de hauteur, disposées par bandes horizontales.
En avant, et du milieu des monceaux de pierres provenant de la destruction
de l’édifice, s’élève une statue de granit noir et rose; on en voit la tête et la
poitrine. La grande quantité de fragmens de même matière épars à quelque distance
de là doit faire présumer qu’il existoit un colosse pareil, placé symétriquement
de l’autre côté de la porte, vers l’est. Le pylône offre encore des traces de ces rainures
cunéiformes pratiquées ordinairement dans la face extérieure de ce genre ■
d’édifice, et destinées, comme nous le prouverons bientôt (2), a recevoir des mâts
triomphaux.
La cour comprise entre le troisième et le quatrième pylônes a quatre-vingt-
trois mètres (3) de longueur : elle est terminée à l’ouest par un mur de clôture
qui conserve encore quelque élévation au-dessus du sol de décombres, et a lest
par des constructions d’une nature particulière que nous allons bientôt décrire.
Le quatrième pylône a soixante-quatre mètres (4) de longueur et une épaisseur de
dix mètres (y) : le talus de ses murs est le même que le talus des murs du précédent;
son axe fait avec le méridien magnétique un angle de cent quarante-quatre
degrés. 11 offre l’aspect de la plus grande destruction ; il n’a d’assez bien conservé
que sa porte qui est tout en granit. En avant de sa face nord, on voit encore, de
chaque côté de l’entrée, deux colosses (6) en-spath calcaire cristallisé, presque
semblable au marbre. Ils sont debout dans l’action de marcher; ils ont une espèce
de poignard à la ceinture, comme les Mamlouks en portent encore aujourdhui.
Us s’élèvent de quatre mètres et demi (7) au-dessus des monceaux de pierres et de
débris qui les environnent. Le pylône, en s’écroulant, les a en partie brisés; la
tête manque ; les mains et les bras sont tout mutilés. Ces statues pouvoient avoir
dix mètres (8) de proportion. En avant de la face sud, et de chaque côté de la porte,
il existoit deux colosses assis, en granit rose, dont il ne reste plus à présent que
des masses informes. 11 est probable que leur destruction ne date pas de bien loin1,
puisque Pococke, qui voyageoit en Egypte de 17 3 7 à 17 3 9 , les a vus encore
bien conservés. A peu de distance de chacun de ces colosses, à 1 est et à 1 ouest,
on trouve beaucoup de fragmens de grès siliceux : il y en a même un bloc assez
considérable en partie enfoui, qui ne présente plus maintenant aucune forme;
ce qui doit faire présumer qu’il existoit encore là deux autres statues. Ainsi il y en
avoit quatre au-devant du pylône. La face sud offre encore des restes des sculptures
dont elle a été décorée. On voit, dans la partie de l’est, des figures de six
mètres (9) de proportion. Le parement de l’ouest est entièrement écroulé.'
Ca porte du pylône est autant remarquable par ses grandes dimensions que par
la belle matière dont elle est bâtie. Le granit n’a aucune liaison avec le reste de
la construction ; ce qui fait croire, au premier abord, qu’il n’est employé que comme
revêtement : mais on ne tarde point à reconnoître que ce n’est pas un simple
(1) Quatre pieds. (6) Voye^ le plan topographique , planche ¡6 , A .
(2) Voyez ci-après, pag. 263. vol. I I I .
(3) Quarante-deux toises trois pieds. (7) Quatorze pieds.
(4) Trente-deux toises cinq pieds. (8) Trente pieds.
{5) Trente pieds. (p) Dix-huit pieds.
/
C H A P I T R E I X . S E C T I O N V I I I . 2 ^ 3
placage, et que la porte toute entière est en granit. Plusieurs blocs sont fendus,
écaillés et même écrasés par le poids des assises supérieures. Les pierres de grès
qui forment le reste du pylône, sont disposées avec peu de soin ; le mortier qui
lioit la maçonnerie, est maintenant très-friable; La porte en granit est couverte
intérieurement et extérieurement de tableaux et d’hiéroglyphes ( i ) dessinés avec
une pureté de trait et une richesse de détails vraiment admirables. On a sur-tout
lieu d’être étonné, lorsqu’on les compare à ceux qui étoient exécutés sur le grès
dans tout le reste du pylône. Il semble qu’on ne peut attribuer les premiers qu à un
art très-perfectionné, et l’on seroit.tenté de croire que les seconds ne sont pas de la
même époque. Sous le rapport de la beauté du travail, les sculptures de la porte
de granit sont tout-à-fait comparables aux hiéroglyphes qui décorent les obélisques.
Bien qu’il soit constant que les artistes Égyptiens mettoient plus de recherche et
de soin dans les bas-reliefs qu’ils exécutoient sur les matières dures et précieuses,
il faut bien toutefois admettre qu’ils avoient, pour la taille de ces pierres, des outils
d’une trempe particulière.
Les sculptures de la porte en granit représentent des offrandes (2) aux dieux de
i’Égypte, et particulièrement à la grande divinité de Thèbes, à Harpocrate, emblème
de la fécondité et de la reproduction. A une époque récente, probablement au
temps où les Chrétiens Grecs du Bas-Empire exerçoient leur culte dans les anciens
monumens de l’Égypte, on s’est attaché à détruire le signe de la virilité qui caractérise
cette divinité ; mais on n’a pu en effacer entièrement la trace. Les deux bas-
reliefs supérieurs n’ont point d’hiéroglyphes : mais tout porte a croire quils en
auroient été accompagnés comme les autres, s’ils eussent été terminés ; une ligne
commencée dans le tableau le plus élevé ( 3) ne laisse même aucun doute a cet égard.
Au milieu de la cour formée par les deux derniers pylônes sur le côté de 1 est,
on aperçoit les restes d’une construction (4) qui paroît avoir servi d’habitation
particulière. Elle consiste en un corps de bâtiment principal, composé dun portique
à jour et d’une salle dont les plafonds sont soutenus par des piliers ou des
colonnes ; ce que l’encombrement ne nous a pas permis de déterminer ; car on
sait que l’architecture Égyptienne offre souvent des colonnes dont les dés sont très-
élevés'; ce qui fait qu’elles ne présentent pas un aspect différent des piliers lorsqu’elles
sont enfouies. Les deux ailes du bâtiment sont distribuées en petits
appartemens plus longs que larges. Au-devant du portique, s élève encore de deux
mètres soixante centièmes au-dessus du sol de décombres, une espèce de pilier
de granit qui nous a paru être le montant d’une porte de 1 édifice.
L ’avenue formée par les quatre pylônes que nous avons décrits, est une de celles
qui présentent le plus de magnificence, et où les Égyptiens ont prodigué toutes
les richesses de l’art et employé les matières les plus précieuses. Les Grecs ont
appelé ces édifices du nom de propylées ['o/’owdAa.i«.] (5). On y compte actuellement
douze colosses monolithes de plus de dix mètres de proportion. Les
(1) Voyez \z planche 4 7 , Jig . i et 2 , A . vol. I I I . - (4) I V ; le plan lopograplüijue, pl. ,6 , A . vol. I I I .
(2) V o y e z planche 4 7 , fis. 1 et 2 , A . vol. I I I . (5) Vaye^ ci-après, pag. 287, l’examen que nous avons
(3) Voyez la planche 47, f i g . i , A , vol. III. fait d’un passage de Strubon.,