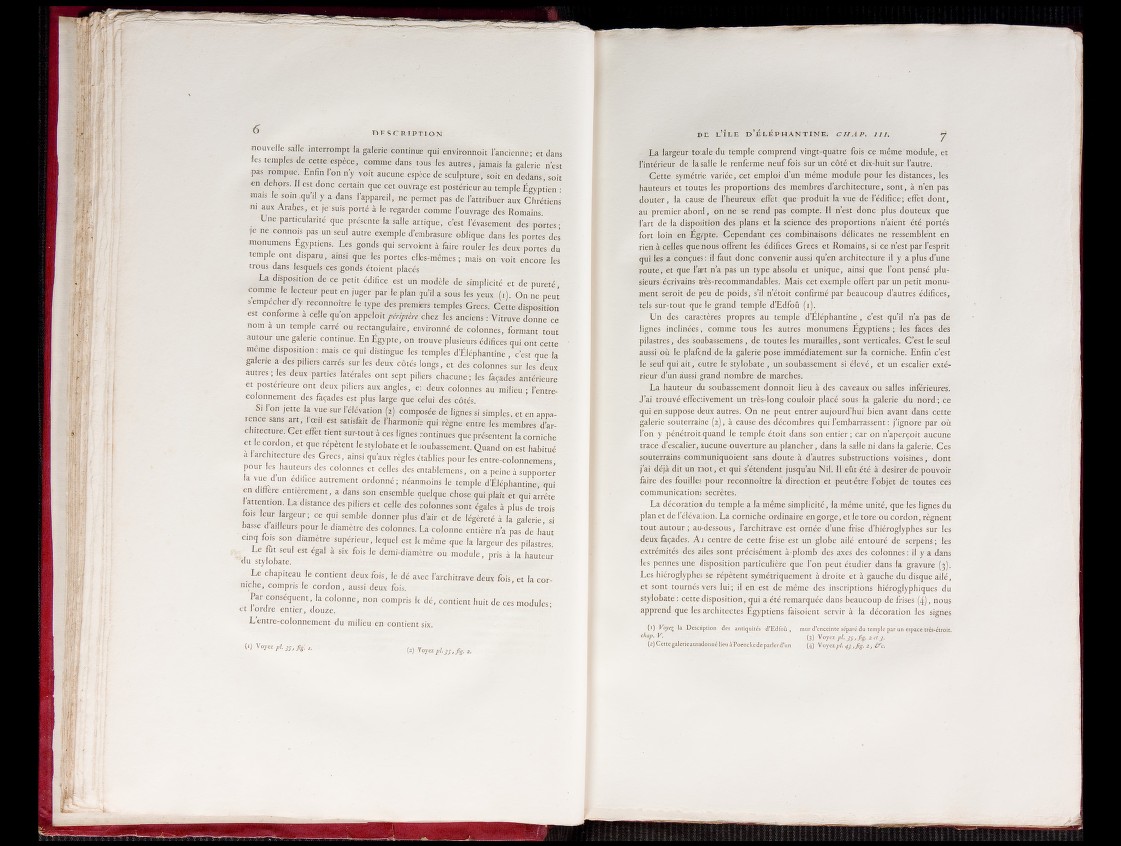
nouvelle salle interrompt la galerie continue qui environnoit l’ancienne; et dans
les temples de cette espèce, comme dans tous les autres, jamais la galerie n’est
pas rompue. Enfin l’on n’y voit aucune espèce de sculpture, soit en dedans, soit
-en dehors. Il est donc certain que cet ouvrage est postérieur au temple Égyptien :
mais le som .qu’il y a dans l’appareil, ne permet pas de l’attribuer aux Chrétiens
m aux Arabes, et je suis porté à le regarder comme l’ouvrage des Romains.
Une particularité que présente la salle antique, c’est l’évasement des portes;
■je ne connois pas un seul autre exemple d’embrasure oblique dans les portes des
monumens Egyptiens. Les gonds qui servoient à frire rouler les deux portes du
temple ont disparu, ainsi que les portes elles-mêmes; mais on voit encore les
trous dans lesquels ces gonds étoient placés.
La disposition de ce petit édifice est un modèle de simplicité et de pureté
comme le lecteur peut en juger par le plan qu’il a sous les yeux (i). On ne peut
sempecher d’y reconnoitre le type des premiers temples Grecs. Cette disposition
est conforme a celle qu’on appeloit périprère chez les anciens : Vitruve donne ce
nom à un temple carré ou rectangulaire, environné de colonnes, formant tout
autour une galerie continue. En Égypte, on trouve plusieurs édifices qui ont cette
meme disposition: mais ce qui distingue les temples d’Éléphantine, c’est que la
galerie a des piliers carrés sur les deux côtés longs, et des colonnes sur les deux
autres; les deux parties latérales ont sept piliers chacune; les façades antérieure
et postérieure ont deux piliers aux angles, et deux colonnes au milieu ; l’entre-
colonnement des frçades est plus large que celui des côtés.
Si l’on jette la vue sur l’élévation (2) composée de lignes si simples, et en apparence
sans art, l’oeil est satisfait de l’harmonie qui règne entre les membres d’ar-
c utecture. Cet effet tient sur-tout à ces lignes continues que présentent la corniche
et le cordon, et que répètent le stylobate et le soubassement. Quand on est habitué
a 1 architecture des Grecs, ainsi qu’aux règles établies pour les entre-colonnemens
pour les hauteurs des colonnes et celles des entablemens, on a peine à supporter
la vue d un édifice autrement ordonné; néanmoins le temple d’Éiéphantine qui
en diffère entièrement, a dans son ensemble quelque chose qui plaît et qui arrête
1 attention. La distance des piliers et celle des colonnes sont égales à plus de trois
fois leur largeur; ce qui semble donner plus d’air et de légèreté à la galerie, si
basse d ailleurs pour le diamètre des colonnes. La colonne entière n’a pas de haut
cinq fois son diamètre supérieur, lequel est le même que la largeur des pilastres.
Le fut seul est égal à six fois le demi-diamètre ou module, pris à la hauteur
du stylobate.
Le chapiteau le contient deux fois, le dé avec l’architrave deux fois, et la corniche,
compris le cordon, aussi deux fois.
Par conséquent, la colonne, non compris le dé, contient huit de ces modules-
et 1 ordre entier, douze.
L entre-colonnement du milieu en contient six.
( 0 Voyez p l . 3 s , f ig . ,.
(2) Voyez p l . j s . f i g . 2.
L a largeur totale du temple comprend vingt-quatre fois ce même module, et
l’intérieur de la salle le renferme neuf fois sur un côté et dix-huit sur l’autre.
Cette symétrie variée, cet emploi d’un même module pour les distances, les
hauteurs et toutes les proportions des membres d’architecture, sont, à n’en pas
douter, la cause de l’heureux effet que produit la vue de l’édifice; effet dont,
au premier abord, on ne se rend pas compte. Il n’est donc plus douteux que
l’art de la disposition des plans et la science des proportions n’aient été portés
fort loin en Égypte. Cependant ces combinaisons délicates ne ressemblent en
rien à celles que nous offrent les édifices Grecs et Romains, si ce n’est par l’esprit
qui les a conçues : il feut donc convenir aussi qu’en architecture il y a plus d’une
route, et que l’art n’a pas un type absolu et unique, ainsi que l’ont pensé plusieurs
écrivains très-recommandables. Mais cet exemple offert par un petit monument
seroit de peu de poids, s’il n’étoit confirmé par beaucoup d’autres édifices,
tels sur-tout que le grand temple d’Edfoû (1).
Un des caractères propres au temple d’Éléphantine, c’est qu’il n’a pas de
lignes inclinées, comme tous les autres monumens Égyptiens ; les feces des
pilastres, des soubassemens , de toutes les murailles, sont verticales. C ’est le seul
aussi où le plafond de la galerie pose immédiatement sur la corniche. Enfin c’est
le seul qui ait, outre le stylobate , un soubassement si élevé, et un escalier extérieur
d’un aussi grand nombre de marches.
La hauteur du soubassement donnoit lieu à des caveaux ou salles inférieures.
J ’ai trouvé effectivement un très-long couloir placé sous Ja galerie du nord ; ce
qui en suppose deux autres. On ne peut entrer aujourd’hui bien avant dans cette
galerie souterraine (2), à cause des décombres qui l’embarrassent : j’ignore par où
l’on y pénétrait quand le temple étoit dans son entier ; car on n’aperçoit aucune
trace d’escalier, aucune ouverture au plancher, dans la salle ni dans la galerie. Ces
souterrains communiquoient sans doute à d’autres substructions voisines, dont
j’ai déjà dit un mot, et qui s'étendent jusqu’au Nil. II eût été à desirer de pouvoir
frire des fouilles pour reconnoître la direction et peut-être l’objet de toutes ces
communications secrètes.
La décoration du temple a la même simplicité, la même unité, que les lignes du
plan et de l’élévation. La corniche ordinaire en gorge, et le tore ou cordon, régnent
tout autour ; au-dessous, l’architrave est ornée d’une frise d’hiéroglyphes sur les
deux frçades. Au centre de cette frise est un globe ailé entouré de serpens ; les
extrémités des ailes sont précisément à-plomb des axes des colonnes : il y a dans
les pennes une disposition particulière que l’on peut étudier dans la gravure (3).
Les hiéroglyphes se répètent symétriquement à droite et à gauche du disque ailé,
et sont tournés vers lui; il en est de même des inscriptions hiéroglyphiques du
stylobate : cette disposition, qui a été remarquée dans beaucoup de frises (4), nous
apprend que les architectes Égyptiens faisoient servir à la décoration les signes
(1) Voye^ la Description des antiquités d’E d fo û , mur d’enceinte séparé du temple par un espace très-étroit.
thaP- W (3) Voyez p l. J S . f g . 2 n p .
(2) Cette galcrieaura donné lieu à Pococke de parler d’un (4) Voyez p l . q j , f i g , 2 , &c.