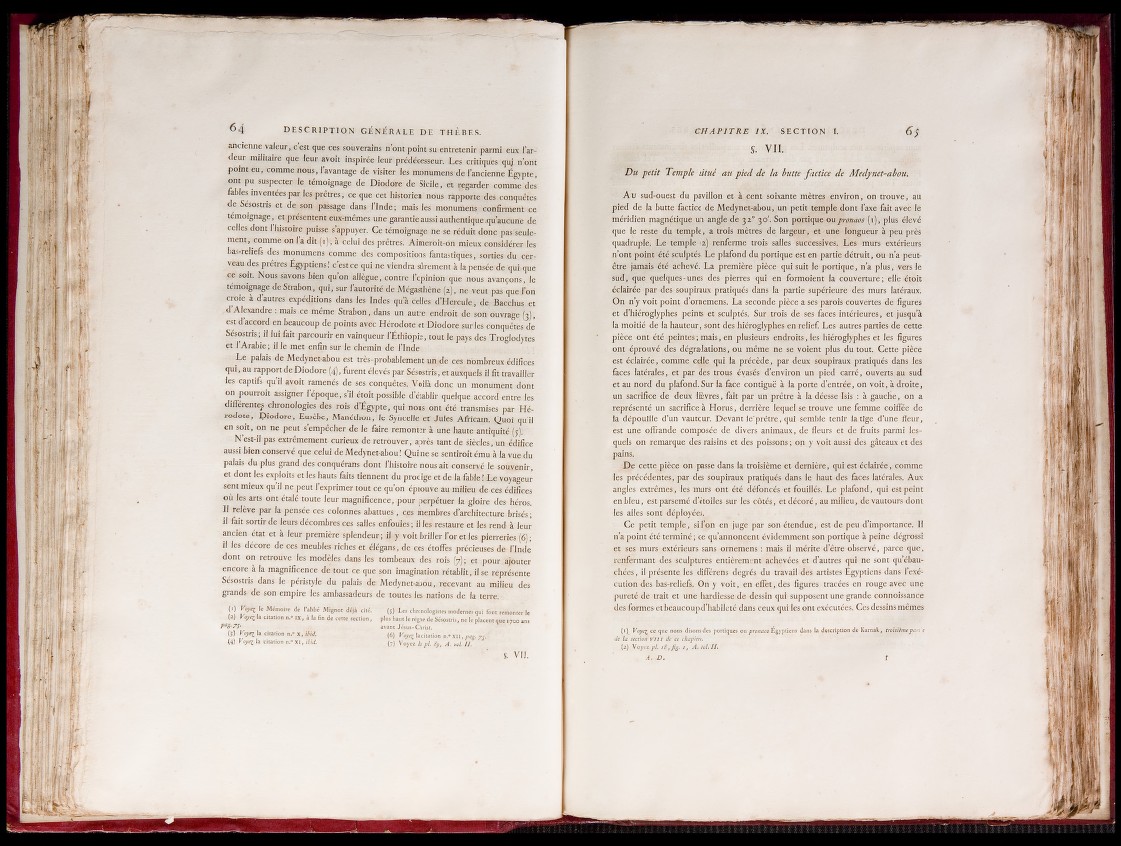
ancienne valeur, c’est que ces souverains n’ont point su entretenir parmi eux l’ardeur
militaire que leur avoit inspirée leur prédécesseur. Les critiques quj n’ont
point eu, comme nous, 1 avantage de visiter les monumens de l’ancienne Égypte,
ont pu suspecter le témoignage de Diodore de Sicile, et regarder comme des
fables inventées par les prêtres, ce que cet historien nous rapporte des conquêtes
de Sésostris et de son passage dans l’Inde; mais les monumens confirment ce
témoignage, et présentent eux-mêmes une garantie aussi authentique .qu’aucune de
celles dont 1 histoire puisse s’appuyer. Ce témoignage ne se réduit donc pas'seule-
ment, comme on I a dit (i) , à celui des prêtres. Aimeroit-on mieux considérer les
bas-reliefs des monumens comme des compositions fantastiques, sorties du cerveau
des prêtres Égyptiens! c’est ce qui ne viendra sûrement à la pensée de qui que
ce soit. Nous savons bien qu’on allègue, contre l’opinion que nous avançons, le
témoignage deStrabon, qui, sur l’autorité de Mégasthène (a), ne veut pas que l’on
croie à d’autres expéditions dans les Indes qu’à celles d’Hercule, de Bacchus et
d Alexandre : mais ce même Strabon, dans un autre endroit de son ouvrage (3),
est d accord en beaucoup de points avec Hérodote et Diodore sur les conquêtes de
Sésostris ; il lui fait parcourir en vainqueur l’Éthiopie, tout le pays des Troglodytes
et 1 Arabie ; il le met enfin sur le chemin de l’Inde.
Le palais de Medynet-abou est très-probablement un de ces nombreux édifices
qui, au rapport de Diodore (4), furent élevés par Sésostris, et auxquels il fit travailler
les captifs qu’il avoit ramenés de ses conquêtes. Voilà donc un monument dont
on pourrait assigner 1 époque, s’il étoit possible d’établir quelque accord entre les
différente^ chronologies des rois d’Égypte, qui nous ont été transmises par Hérodote,
Diodore, Eusèbe, Manéthon, le Syncelle et Jules Africain. Quoi qu’il
en soit, on ne peut s empêcher de le faire remonter à une haute antiquité (5).
N est-il pas extrêmement curieux de retrouver, après tant de siècles, un édifice
aussi bien conserve que celui de Medynet-abou! Qui ne se sentirait ému à la vite du
palais du plus grand des conquérans dont 1 histoire nous ait conservé le souvenir,
et dont les exploits et les hauts faits tiennent du prodige et de la fable ! Le voyageur
sent mieux qu il ne peut l’exprimer tout ce qu’on éprouve au milieu de ces édifices
où les arts ont étalé toute leur magnificence, pour perpétuer la gloire des héros.
Il relève par la pensée ces colonnes abattues, ces membres d’architecture brisés ;
il fait sortir de leurs décombres ces salles enfouies; il les restaure et les rend à leur
ancien état et à leur première splendeur; il y voit briller l’or et les pierreries (6);
il les décore de ces meubles riches et élégans, de ces étoffes précieuses de l’Inde
dont on retrouve les modèles dans les tombeaux des rois (7) - et pour ajouter
encore à la magnificence de tout ce que son imagination rétablit, il se réprésente
Sésostris dans le péristyle du palais de Medynet-abou, recevant au milieu des
glands de son empire les ambassadeurs de toutes les nations de la terre.
(■) Voyei le Mémoire de l’abbé Mignot d é jà cité. (5) Les chronologistes modernes qui font remonter le
(2) Vojei la crtatron n." I X , à la fin de cette section, plus haut le régne de Sésostris, ne le placent que 17 0 0 ans
PaS’ 75' avant Jé sus-Christ.
(3) Voyri la citation n.” X , ibid. (6) Kej.ej la citation n." X I I , pag. 7S.
( 4) Eo /e j la citation n.» XI, ibid. (7 ) Voyez iü pl. SS , A. vol. II.
S. VII.
Du petit Temple situé au p ied de la butte factice de Medynet-abou.
A u sud-ouest du pavillon et à cent soixante mètres environ, on trouve, au
pied de la butte factice de Medynet-abou, un petit temple dont l’axe fait avec le
méridien magnétique un angle de 320 30'. Son portique ou pronaos (1), plus élevé
que le reste du temple, a trois mètres de largeur, et une longueur à peu près
quadruple. Le temple (2) renferme trois salles successives. Les murs extérieurs
n’ont point été sculptés. Le plafond du portique est en partie détruit, ou n’a peut-
être jamais été achevé. La première pièce qui suit le portique, n’a plus, vers le
sud, que quelques-unes des pierres qui en formoient la couverture; elle étoit
éclairée par des soupiraux pratiqués dans la partie supérieure des murs latéraux.
On n’y voit point d’ornemens. La seconde pièce a ses parois couvertes de figures
et d’hiéroglyphes peints et sculptés. Sur trois de ses faces intérieures, et jusqu’à
la moitié de la hauteur, sont des hiéroglyphes en relief. Les autres parties de cette
pièce ont été peintes ; mais, en plusieurs endroits, les hiéroglyphes et les figures
ont éprouvé des dégradations, ou même ne se voient plus du tout. Cette pièce
est éclairée, comme celle qui la précède, par deux soupiraux pratiqués dans les
faces latérales, et par des trous évasés d’environ un pied carré, ouverts au sud
et au nord du plafond. Sur la face contiguë à la porte d’entrée, on voit, à droite,
un sacrifice de deux lièvres, fait par un prêtre à la déesse Isis : à gauche, on a
représenté un sacrifice à Horus, derrière lequel se trouve une femme coiffée de
la dépouille d’un vautour. Devant le’prêtre, qui semble tenir la tige d’une fleur,
est une offrande composée de divers animaux, de fleurs et de fruits parmi lesquels
on remarque des raisins et des poissons ; on y voit aussi des gâteaux et des
pains.
De cette pièce on passe dans la troisième et dernière, qui est éclairée, comme
les précédentes, par des soupiraux pratiqués dans le haut des faces latérales. Aux
angles extrêmes, les murs ont été défoncés et fouillés. Le plafond, qui est peint
en bleu, est parsemé d’étoiles sur les côtés, et décoré, au milieu, de vautours dont
les ailes sont déployées.
Ce petit temple, si l’on en juge par son étendue, est de peu d’importance. Il
n’a point été terminé ; ce qu’annoncent évidemment son portique à peine dégrossi
et ses murs extérieurs sans ornemens : mais il mérite d’être observé, parce que,
renfermant des sculptures entièrement achevées et d’autres qui ne sont qu’ébau-
chées, il présente les différens degrés du travail des artistes Égyptiens dans ¡exécution
des bas-reliefs. On y voit, en effet, des figures tracées en rouge avec une
pureté de trait et une hardiesse de dessin qui supposent une grande connoissance
des formes et beaucoup d’habileté dans ceux qui les ont exécutées. Ces dessins mêmes
(1) Voye^ ce que nous disons des portiques ou pronaos Égyptiens dans la description de Karnak, troisième pan e
de la section VI I I de ce chapitre.
ip| Voyez pl. t , A . vol, II.
a . d . r