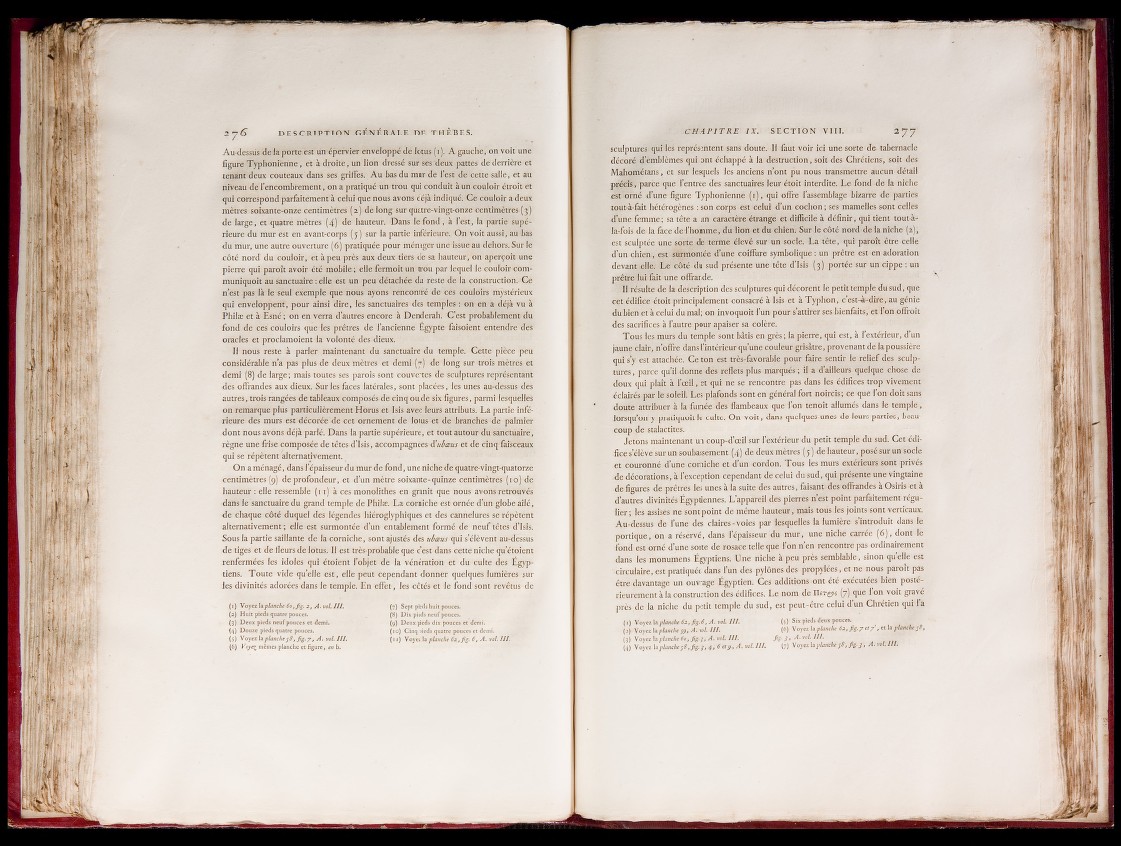
Au-dessüs de la porte est un épervier enveloppé de lotus (i). A gauche, on voit une
figure Typhoniènne, et à droite, un lion dressé sur ses deux pattes de derrière et
tenant deux couteaux dans ses griffes. Au has du mur de l’est de cette salle, et au
niveau de l’encombrement, on a pratiqué un trou qui conduit à un couloir étroit et
qui correspond parfaitement à celui que nous avons déjà indiqué. Ce couloir a deux
mètres soixante-onze centimètres (2) de long sur quatre-vingt-onze centimètres (3)
de large, et quatre mètres (4) de hauteur. Dans le fond, à l’est, la partie supérieure
du mur est en avant-corps (5) sur la partie inférieure. On voit aussi, au bas
du mur, une autre ouverture (6) pratiquée pour ménager une issue au dehors. Sur le
côté nord du couloir, et à peu près aux deux tiers de sa hauteur, on aperçoit une
pierre qui paroît avoir été mobile ; elle fermoit un trou par lequel le couloir corn-
muniquoit au sanctuaire : elle est un peu détachée du reste de la construction. Ce
n’est pas là le seul exemple que nous ayons rencontré de ces couloirs mystérieux
qui enveloppent, pour ainsi dire, les sanctuaires des temples : on en a déjà vu à
Philæ et à Esné ; on en verra d’autres encore à Denderah. C’est probablement du
fond de ces couloirs que les prêtres de l’ancienne Egypte faisoient entendre des
oracles et proclamoient la volonté des dieux.
Il nous reste à parler maintenant du sanctuaire du temple. Cette pièce peu
considérable n’a pas plus de deux mètres et demi (7) de long sur trois mètres et
demi (8) de large; mais toutes ses parois sont couvertes de sculptures représentant
des offrandes aux dieux. Sur les faces latérales, sont placées, les unes au-dessus des
autres, trois rangées de tableaux composés de cinq ou de six figures, parmi lesquelles
on remarque plus particulièrement Horus et Isis avec leurs attributs. La partie inférieure
des murs est décorée de cet ornement de lotus et de branches de palmier
dont nous avons déjà parlé. Dans la partie supérieure, et tout autour du sanctuaire,
règne une frise composée de têtes d’Isis, accompagnées d’uboeus et de cinq faisceaux
qui se répètent alternativement.
On a ménagé, dans l’épaisseur du mur de fond, une niche de quatre-vingt-quatorze
centimètres (9) de profondeur, et d’un mètre soixante-quinze centimètres (10) de
hauteur : elle ressemble (11) à ces monolithes en granit que nous avons retrouvés
dans le sanctuaire du grand temple de Philæ. La corniche est ornée d’un globe ailé,
de chaque côté duquel des légendes hiéroglyphiques et des cannelures se répètent
alternativement; elle est surmontée d’un entablement formé de neuf têtes d’Isis.
Sous la partie saillante de la corniche, sont ajustés des uboeus qui s’élèvent au-dessus
de tiges et de fleurs de lotus. Il est très-probable que c’est dans cette niche qu’étoient
renfermées les idoles qui étoient l’objet de la vénération et du culte des Égyptiens.
Toute vide qu’elle est, elle peut cependant donner quelques lumières sur
les divinités adorées dans le temple. En effet, les côtés et le fond sont revêtus de
(1) Voyez la planche 60, Jig. z t A . vol. I I I . (7) Sept pieds huit pouces.
(z) Huit pieds quatre pouces. (8) Dix pieds neuf pouces.
{3) .Deux pieds neuf pouces et demi. (9) Deux pieds dix pouces et demi.
(4) Douze pieds quatre pouces. (10) Cinq pieds quatre pouces et demi.
(5) Voyez la planche $ 8 , Jig. y , A . vol. I I I . ( 11) Voyez la planche 6z, fig. 6 , A . vol. I I I .
(6) Voye^ mêmes planche et figure, en b.
C H A P I T R E I X . S E C T I O N V I I I . 2 7 7
sculptures qui les représentent sans doute. Il faut voir ici une sorte de tabernacle
décoré d’emblèmes qui ont échappé à la destruction, soit des Chrétiens, soit des
Mahométans, et sur lesquels les anciens n’ont pu nous transmettre aucun détail
précis, parce que l’entrée des sanctuaires leur étoit interdite. Le fond de la niche
est orné d’une figure Typhonienne (i), qui offre l’assemblage bizarre de parties
tout-à-fait hétérogènes : son corps est celui d’un cochon ; sês mamelles sont celles
d’une femme ; sa tête a un caractère étrange et difficile à définir, qui tient tout-à-
la-fois de la face d e f homme, du lion et du chien. Sur le côté nord de la niche (i),
est sculptée une sorte de terme élevé sur un socle. La tête, qui paroît être celle
d’un chien, est surmontée d’une coiffure symbolique : un prêtre est en adoration
devant elle. Le côté du sud présente une tête d’Isis (3) portée sur un cippe : un
prêtre lui fait une offrande.
Il résulte de la description des sculptures qui décorent le petit temple dusud, que
cet édifice étoit principalement consacré à Isis et à Typhon, c’est-à-dire, au génie
du bien et à celui du mal ; on invoquoit l’un pour s’attirer ses bienfaits, et l’on offroit
des sacrifices à l’autre pour apaiser sa colère.
Tous les murs du temple sont bâtis en grès; la pierre, qui est, à l’extérieur, d un
jaune clair, n’offre dans l’intérieur qu’une couleur grisâtre, provenant de la poussière
qui s’y est attachée. Ce ton est très-favorable pour faire sentir le relief des sculptures
, parce qu’il donne dés reflets plus marqués ; il a d’ailleurs quelque chose de
doux qui plaît à l’oe il, et qui ne se rencontre pas dans les édifices trop vivement
éclairés par le soleil. Les plafonds sont en général fort noircis; ce que l’on doit sans
doute attribuer à la fumée des flambeaux que l’on tenoit allumés dans le temple,
lorsqu’on y pratiquoitle culte. On voit, dans quelques-unes de leurs parties, beaucoup
de stalactites.
Jetons maintenant un coup-d’oeil sur l’extérieur du petit temple du sud. Cet édifice
s’élève sur un soubassement (4) de deux mètres ( y ) de hauteur, posé sur un socle
et couronné d’une corniche et d’un cordon. Tous les murs extérieurs sont privés
de décorations, à l’exception cependant de celui du sud, qui présente une vingtaine
de figures de prêtres les unes à la suite des autres, faisant des offrandes a Osiris et a
d’autres divinités Égyptiennes. L ’appareil des pierres nest point parfaitement régulier
; les assises ne sont point de même hauteur, mais tous les joints sont verticaux.
Au-dessus de l’une des claires-voies par lesquelles la lumière s introduit dans le
portique, on a réservé, dans l’épaisseur du mur, une niche carree (6), dont le
fond est orné d’une sorte de rosace telle que l’on n’en rencontre pas ordinairement
dans les monumens Égyptiens. Une niche à peu près semblable, sinon quelle est
circulaire, est pratiquée dans 1 un des pylônes des propylees, et ne nous païoit pas
être davantage un ouvrage Égyptien. Ces additions ont ete executees bien postérieurement
à la construction des édifices. Le nom de ïlergyi (7) que 1 on voit grave
près de la niche du petit temple du sud, est peut-être celui dun Chrétien qui la
(!) Voyez la planche f c , Jlg. 6 , A . vol. I I I . (s) Six pieds deux pouces.
(2) Voyez la planche A . vol. I I I . (<>) Voyez la planche C z , fg .7 e t f , et la fb n ch e ¡ 8 ,
(l) Voyez h planche 6o, f i g . J , A . vol, I I I . fig ' 3 > A . vol. I I I .
(4) Voyezla planche ¡ S , Jlg. j , g ; 6 et p., A . vol. I I I . (7) Vo y ezh planche f g . j , A . vol. I I I .