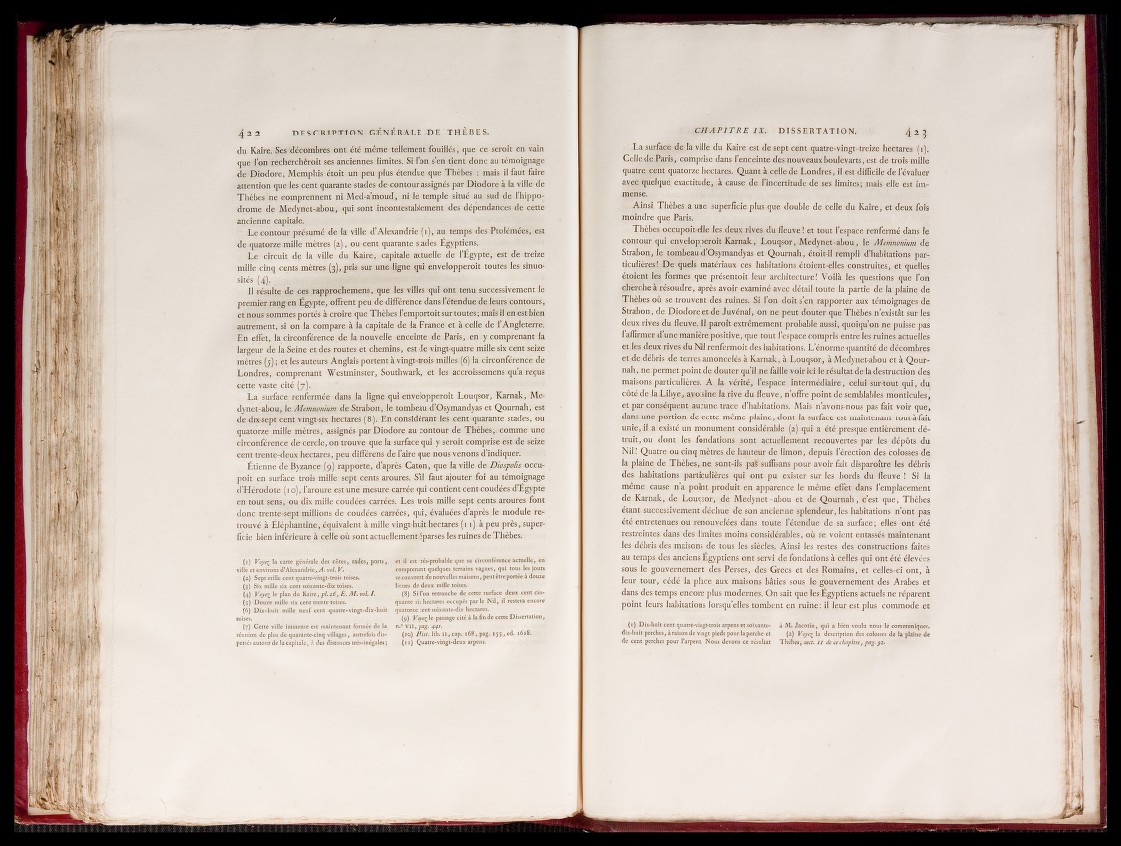
du Kaire. Ses décombres ont été même tellement fouillés, que ce seroit en vain
que l’on recherchêroit ses anciennes limites. Si l’on s’en tient donc au témoignage
de Diodore, Memphis étoit un peu plus étendue que Thèbes : mais il faut faire
attention que les cent quarante stades de contour assignés par Diodore à la ville de
Thèbes ne comprennent ni Med-a’moud, ni le temple situé au sud de l’hippodrome
de Medynet-abou, qui sont .incontestablement des dépendances de cette
ancienne capitale.
Le contour présumé de la ville d’Alexandrie (t), au temps des Ptolémées, est
de quatorze mille mètres (a) , ou cent quarante stades Egyptiens.
Le circuit de la ville du Kaire, capitale actuelle de l’Égypte, est de treize
mille cinq cents mètres {3), pris sur une ligne qui envelopperait toutes les sinuosités
(4).
Il résulte de ces rapprochemens, que les villes qui ont tenu successivement le
premier rang en Égypte, offrent peu de différence dans l’étendue de leurs contours,
et nous sommes portés à croire que Thèbes l’emportoit sur toutes; mais il en est bien
autrement, si on la compare à la capitale de la France et à celle de l’Angleterre.
En effet, la circonférence de la nouvelle enceinte de Paris, en y comprenant la
largeur de la Seine et des routes et chemins, est de vingt-quatre mille six cent seize
mètres (î); et les auteurs Anglais portent à vingt-trois milles (6) la circonférence de
Londres, comprenant Westminster, Southwark, et les accroissemens qu’a reçus
cette vaste cité (7).
La surface renfermée dans la ligne qui envelopperoit Louqsor, Kamak, Medynet
abou, le Memnonium de Strabon, le tombeau d’Osymandyas et Qournah, est
de dix-sept cent vingt-six hectares (8). En considérant les cent quarante stades, ou
quatorze mille mètres, assignés par Diodore au contour de Thèbes,. comme une
circonférence de cercle, on trouve que la surface qui y seroit comprise est de seize
cent trente-deux hectares, peu différens de faire que nous venons d indiquer.
Étienne de Byzance (9) rapporte, d’après Caton, que la ville de Diospolis occu-
poit en surface trois mille sept cents aroures. S’il faut ajouter foi au témoignage
d’Hérodote (10), l’aroure est une mesure carrée qui contient cent coudées d’Egypte
en tout sens, ou dix mille coudées carrées. Les trois mille sept cents aroures font
donc trente-sept millions de coudées carrées, qui, évaluées d’après Je module retrouvé
à Éléphantine, équivalent à mille vingt-huit hectares (11) à peu près, superficie
bien inférieure à celle où sont actuellement éparses les ruines de Thèbes.
(1) Voyez la carte générale des côtes, rades, ports, et il est très-probabie que sa circonférence actuelle, en
ville et environs d’Alexandrie, A . vol. V• comprenant quelques terrains vagues, qui tous les jours
(2) Sept mille cent quatre-vingt-trois toises. se couvrent de nouvelles maisons, peut etre portée a douze
(3) Six mille sir cent soixante-dix toises. lieues de deux mille toises.
(4) Voyez Ie plan du Kaire, pl. 26 , É . JVI. vol. I . (8) S i l’on retranche de cette surface deux cent cin*
(5) Douze mille six cent trente toises. quante six hectares occupés par le N il, il restera encore*
(6) Dix-huit mille neuf cent quatre-vingt-dix-huit quatorze cent soixante-dix hectares.
toises. (9) Voyez le passage cité à la fin de cette Dissertation,
(7) Cette ville immense est maintenant formée de la n.° v i l , pag. 441.
réunion de plus, de quarante-cinq villages, autrefois dis- (iq) Hist. lib. i l , cap. 16 8 , pag. 155, ed. 1618.
perses autour de la capitale, à des distances très-inégales; (11) Quatre-vingt-deux arpens.
La surface de la ville du Kaire est de sept cent quatre-vingt-treize hectares (i).
Celle de Paris, comprise dans 1 enceinte des nouveauxboulevarts, est de trois mille
quatre cent quatorze hectares. Quant à celle de Londres, il est difficile de l’évaluer
avec quelque exactitude, à cause de l’incertitude de ses limites; mais elle est immense.
Ainsi Thèbes aune superficie plus que double de celle du Kaire, et deux fois
moindre que Paris.
Thèbes occupoit-elle les deux rives du fleuve ! et tout l’espace renfermé dans le
contour qui envelopperoit Karnak, Louqsor, Medynet-abou, le Memnonium de
Strabon, le tombeau d’Osymandyas et Qournah, étoit-il rempli d’habitations particulières!
De quels matériaux ces habitations étoient-eiles construites, et quelles
étoient les formes que présentoit leur architecture! Voilà les questions que l’on
cherche à résoudre, après avoir examiné avec détail toute la partie de la plaine de
Thebes où se trouvent des ruines. Si l’on doit s’en rapporter aux témoignages de
Strabon, de Diodore et de Juvénal, on ne peut douter que Thèbes n’existât sur les
deux rives du fleuve. Il paroît extrêmement probable aussi, quoiqu’on ne puisse pas
1 affirmer d une manière positive, que tout l’espace compris entre les ruines actuelles
et les deux rives du Nil renfermoit des habitations. L ’énorme quantité de décombres
et de débris de terres amoncelés à Karnak, à Louqsor, à Medynet-abou et à Qournah,
ne permet point de douter qu’il ne faille voir ici le résultat de la destruction des
maisons particulières. A la vérité, l’espace intermédiaire, celui sur-tout qui, dut
côté de la Libye, avoisine la rive du fleuve, n’offre point de semblables monticules,
et par conséquent aucune trace d’habitations. Mais n’avons-nous pas fait voir que,
dans une portion de cette même plaine, dont la surface est maintenant tout-à-fait
unie, il a existé un monument considérable (a) qui a été presque entièrement détruit,
ou dont les fondations sont actuellement recouvertes par (es dépôts du
Nil! Quatre ou cinq mètres de hauteur de limon, depuis l’érection des colosses de
la plaine de Thèbes, ne sont-ils pa£ suffisans pour avoir fait disparoître les débris
des habitations particulières qui ont pu exister sur les bords du fleuve ! Si la
même cause n’a point produit en apparence le même effet dans l’emplacement
de Karnak, de Louqsor, de Medynet-abou et de Qournah, c’est que, Thèbes
étant successivement déchue de son ancienne splendeur, les habitations n’ont pas
été entretenues ou renouvelées dans toute l’étendue de sa surface; elles ont été
restreintes dans des limites moins considérables, où se voient entassés maintenant
les débris des maisons de tous les siècles. Ainsi les restes des constructions faites
au temps des anciens Égyptiens ont servi de fondations à celles qui ont été élevées
sous le gouvernement des Perses, des Grecs et des Romains, et celles-ci ont, à
leur tour, cédé la place aux maisons bâties sous le- gouvernement des Arabes et
dans des temps encore plus modernes. On sait que les Égyptiens actuels ne réparent
point leurs habitations lorsqu’elles tombent en ruine: il leur est plus commode et
(i) Dix-huit cent quatre-vingt-trois arpens et soixante- à M. Jacotin, qui a bien voulu nous le communiquer,
dix-huit perches, a raison de vingt pieds pour la perche et (2) Voyez la description des colosses de la plaine de
de cent perches pour l’arpent. Nous devons ce résultat Thèbes, sect. i l de ce chapitre, pag. 92.