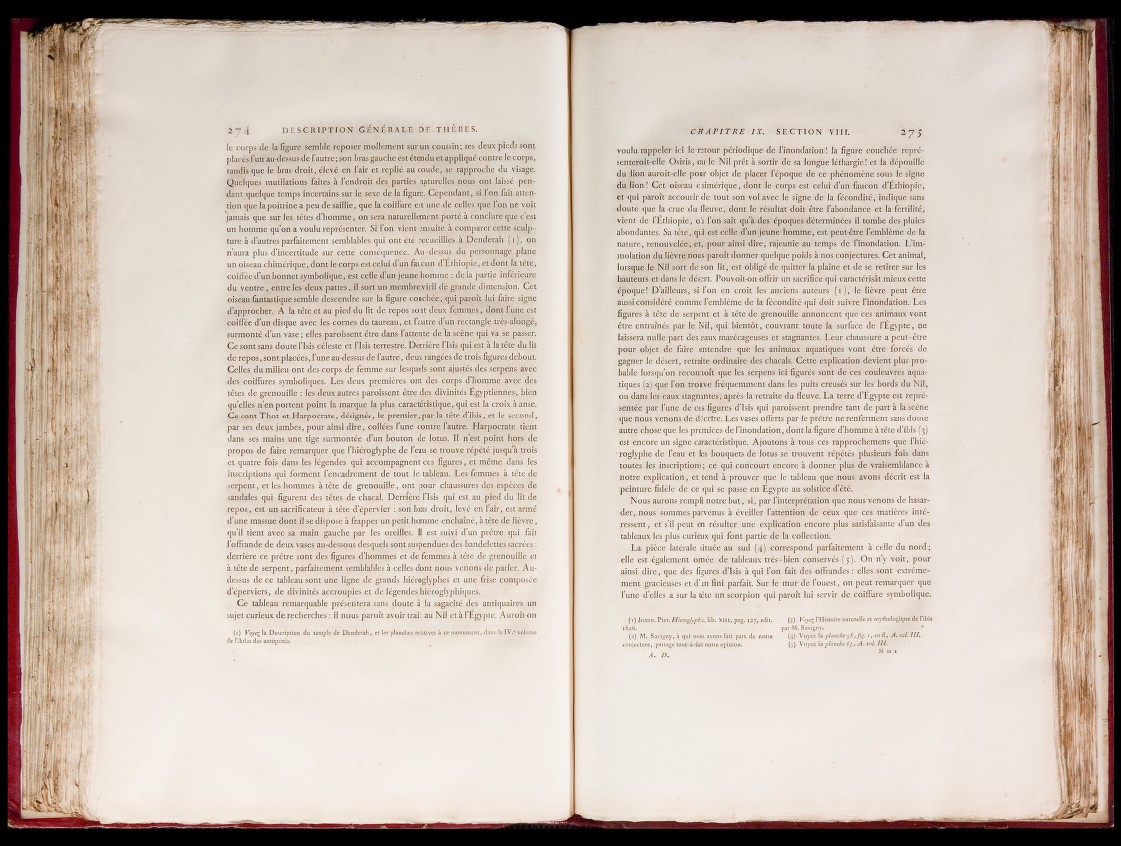
le corps de la figure semble reposer mollement sur un coussin; ses deux pieds sont
placés l’un au-dessus de l’autre ; son bras gauche est étendu et appliqué contre le corps,
tandis que le bras droit, élevé en l’air et replié au coude, se rapproche du visage.
Quelques mutilations faites à l’endroit des parties naturelles nous ont laissé pendant
quelque temps incertains sur le sexe de la figure. Cependant, si l’on fait attention
que la poin-ine a peu de saillie, que la coiffure est une de celles que l’on ne voit
jamais que sur les têtes d’homme, on sera naturellement porté à conclure que c’est
un homme qu’on a voulu représenter. Si l’on vient ensuite à comparer cette sculpture
à d’autres parfaitement semblables qui ont été recueillies à Denderah ( i ), on
n’aura plus d’incertitude sur cette conséquence. Au-dessus du personnage plane
un oiseau chimérique, dont le corps est celui d’un faucon d’Ethiopie, et dont la tête,
coiffée d’un bonnet symbolique, est celle d’un jeune homme : de la partie inférieure
du ventre, entre les deux pattes, il sort un membre viril de grande dimension. Cet
oiseau fantastique semble descendre sur la figure couchée, qui paroît lui faire signe
d’approcher. A la tête et au pied du lit de repos sont deux femmes, dont l’une est
coiffée d’un disque avec les cornes du taureau, et l’autre d’un rectangle très-alongé,
sunnonté d’un vase ; elles paraissent être dans l’attente de fa scène qui va se passer.
Ce sont sans doute l’Isis céleste et l’Isis terrestre. Derrière l’Isis qui est à la tête du lit
de repos, sont placées, l’une au-dessus de l’autre, deux rangées de trois figures debout.
Celles du milieu ont des corps de femme sur lesquels sont ajustés des serpens avec
des coiffures symboliques. Les deux premières ont des corps d’homme avec des
têtes de grenouille : les deux autres paraissent être des divinités Égyptiennes, bien
qu’elles n’en portent point la marque la plus caractéristique, qui est la croix à anse.
Ce sohtThot et Harpocrate, désignés, le premier, par la tête d’ibis, et le second,
par ses deux jambes, pour ainsi dire, collées l’une contre l’autre. Harpocrate tient
dans ses mains une tige surmontée d’un bouton de lotus. Il n’est point hors de
propos de faire remarquer que l’hiéroglyphe de l’eau se trouve répété jusqu’à trois
et quatre fois dans les légendes qui accompagnent ces figures, et même dans les
inscriptions qui forment l’encadrement de tout le tableau. Les femmes à tête de
serpent, et les hommes à tête de grenouille, ont pour chaussures des espèces de
sandales qui figurent des têtes de chacal. Derrière l’Isis qui est au pied du lit de
repos, est un sacrificateur à tête d’épervier : son bras droit, levé en l’air, est armé
d’une massue dont il se dispose à frapper un petit homme enchaîné, à tête de lièvre,
qu’il tient avec sa main gauche par les oreilles. Il est suivi d’un prêtre qui fait
l’offrande de deux vases au-dessous desquels sont suspendues des bandelettes sacrées :
derrière ce prêtre sont des figures d’hommes et de femmes à tête de grenouille et
à tête de serpent, parfaitement semblables à celles dont nous venons de parler. Au-
dessus de ce tableau sont une ligne de grands hiéroglyphes et une frise composée
d’éperviers, de divinités accroupies et de légendes hiéroglyphiques.
Ce tableau remarquable présentera sans doute à la sagacité des antiquaires un
sujet curieux de recherches : il nous paroît avoir trait au Nil et à l’Egypte. Auroit-on
(i) Voye^ la Description du temple de Denderah, et les planches relatives à ce monument, dans le JV .C volume
de l’Atlas des antiquités«
voulu rappeler ici le retour périodique de l’inondation ! la figure couchée représenterait
elle Osiris, ou le Nil prêt à sortir de sa longue léthargie! et la dépouille
du lion aurait-elle pour objet de placer l’époque de ce phénomène sous le signe
du lion! Cet oiseau chimérique, dont le corps est celui d’un faucon d’Ethiopie,
et qui paroît accourir de tout son vol avec le signe de la fécondité, indique sans
doute que la crue du fleuve, dont le résultat doit être l’abondance et la fertilité,
vient de l’Ethiopie, où l’on sait qu’à des époques déterminées il tombe des pluies
abondantes. Sa tête, qui est celle d’un jeune homme, est peut-être l’emblème de la
nature, renouvelée, et, pour ainsi dire, rajeunie au temps de l’inondation. L’immolation
du lièvre nous paroît donner quelque poids à nos conjectures. Cet animal,
lorsque le Nil sort de son lit, est obligé de quitter la plaine et de se retirer sur les
hauteurs et dans le désert. Pouvoit-on offrir un sacrifice qui caractérisât mieux cette
époque! D’ailleurs, si l’on en croit les anciens auteurs ( i) , le lièvre peut être
aussi considéré comme l’emblème de la fécondité qui doit suivre l’inondation. Les
figures à tête de serpent et à tête de grenouille annoncent que ces animaux vont
être entraînés par le Nil, qui bientôt, couvrant toute la surface de l’Egypte, ne
laissera nulle part des eaux marécageuses et stagnantes. Leur chaussure a peut-être
pour objet de faire entendre que les animaux aquatiques vont être forcés de
gagner le désert, retraite ordinaire des chacals. Cette explication devient plus probable
lorsqu’on reconnoît que les serpens ici figurés sont de ces couleuvres aquatiques
(2) que l’on trouve fréquemment dans les puits creusés sur les bords du Nil,
ou dans les eaux stagnantes, après la retraite du fleuve. La terre d’Egypte est représentée
par l’une de ces figures d’Isis qui paraissent prendre tant de part à la scène
que nous venons de décrire. Les vases offerts par le prêtre ne renferment sans doute
autre chose que les prémices de l’inondation, dont la figure d’homme à tête d’ibis (3)
est encore un signe caractéristique. Ajoutons à tous ces rapprochemens que 1 hié-
■ roglyphe de l’eau et les bouquets de lotus se trouvent répétés plusieurs fois dans
toutes les inscriptions; ce qui concourt encore à donner plus de vraisemblance a
notre explication, et tend à prouver que le tableau que nous avons décrit est la
peinture fidèle de ce qui se passe en Egypte au solstice d’été.
Nous aurons rempli notre but, si, par l’interprétation que nous venons de hasarder,
nous sommes parvenus à éveiller l’attention de ceux que ces matières intéressent
, et s’il peut en résulter une explication encore plus satisfaisante d’un des
tableaux les plus curieux qui font partie de la collection.
La pièce latérale située au sud (4) correspond parfaitement à celle du nord;
elle est également ornée de tableaux très-bien conservés (5). On n’y voit, pour
ainsi dire, que des figures d’Isis à qui l’on fait des offrandes: elles sont extrêmement
gracieuses et d’un fini parfait. Sur le mur de l’ouest, on peut remarquer que
l’une d’elles a sur la tête un scorpion qui paroît lui servir de coiffure symbolique.
( 1) J o a n n . Pier. Hieroglyphic. lib. X I I I , pag. 127, edit. (3) Voye£ l’Histoire naturelle et mythologique de 1 ibis
1626. par M. Savigny.
(2) M. Savigny, à qui nous avons fait part de notre (4) Voyez la planche ¿8 ,fig . / , en d , A . vol■ III»
conjecture, partage tout-à-fait notre opinion. (5) Voyez la planche 63, A . vol. I I I .
A . D . -