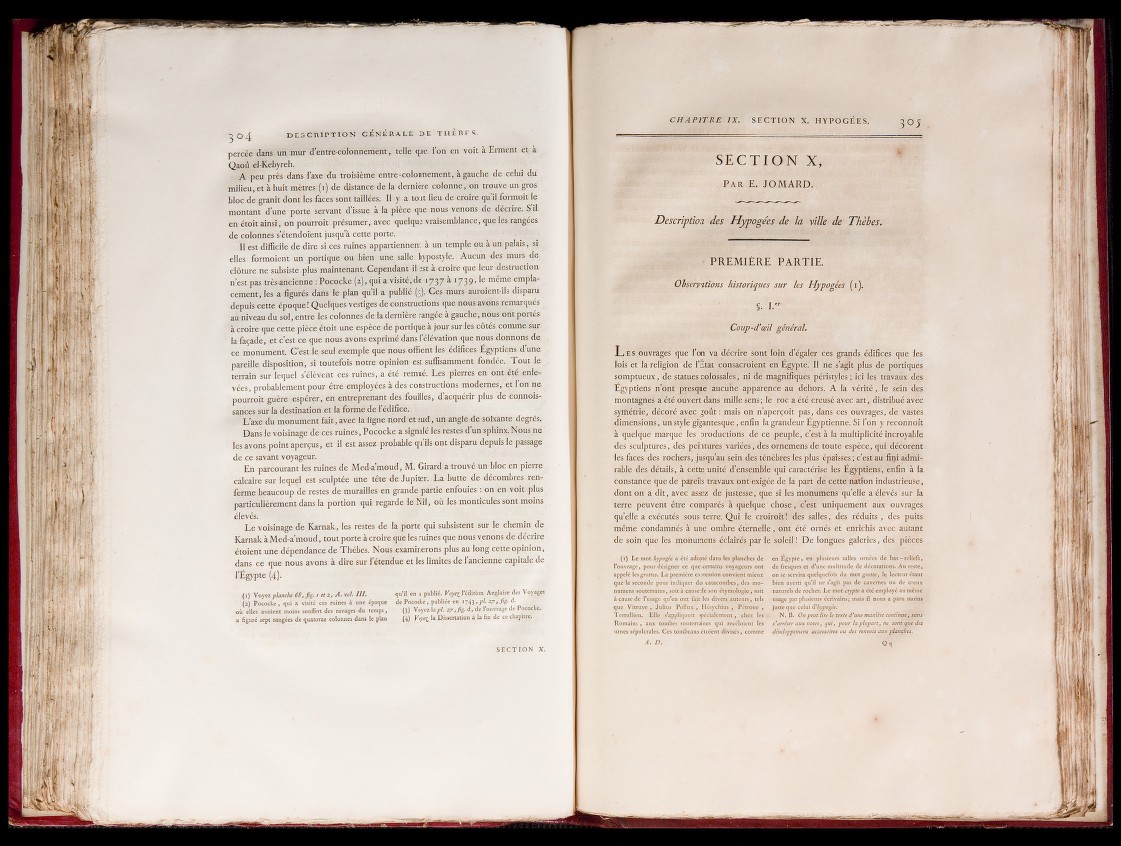
percée dans un mur d’entre-colonnement, telle que l’on en voit à Erment et à
Qaoû el-Kebyreh.
A peu près dans l’axe du troisième entre-colonnement, à gauche de celui du
milieu,« à huit mètres (i) de distance de la dernière colonne, on trouve un gros
bloc de granit dont les faces sont taillées. 11 y a tout lieu de croire qu’il formoit le
montant d’une porte servant d’issue à la pièce que nous venons de décrire. S il
en étoit ainsi, on pourroit présumer, avec quelque vraisemblance, que les rangées
de colonnes s’étendoient jusqu’à cette porte.
Il est difficile de dire si ces ruines appartiennent à un temple pu à un palais, si
elles formoient un portique ou bien une salle hypostyle. Aucun des murs de
clôture ne subsiste plus maintenant. Cependant il est a croire que leur destruction
n’est pas très-ancienne : Pococke (2), qui a visité, de 17 3 7 à 17 3 9 , le même emplacement
, les a figurés dans le plan quil a publie (3). Ces murs auroient-ils disparu
depuis cette époque! Quelques vestiges de constructions que nous avons remarques
au niveau du sol, entre ies colonnes de la derniere rangée a gauche, nous ont portes
à croire que cette pièce étoit une espece de portique a jour sur les cotés comme .sur
la façade, et c’est ce que nous avons exprimé dans l’élévation que nous donnons de
ce monument. C’est le seul exemple que nous offrent les édifices Égyptiens d’une
pareille disposition, si toutefois notre opinion est suffisamment fondée. Tout le;
terrain sur lequel s’élèvent ces ruines, a etc remue. Les pierres en ont ete enlevées,
probablement pour être employées à des constructions modernes, et l’on ne
pourroit guère espérer, en entreprenant des fouilles, d’acquérir plus de connois-
sances sur la destination et la forme de l’édifice.
L ’axe du monument fait, avec la ligne nord et sud, un angle de soixante degrés.
Dans le voisinage de ces ruines, Pococke a signale les restes d un sphinx. Nous ne
les avons point aperçus, et il est assez probable quils ont disparu depuis le passage
de ce savant voyageur.
En parcourant les ruines de Med-a’moud, M. Girard a trouve un bloc en pierre
calcaire sur lequel est sculptée une tête de Jupiter. La butte de décombres renferme
beaucoup de restes de murailles en grande partie enfouies : on en voit plus
particulièrement dans la portion qui regarde le Nil, où les monticules sont moins
élevés.
Le voisinage de Karnak, les restes de la porte qui subsistent sur le chemin de
Karnak à Med-a’moud, tout porte à croire que les ruines que nous venons de décrire
étoient une dépendance de Thèbes. Nous examinerons plus au long cette opinion,
dans ce que nous avons à dire sur l’étendue et les limites de l’ancienne capitale de
l’Égypte (4).
{ 1 ) Voyez planche 68, fi* . i a i , A . vol. I I I . qu’ il en a publié. Voyc^ J’édition Anglaise des Voyages
(z) Pococke, qui a visité ces ruines à une époque de Pococke, publiée en 1743 , pl. 2 7 , fig. d-
où elles avoient moins souffert des ravages du temps, (3) Voyez la pl. 2.7, f i g. d , de l’ouvrage de Pococke.
a figuré sept rangées de quatorze colonnes dans le plan (4) Voyez la Dissertation à la fin de ce chapitre.
S E C T IO N X .
SECTION X,
P a r E. JO M A R D .
Description des Hypogées de la ville de Thèbes.
PREMIÈRE PARTIE.
Observations historiques sur les Hypogées (i).
§. I."
Coup-d’oeil général.
L es ouvrages que l’on va décrire sont loin d’égaler ces grands édifices que les
lois et la religion de l’État consacroient en Égypte. II ne s’agit plus de portiques
somptueux, de statues colossales, ni de magnifiques péristyles ; ici les travaux des
Égyptiens n’ont presque aucune apparence au dehors. A la vérité, le sein des
montagnes a été ouvert dans mille sens; le roc a été creusé avec art, distribué avec
symétrie, décoré avec goût : mais on n’aperçoit pas, dans ces ouvrages, de vastes
dimensions, un style gigantesque, enfin la grandeur Égyptienne. Si l’on y reconnoît
à quelque marque les productions de ce peuple, c’est à la multiplicité incroyable
des sculptures, des peintures variées, des ornemens de toute espèce, qui décorent
les faces des rochers, jusqu’au sein des ténèbres les plus épaisses ; c’est au fini admirable
des détails, à cette unité d’ensemble qui caractérise les Égyptiens, enfin à la
constance que de pareils travaux ont exigée de la part de cette nation industrieuse,
dont on a dit, avec assez de justesse, que si les monumens qu’elle a élevés sur la
terre peuvent être comparés à quelque chose, c’est uniquement aux ouvrages
qu’elle a exécutés sous terre. Qui le croiroit! des salles, des réduits , des puits
même condamnés à une ombre éternelle, ont été ornés et enrichis avec autant
de soin que les monumens éclairés par le soleil ! De longues galeries, des pièces
(1) Le mot hypogée a été adopté dans les planches de
l’ouvrage, pour désigner ce que certains voyageurs ont
appelé les grottes. La première expression convient mieux
que la seconde pour indiquer des catacombes, des monumens
souterrains, soit à cause de son étymologie, soit
à cause de l’usage qu’en ont fait les divers auteurs, tels
que Vitruve , Julius PoIIux , Hésychius , Pétrone ,
Tertullien. Elle s’appliquoit spécialement, chez les *
Romains, aux tombes souterraines qui recéloient les
urnes sépulcrales. Ces tombeaux étoient divisés, comme
A . D .
en Egypte, en plusieurs salles ornées de bas - reliefs,
de fresques et d’une multitude de décorations. Au reste,
on se servira quelquefois du mot grotte, le lecteur étant
bien averti qu’il ne s’agit pas de cavernes ou de creux
naturels de rocher. Le mot crypte a été employé au même
usage par plusieurs écrivains; mais il nous a paru moins
juste que celui hypogée.
N .B . On peut lire le texte d’ une manière continue, sans
s’arrêter aux notes, qui, pour la plupart, ne sont que des
développemens accessoires ou des renvois aux planches.
Q q