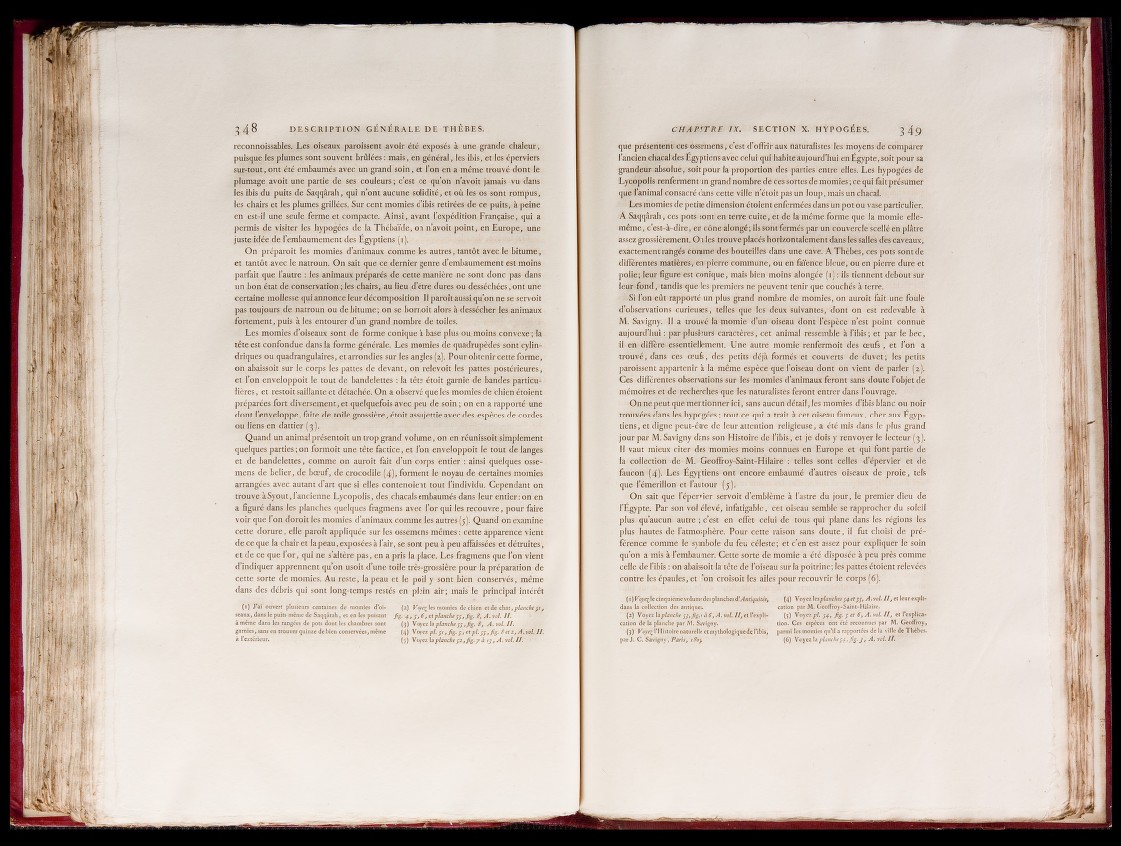
reconnoissables. Les oiseaux paraissent avoir été exposés à une grande chaleur,
puisque les plumes sont souvent brûlées : mais, en général, les ibis, et les éperviers
sur-tout, ont été embaumés avec un grand soin, et l’on en a même trouvé dont le
plumage avoit une partie de ses couleurs; c’est ce qu’on n’avoit jamais vu dans
les ibis du puits de Saqqârah, qui n’ont aucune solidité, et où les os sont rompus,
les chairs et les plumes grillées. Sur cent momies d’ibis retirées de ce puits, à peine
en est-il une seule ferme et compacte. Ainsi, avant l’expédition Française, qui a
permis de visiter les hypogées de la Thébaïde, on n’avoit point, en Europe, une
juste idée de l’embaumement des Egyptiens (1).
On préparait les momies d’animaux comme les autres, tantôt avec le bitume,
et tantôt avec le natroun. On sait que ce dernier genre d’embaumement est moins
parfait que l’autre : les animaux préparés de cette manière ne sont donc pas dans
un bon état de conservation ; les chairs, au lieu d’être dures ou desséchées, ont une
certaine mollesse qui annonce leur décomposition. Il paroît aussi qu’on ne se servoit
pas toujours de natroun ou de bitume; on se bornoit alors à dessécher les animaux
fortement, puis à les entourer d’un grand nombre de toiles.
Les momies d’oiseaux sont de forme conique à base plus ou.moins convexe; la
tête est confondue dans la forme générale. Les momies de quadrupèdes sont cylindriques
ou quadrangulaires, et arrondies sur les angles (2). Pour obtenir cette forme,
on abaissoit sur le corps les pattes de devant, on relevoit les pattes postérieures,
et l’on enveloppoit le tout de bandelettes : la tête étoit garnie de bandes particulières
, et restoit saillante et détachée. On a observé que les momies de chien étoient
préparées fort diversement, et quelquefois avec peu de soin ; on en a rapporté une
dont l’enveloppe, faite de toile grossière, étoit assujettie avec des espèces de cordes
ou liens en dattier (3).
Quand un animal présentoit un trop grand volume, on en réunissoit simplement
quelques parties;on formoit une tête factice, et l’on enveloppoit le tout de langes
et de bandelettes, comme on aurait fait d’un corps entier : ainsi quelques osse-
mens de belier, de boeuf, de crocodile (4), forment le noyau de certaines momies
arrangées avec autant d’art que si elles contenoient tout l’individu. Cependant on
trouve à Syout, l’ancienne Lycopolis, des chacals embaumés dans leur entier: on en
a figuré dans les planches quelques fragmens avec l’or qui les recouvre, pour faire
voir que l’on doroit les momies d’animaux comme les autres (5). Quand on examine
cette dorure, elle paroît appliquée sur les ossemens mêmes : cette apparence vient
de ce que la chair et lapeau, exposées à l’air, se sont peu à peu affaissées et détruites,
et de ce que l’or, qui ne s’altère pas, en a pris la place. Les fragmens que l’on vient
d’indiquer apprennent qu’on usoit d’une toile très-grossière pour la préparation de
cette sorte de momies. Au reste, la peau et le poil y sont bien conservés, même
dans des débris qui sont long-temps restés en plein air; mais le principal intérêt
(1) 'J'a i ouvert plusieurs centaines de momies d’oi- (2) V o y e ^ les momies de chien et de c h a t , p la n c h e j e ,
seaux, dans le puits même de Saqqârah, et en les puisant f i g . q , y , 6 , e t p la n c h e J J . f i g . 8 , A . v o l . I I .
à même dans les rangées de pots dont les chambres sont (3) Voyez la p l a n c h e 55 > f i g . 8 , A . v o l . I I .
garnies, sans en trouver quinze de bien conservées, même (4) Voyez p l . y / , f i g . y , et p l . yy, fig. 8 e t 2 , A . v o l . I I .
à l’extérieur. (5) Voyez p la n c h e 5 2 , f i g . 7 à i j , A . v o l . I I .
que présentent ces ossemens, c’est d’offrir aux naturalistes les moyens de comparer
l’ancien chacal des Egyptiens avec celui qui habite aujourd’hui en Egypte, soit pour sa
grandeur absolue, soit pour la proportion des parties entre elles. Les hypogées de
Lycopolis renferment un grand nombre de ces sortes de momies ; ce qui fait présumer
que l’animal consacré dans cette ville n’étoit pas un loup, mais un chacal.
Les momies de petite dimension étoient enfermées dans Un pot ou vase particulier.
A Saqqârah, ces pots sont en terre cuite, et de la même forme que la momie elle-
meme, c’est-à-dire, en cône alongé; ils Sont fermés par un couvercle scellé en plâtre
assez grossièrement. On les trouve placés horizontalement dans les salles des caveaux,
exactement rangés comme des bouteilles dans une cave. A Thèbes, ces pots sont de
différentes matières, en pierre commune, ou en faïence bleue, ou en pierre dure et
polie; leur figure est conique, mais bien moins alongée (1) : ils tiennent debout sur
leur fond, tandis que les premiers ne peuvent tenir que couchés à terre.
Si l’on eût rapporté un plus grand nombre de momies, on auroit fait une foulé
d’observations curieuses, telles que les deux suivantes, dont on est redevable à
M. Savigny. II a trouvé la momie d’un oiseau dont l’éspèce n’est point connuè
aujourd’hui : par plusieurs caractères, cet animal ressemble à l’ibis; et par le bec,
il en diffère essentiellement. Une autre momie renfermoit des oeufs, et fort a
trouvé, dans ces oeufs, des petits déjà formés et couverts de duvet; les petits
paraissent appartenir à la même espèce que l’oiseau dont on vient de parler (2).
Ces différentes observations sur les momies d’animaux feront sans doute l’objet de
mémoires et de recherches que les naturalistes feront entrer dans l’ouvrage.
On ne peut que mentionner ici, sans aucun détail, les momies d’ibis blanc ou noir
trouvées dans les hypogées ; tout ce qui a trait à cet oiseau fameux, cher aux Egyptiens,
et digne peut-être de leur attention religieuse, a été mis dans le plus grand
jour par M. Savigny dans son Histoire de l’ibis, et je dois y renvoyer le lecteur (3).
Il vaut mieux citer des momies moins connues en Europe et qui font partie de
la collection de M. Geoffroy-Saint-Hilaire : telles sont celles d’épervier et de
faucon (4). Les Egyptiens ont encore embaumé d’autres oiseaux de proie, tels
que l’émerillon et l’autour (y).
On sait que l’épervier servoit d’emblème à l’astre du jour, le premier dieu de
l’Egypte. Par son vol élevé, infatigable, cet oiseau semble se rapprocher du soleil
plus qu’aucun autre ; c’est en effet celui de tous qui plane dans les régions les
plus hautes de l’atmosphère. Pour- cette raison sans doute, il fut choisi de préférence
comme le symbole du feu céleste; et c’en est assez pour expliquer le soin
qu’on a mis à l’embaumer. Cette sorte de momie a été disposée à peu près comme
celle de l’ibis : on abaissoit la tête de l’oiseau sur la poitrine; les pattes étoient relevées
contre les épaules, et l’on croisoit les ailes pour recouvrir le corps (6).
( i ) Voye1 le cinquième volume des planches d’Antiquités, (4) Voyez les planches jq. et yy, A . vol. I I , et leur explidans
la collection des antiques. cation par M. Geoffroy-Saint-Hilaire.
(2) Voyez \nplanche j j , fig. / à 6 , A . vol. I I , et I’expli- (5) Voyez pl. 5 4 , fig. y et 6, A . vol. I l , et l’explicacation
dè la planche par M. Savigny. tion. Ces espèces ont été reconnues par M. Geoffroy,
(3) Voye^ l’Histoire naturelle et mythologique de l’ibis, parmi les momies qu’il a rapportées de la ville de Thèbes.
par J . G. Savigny, Paris, 180y. (6) Voyez la planche 94, fig. j , A , vói. I I .