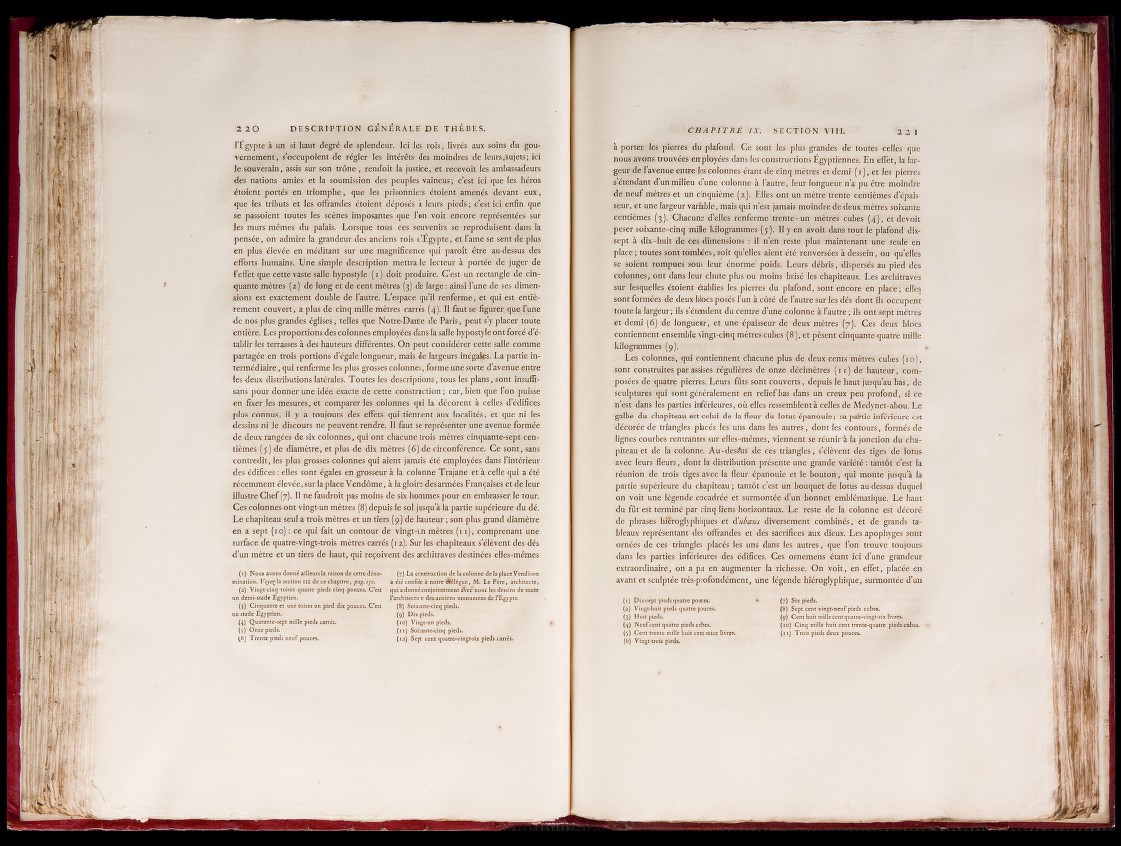
l’Egypte à un si haut degré de splendeur. Ici les rois, livrés aux soins du gouvernement,
s’occupoient de régler les intérêts des moindres de leurs.Sujets; ici
Je souverain, assis sur son trône, rendoit la justice, et recévoit les ambassadeurs
des nations amies et la soumission des peuples vaincus; c’est ici nue les héros
étoient portés en triomphe, que les prisonniers étoient amenés devant eux,
que les tributs et les offrandes étoient déposés à leurs pieds ; c’est ici enfin que
se passoient toutes les scènes imposantes que l’on voit encore représentées sur
Jes murs mêmes du palais. Lorsque tous ces souvenirs se reproduisent dans la
pensée, on admire la grandeur des anciens rois d’Egypte, et l’ame se sent de plus
en plus élevée en méditant sur une magnificence qui paroît être au-dessus des
efforts humains. Une simple description mettra le lecteur à portée de juger de
l’effet que cette vaste salle hypostyle ( i ) doit produire. C’est un rectangle de cinquante
mètres (2) de long et de cent mètres (3) de large: ainsi l’une de ses dimensions
est exactement double de l’autre. L ’espace qu’il renferme, et qui est entièrement
couvert, a plus de cinq mille mètres carrés (4). Il faut se figurer que l’une
de nos plus grandes églises, telles que Notre-Dame de Paris, peut s’y placer toute
entière. Les proportions des colonnes employées dans la salle hypostyle ont forcé d’établir
les terrasses à des hauteurs différentes. On peut considérer cette salle comme
partagée en trois portions d’égale longueur, mais de largeurs inégales. La partie intermédiaire
, qui renferme les plus grosses colonnes, forme une sorte d’avenue entre
les deux distributions latérales. Toutes les descriptions, tous les plans, sont insuffi-
sans pour donner une idée exacte de cette construction ; car, bien que l’on puisse
en fixer les mesures, et comparer les colonnes qui la décorent à celles d’édifices
plus connus, il y a toujours des effets qui tiennent aux localités, et que ni les
dessins ni le discours ne peuvent rendre. Il faut se représenter une avenue formée
de deux rangées de six colonnes, qui ont chacune trois mètres cinquante-sept centièmes
(5) de diamètre, et plus de dix mètres (6) de circonférence. Ce sont, sans
contredit, les plus grosses colonnes qui aient jamais été employées dans l’intérieur
des édifices : elles sont égales en grosseur à la colonne Trajane et à celle qui a été
récemment élevée, sur la place Vendôme, à la gloire des armées Françaises et de leur
illustre Chef (7). Il ne faudroit pas moins de six hommes pour en embrasser le tour.
Ces colonnes ont vmgt-un mètres (8) depuis le sol jusqu’à la partie supérieure du dé.
Le chapiteau seul a trois mètres et un tiers (9) de hauteur ; son plus grand diamètre
en a sept (10) : ce qui fait un contour de vmgt-un mètres ( 11) , comprenant une
surface de quatre-vingt-trois mètres carrés (r 2). Sur les chapiteaux s’élèvent des dés
d’un mètre et un tiers de haut, qui reçoivent des architraves destinées elles-mêmes
(1) Nous avons donné ailleurs la raison de cette déno- (7) La construction de la colonne de la place Vendôme
mination. Voyez la section III de ce chapitre, pag. rjo. a été confiée à notre dbllègue, M. Le Père, architecte,
(2) Vingt-cinq toises quatre pieds cinq pouces. C ’est qui adonné conjointement avec nous les dessins de toute
un demi-rstade Egyptien. l’architecture de& anciens monumens de l’Egypte.
(3) Cinquante et une toises un pied dix pouces. C ’est (8) Soixante-cinq pieds,
un stade Egyptien. (9) Dix pieds.
(4) Quarante-sept mille pieds carrés. (10) Vingt-un pieds.
(5) Onze pieds. ( 11) Soixante-cinq pieds.
^6) Trente pieds neuf pouces. (12) Sept cent quatre-vingt-six pieds carrés.
à porter les pierres du plafond. Ce sont les plus grandes de toutes celles que
nous avons trouvées employées dans les constructions Égyptiennes. En effet, la largeur
de 1 avenue entre les colonnes étant de cinq mètres et demi ( ) ), et les pierres
s étendant d’un milieu d’une colonne à l’autre, leur longueur n’a pu être moindre
de neuf mètres et un cinquième (2). Elles ont un mètre trente centièmes d’épaisseur,
et une largeur variable, mais qui n’est jamais moindre de deux mètres soixante
centièmes (3). Chacune d’elles renferme trente-un mètres cubes (4), et devoit
peser soixante-cinq mille kilogrammes (5). 11 y en avoit dans tout le plafond dix-
sept à dix-huit de ces dimensions : il n’en reste plus maintenant une seule en
place ; toutes sont tombées, soit qu’elles aient été renversées à dessein, ou qu’elles
se soient rompues sous leur énorme poids. Leurs débris, dispersés au pied des
colonnes, ont dans leur chute plus ou moins brisé les chapiteaux. Les architraves
sur lesquelles étoient établies les pierres du plafond, sont encore en place ; elles
sont formées de deux blocs posés l’un à côté de l’autre sur les dés dont ils occupent
toute la largeur; ils s’étendent du centre d’une colonne à l’autre ; ils ont sept mètres
et demi (6) de longueur, et une épaisseur de deux mètres (7). Ces deux blocs
contiennent ensemble vingt-cinq mètres cubes (8), et pèsent cinquante-quatre mille
kilogrammes (9). •
Les colonnes, qui contiennent chacune plus de deux cents mètres cubes (10),
sont construites par assises régulières de onze décimètres ( 1 1 ) de hauteur, composées
de quatre pierres. Leurs fûts sont couverts, depuis le haut jusqu’au bas, de
sculptures qui sont généralement en relief bas dans un creux peu profond, si ce
n’est dans les parties inférieures, où elles ressemblentà celles de Medynet-abou. Le
galbe du chapiteau est celui de la fleur du lotus épanouie ; sa partie inférieure est
décorée de triangles placés les uns dans les autres, dont les contours, formés de
lignes courbes rentrantes sur elles-mêmes, viennent se réunir’à la jonction du chapiteau
et de la colonne. Au-dessus de ces triangles, s’élèvent des tiges de lotus
avec leurs fleurs, dont la distribution présente une grande variété : tantôt c’est la
réunion de trois tiges avec la fleur épanouie et le bouton, qui monte jusqu’à la
partie supérieure du chapiteau ; tantôt c’est un bouquet de lotus au-dessus duquel
on voit une légende encadrée et surmontée d’un bonnet emblématique. Le haut
du fût est terminé par cinq liens horizontaux. Le reste de la colonne est décoré
de phrases hiéroglyphiques et Suboeus diversement combinés, et de grands tableaux
représentant des offrandes et des sacrifices aux dieux. Les apophyges sont
ornées de ces triangles placés les uns dans les autres, que l’on trouve toujours
dans les parties inférieures des édifices. Ces ornemens étant ici d’une grandeur
extraordinaire, on a pu en augmenter la richesse. On voit, en effet, placée en
avant et sculptée très-profondément, une légende hiéroglyphique, surmontée d’un
(1) Dix-sept pieds quatre poucés. ► (7) Six pieds.
(2) Vingt-huit pieds quatre pouces. (8) Sept cent vingt-neuf pieds cubes.
(3) Huit pieds. (9) Cent huit mille cent quatre-vingt-six livres.
(4) Neuf cent quatre pieds cubes. (10) Cinq mille huit cent trente-quatre pieds cubes
(5) Cent trente mille huit cent seize livres-. ( 11) Trois pieds deux pouces.
(6) Vingt-trois pieds.