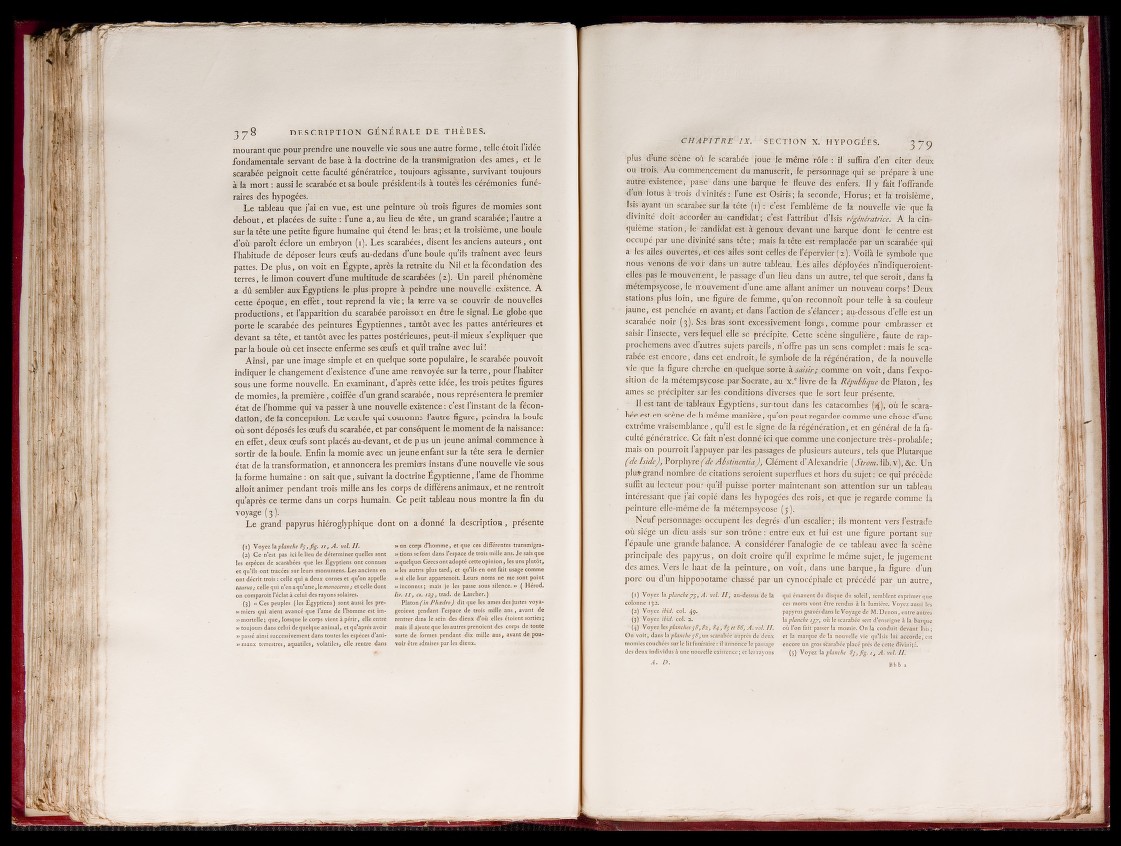
mourant que pour prendre une nouvelle vie sous une autre forme, telle étoit l’idée
fondamentale servant de base à la doctrine de la transmigration des âmes, et le
scarabée peignoit cette faculté génératrice, toujours agissante, survivant toujours
à la mort : aussi le scarabée et sa boule président-ils à toutes les cérémonies funéraires
des hypogées.
Le tableau que j’ai en vue, est une peinture où trois figures de momies sont
debout, et placées de suite : l’une a, au lieu de tête, un grand scarabée ; l’autre a
sur la tête une petite figure humaine qui étend les bras; et la troisième, une boule
d’où paroît éclore un embryon (1). Les scarabées, disent les anciens auteurs, ont
l’habitude de déposer leurs oeufs au-dedans d’une boule qu’ils traînent avec leurs
pattes. De plus, on voit en Égypte, après la retraite du Nil et la fécondation des
terres, le limon couvert d’une multitude de scarabées (2). Un pareil phénomène
a dû sembler aux Égyptiens le plus propre à peindre une nouvelle existence. A
cette époque, en effet, tout reprend la vie ; la terre va se couvrir de nouvelles
productions, et l’apparition du scarabée paroissoit en être le signal. Le globe que
porte le scarabée des peintures Égyptiennes, tantôt avec les pattes antérieures et
devant sa tête, et tantôt avec les pattes postérieures, peut-il mieux s’expliquer que
par la boule où cet insecte enferme ses oeufs et qu’il traîne avec lui !
Ainsi, par une image simple et en quelque sorte populaire, le scarabée pouvoit
indiquer le changement d’existence d’une ame renvoyée sur la terre, pour l’habiter
sous une forme nouvelle. En examinant, d’après cette idée, les trois petites figures
de momies, la première, coiffée d’un grand scarabée, nous représentera le premier
état de l’homme qui va passer à une nouvelle existence : c est 1 instant de la fécondation,
de la conception. Le cercle qui couronne l’autre figure, peindra la boule
où sont déposés les oeufs du scarabée, et par conséquent le moment de la naissance:
en effet, deux oeufs sont placés au-devant, et de plus un jeune animal commence a
sortir de la boule. Enfin la momie avec un jeune enfant sur la tête sera le dernier
état de la transformation, et annoncera les premiers instans d’une nouvelle vie sous
la forme humaine : on sait que, suivant la doctrine Égyptienne, 1 ame de 1 homme
alloit animer pendant trois mille ans les corps de différens animaux, et ne rentroit
qu’après ce terme dans un corps humain. Ce petit tableau nous montre la fin du
voyage (3). ^
Le grand papyrus hiéroglyphique dont on a donné la description, présente
(1) Voyez la planche 85, f i g. / / , A . vol. I I .
(2) Ce n’est pas ici le lieu de déterminer quelles sont
les espèces de scarabées que les Egyptiens ont connues
et qu’ils ont tracées sur leurs monumens. Les anciens en
ont décrit trois : celle qui a deux cornes et qu’on appelle
taurus; celle qui n’en a qu’une, le monoceros; et celle dont
on comparait l’éclat à celui des rayons solaires.
(3) « Ces peuples (des Egyptiens) sont aussi les pre-
» miers qui aient avancé que l’ame de l’homme est im-
« mortelle; que, lorsque le corps vient à périr, elle entre
« toujours dans celui de quelque animal, et qu’après avoir
» passé ainsi successivement dans toutes les espèces d’animaux
terrestres, aquatiles, volatiles, elle rentre dans
» un corps d’homme, et que ces différentes transmigra-
» tions se font dans l’ espace de trois mille ans. J e sais que
» quelques Grecs ont adopté cette opinion, les uns plutôt,
»les autres plus tard, et qu’ ils en ont fait usage comme
» s i elle leur appartenoit. Leurs noms ne me sont point
» inconnus ; mais je les passe sous silence. » ( Hérod.
liv. 1 1 , ch. 12 3 , trad. de Larcher.)
Platon (in Phoedro) dit que les ames des justes voya-
geoient pendant l’espace de trois mille ans, avant de
rentrer dans le sein des dieux d’où elles étoient sorties ;
mais il ajoute que les autres prenoient des corps de toute
sorte de formes pendant dix mille ans, avant de pouvoir
être admises par les dieux.
plus d-une scene ou le scarabée joue le même rôle : il suffira d’en citer deux
ou trois. Au commencement du manuscrit, le personnage qui se prépare à une
autre existence, passe dans une barque le fleuve des enfers. Il y fait l’offrande
dun lotus à trois divinités: l’une est Osiris; la seconde, Horus; et la troisième,
Isis ayant un scarabée sur la tête (1) : c’est l’emblème de la nouvelle vie que la
divinité doit accorder au candidat ; c’est l’attribut d’Isis régénératrice. A la cinquième
station, le^ candidat est à genoux devant une barque dont le centre est
occupé par une divinité sans tête ; mais la tête est remplacée par un scarabée qui
a les ailes ouvertes, et ces ailes sont celles de l’épervier (2). Voilà le symbole que
nous venons de voir dans un autre tableau. Lès ailes déployées n’indiqueroient-
elles pas le mouvement, le passage d’un lieu dans un autre, tel que seroit, dans la
métempsycose, le mouvement dune ame allant animer un nouveau corps! Deux
stations plus loin, une figure de femme, qu’on reconnoît pour telle à sa couleur
jaune, est penchee en avant; et dans 1 action de s’élancer; au-dessous d’elle est un
scarabée noir (3). Ses bras sont excessivement longs, compte pour embrasser et
saisir Iinsecte, vers lequel elle se précipite. Cette scène singulière, faute de rap-
prochemens avec d autres sujets pareils, n’offre pas un sens complet : mais le scarabée
est encore, dans cet endroit, le symbole de la régénération, de la nouvelle
vie que la figure cherche en quelque sorte à saisir; comme on voit, dans l’exposition
de la métempsycose par Socrate, au x .e livre de la République de Platon, les
ames se précipiter sur les conditions diverses que le sort leur présente.
Il est tant de tableaux Égyptiens, sur tout dans les catacombes (if), où le scarabée
est en scène de la même manière, qu’on peut regarder comme une chose d’une
extrême vraisemblance, qu'il est le signe de la régénération, et en général de la faculté
génératrice. Ce fait n’est donné ici que comme une conjecture très-probable;
mais on pourroit l’appuyer par les passages de plusieurs auteurs, tels que Plutarque
( de Iside), Porphyre ( de Abstinentia) , Clément d’Alexandrie (Strom. lib. v), &c. Un
plus-grand nombre de citations seroient superflues et hors du sujet : ce qui précède
suffit au lecteur pour qu’il puisse porter maintenant son attention sur un tableau
intéressant que j’ai copié dans les hypogées des rois, et que je regarde comme la
peinture elle-même de la métempsycose (5).
Neuf personnages occupent les degrés d’un escalier; ils montent vers l’estrade
où siège un dieu assis sur son trône : entre eux et lui est une figure portant sur
l’épaule une grande balance. A considérer l’analogie de ce tableau avec la scène
principale des papyrus, on doit croire qu’il exprime le même sujet,-le jugement
des ames. Vers le haut de la peinture, on voit, dans une barque, la figure d’un
porc ou d’un hippopotame chassé par un cynocéphale et précédé par un autre,
(1 ) Voyez la planche7 5 , A . vol. I I , au-dessus de la qui émanent du disque du soleil, semblent exprimer que
colonne 132. ces morts vont être rendus à la lumière. Voyez aussi les
(2) Voyez ibid. col. 49* papyrus gravés dans le Voyage de M.Denon, entre autres
(3) Voyez ibid. col. 2. la planche 137, où le scarabée sert d’enseigne à la barque
(4) Voyez les planches$8 , 82, 84, 85 et 86, A . vol. I I . où l’on fait passer la momie. On la conduit devant Isis ;
On voit, dans la planche38 , un scarabée auprès de deux et la marque de la nouvelle vie qu’ Isis lui accorde, est
momies couchées sur le lit funéraire : il annonce le passage encore un gros starabée placé près de cette divinité.*
des deux individus à une nouvelle existence ; et les rayons (5) Voyez la planche 83, fig. 1 , A . vol. I I .
A ‘ D - Bb b *