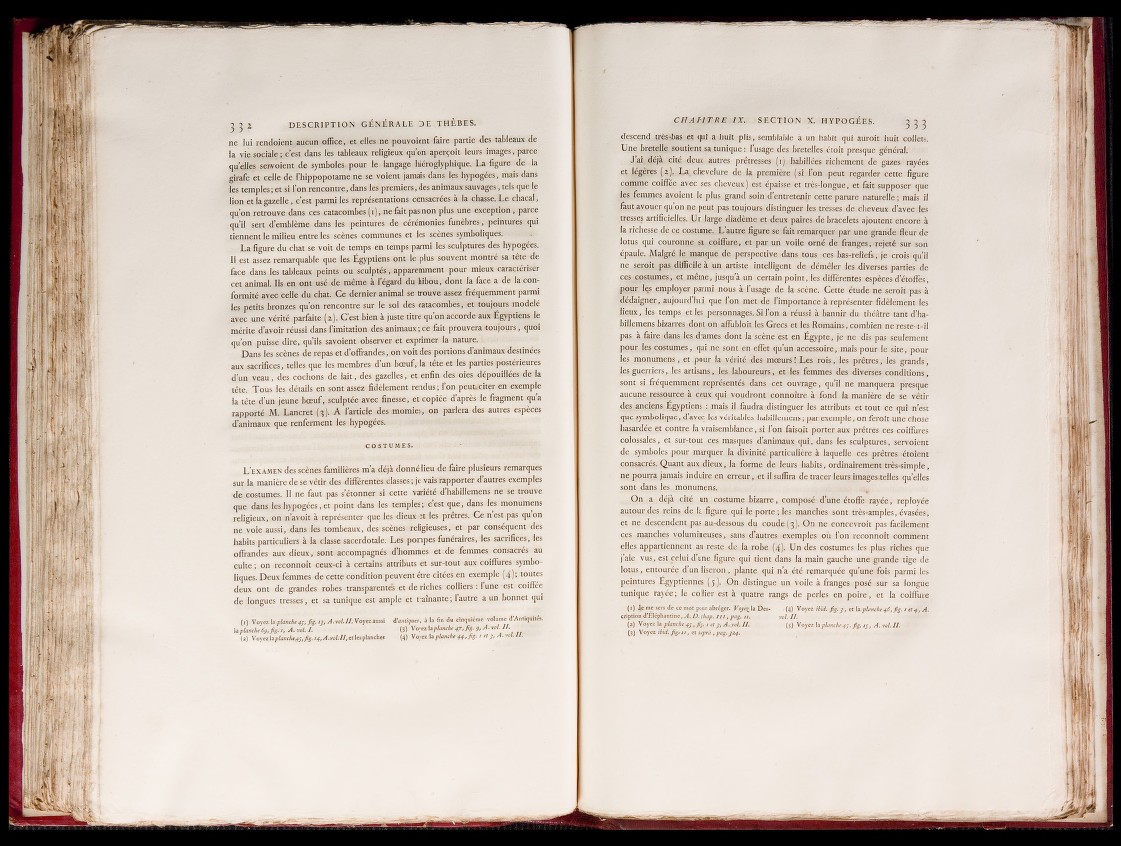
ne lui rendoient aucun office, et elles ne pouvoient faire partie des tableaux de
la vie sociale ; c’est dans les tableaux religieux qu’on aperçoit leurs images, parce
qu’elles sewoient de symboles- pour le langage hiéroglyphique. La figure de la
girafe et celle de l’hippopotame ne se voient jamais dans les hypogées, mais dans
les temples ; et si l’on rencontre, dans les premiers, des animaux sauvages, tels que le
lion et la gazelle, c’est parmi les représentations consacrées a la chasse. Le chacal,
qu’on retrouve dans ces catacombes ( i ), ne fait pas non plus une exception, parce
qu’il sert d’emblème dans les peintures de cérémonies funebres, peintures qui
tiennent le milieu entre les scènes communes et les scenes symboliques.
La figure du chat se voit de temps en temps parmi les sculptures des hypogees.
Il est assez remarquable que les Égyptiens ont le plus souvent montré sa tete de
face dans les tableaux peints ou sculptés, apparemment pour mieux caractéi iseï
cet animal. Ils en ont usé de même à 1 égard du hibou, dont la face a de la conformité
avec celle du chat. Ce dernier animal se trouve assez fréquemment parmi
les petits bronzes qu’on rencontre sur le sol des catacombes, et toujours modelé
avec une vérité parfaite (2). C’est bien à juste titre qu’on accorde aux Égyptiens le
mérite d’avoir réussi dans 1 imitation des animaux ; ce fait prouvera -toujours} quoi
qu’on puisse dire, qu’ils savoient observer et exprimer la nature.
Dans les scènes de repas et d’offrandes, on voit des portions d animaux destmees
aux sacrifices, telles que les membres d’un boeuf, la tête et les parties postérieures
d’un veau, des cochons de lait, des gazelles, et enfin des oies dépouillées de la
tête. Tous les détails en sont assez fidèlement rendus; l’on peut.citer en exemple
la tête d’un jeune boeuf, sculptée avec finesse, et copiée d’après le fragment qu’a
rapporté M. Lancret (3). A l’article des momies, on parlera des autres espèces
d’animaux que renferment les hypogées.
C O S T U M E S .
L ’e x ame n des scènes familières m’a déjà donné lieu de faire plusieurs remarques
sur la manière de se vêtir des différentes classes ; je vais rapporter d autres exemples
de costumes. II ne faut pas s’étonner si cette variété dhabillemens ne se trouve
que dans les hypogées, et point dans les temples; cest que, dans les monumens
religieux, on n’avoit à représenter que les dieux et les pretres. Ce nest pas quon
ne voie aussi, dans les tombeaux, des scènes religieuses, et par conséquent des
habits particuliers à la classe sacerdotale. Les pompes funéraires, les sacrifices, les
offrandes aux dieux, sont accompagnés d’hommes et de femmes consacrés au
culte ; on reconnoît ceux-ci à certains attributs et sur-tout aux coiffures symboliques.
Deux femmes de cette condition peuvent etre citees en exemple (4 ); toutes
deux ont de grandes robes transparentes et de riches colliers : 1 une est coiffée
de longues tresses, et sa tunique est ample et traînante ; 1 autre a un bonnet qui
( ,) Voyez la planche 45, fig. 13, A . vol.II. Voyez aussi Sctnûiju,, , à la fin du cinquième volume d'Antiquités.
la planche ip , fig. f , A . vol. I . (3) Voyez la ?W /te 4 7 ,fig. p, A . vol.I I .
(z) Voyez \aplanc/te/fp, fig . r^ A .v o L I / , et iesplanches (4) Voyez la planche 4 4 , fis. ' a f i A - vo i U -
descend très-bas et qui a huit plis, semblable à un habit qui auroit huit collets.
Une bretelle soutient sa tunique : 1 usage des bretelles étoit presque générai.
J a i deja cite deux autres prêtresses (1) habillées richement de gazes rayées
et légères (2). La chevelure de la première (si l’on peut regarder cette figure
comme coiffée avec ses cheveux) est épaisse et très-longue, et fait supposer que
les femmes avoient le plus grand soin d’entretenir cette parure naturelle ; mais il
faut avouer qu on ne peut pas toujours distinguer les tresses de cheveux d’avec les
tresses artificielles. Un large diadème et deux paires de bracelets ajoutent encore à
la richesse de ce costume. L ’autre figure se fait remarquer par une grande fleur de
lotus qui couronne sa coiffure, et par un voile orné de franges, rejeté sur son
épaule. Malgré le manque de perspective dans tous ces bas-reliefs, je crois qu’il
11e seroit pas difficile à un artiste intelligent de démêler les diverses parties de
ces costumes, et même, jusqu’à un certain point, les différentes espèces d’étoffes,
pour Iqs employer parmi nous a I usage de la scène. Cette étude ne seroit pas à
dédaigner, aujourd hui que 1 on met de l’importance à représenter fidèlement les
lieux, les temps et les personnages. Si l’on a réussi à bannir du théâtre tant d’ha-
billemens bizarres dont on affubloit les Grecs et les Romains, combien ne reste-t-il
pas a faire dans les drames dont la scène est en Égypte, je ne dis pas seulement
pour les costumes, qui ne sont en effet qu’un accessoire, mais pour le site, pour
les monumens, et pour la vérité des moeurS î Les rois, les prêtres, les grands,
les guerriers, les artisans, les laboureurs, et les femmes des diverses conditions,
sont si fréquemment représentés dans cet ouvrage , qu’il ne manquera presque
aucune ressource à ceux qui voudront connoître à fond la manière de se vêtir
des anciens Égyptiens : mais il faudra distinguer les attributs et tout ce qui n’est
que symbolique, d’avec les véritables habillemens ; par exemple, on feroit une chose
hasardée et contre la vraisemblance, si l’on faiso.it porter aux prêtres ces coiffures
colossales, et sur-tout ces masques d’animaux qui, dans les sculptures, servoient
de symboles pour marquer la divinité particulière à laquelle ces prêtres étoient
consacrés. Quant aux dieux, la forme de leurs habits, ordinairement très-shnpie,
ne pourra jamais induire en erreur, et il suffira de tracer leurs hnages.telles qu’elles
sont dans les monumens.
On a déjà cité un costume bizarre, composé d’une étoffe rayée, reployée
autour des reins de la figure qui le porte ; les manches sont très-amples, évasées,
et ne descendent pas au-dessous du coude (3). On ne concevroit pas facilement
ces manches volumineuses, sans d’autres exemples où l’on reconnoît comment
elles appartiennent au reste de la robe (4). Un des costumes les plus riches que
j’aie vus, est celui d’une figure qui tient dans la main gauche une grande tige de
lotus, entourée d’un liseron, plante qui n’a été remarquée qu’une fois parmi les
peintures Égyptiennes ( 5 ). On distingue un voile à franges posé sur sa longue
tunique rayée ; le collier est à quatre rangs de perles en poire, et la coiffure
(1) 4e me sers de ce mot pour abréger. Voye^ la Des- .(4) Voyez itid. f i g . j , et la planche 46, fig. r a 4 , A.
ciiption d’EIéphantine, A . D . c/iap, I II , pag. ir. vol. II .
(z) Voyezla planche 4 , , fig. r et 3 , A . vol. U . (y) Voyez \i planche 4 ; . fig. A . vo l.II.
(3) Voyez ïbid. fig . 1 1 f et suprà , pag.,2 4 .