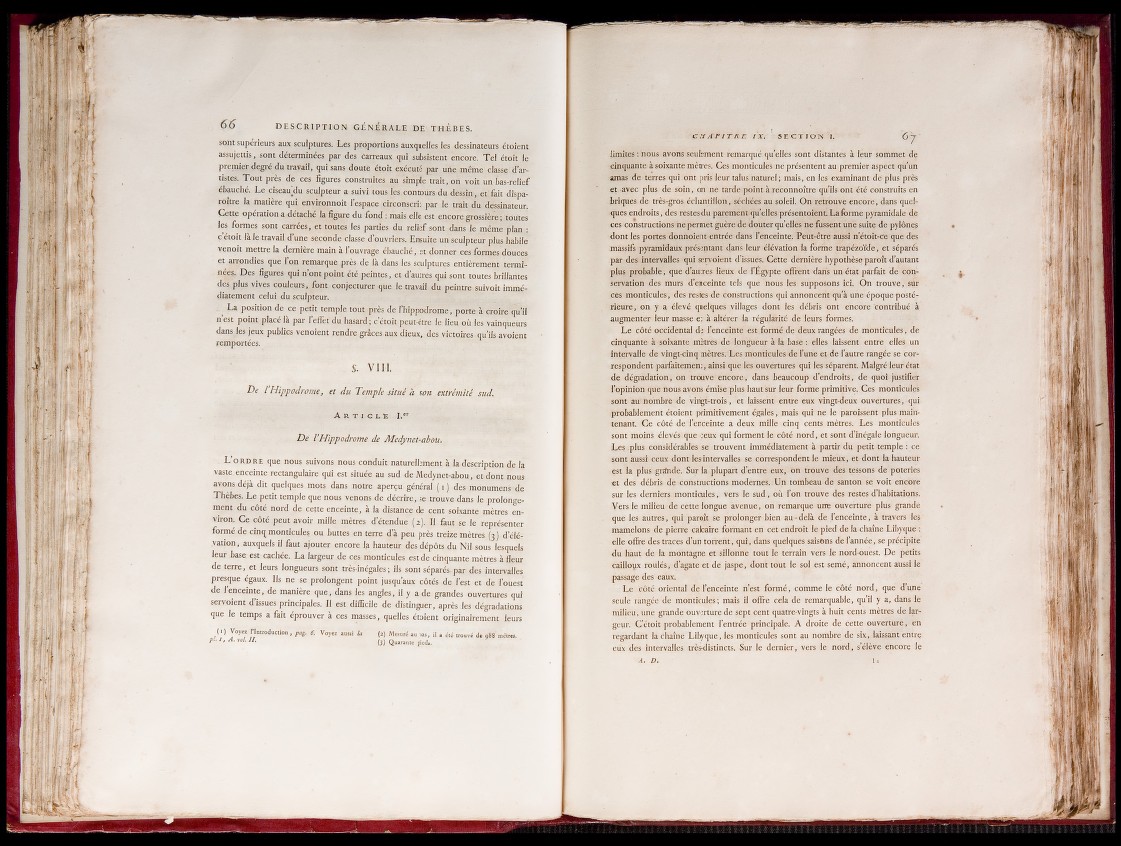
sont supérieurs aux sculptures. Les proportions auxquelles les dessinateurs étoient
assujettis, sont déterminées par des Carreaux qui subsistent encore. Tel étoit le
pi entier degre du travail, qui sans doute étoit exécuté par une même classe d’artistes.
Tout piès de ces figures construites au simple trait, on voit un bas-relief
ébauche. Le ciseau_du sculpteur a suivi tous les.contours du dèssin, et'fait dispa-
roitre la matière qui environnoit l’espace circonscrit par le trait du dessinateur.
Cette opération a détaché la figure du fond : mais elle est encore grossière ; toutes
les formes sont carrées, et toutes les parties du relief sont dans Je même plan :
c’étoit là le travail d’une seconde classe d’ouvriers. Ensuite un sculpteur plus habile
venoit mettre la derniere main à l’ouvrage ébauché, et donner ces formes douces
et arrondies que 1 on remarque près de là dans les sculptures entièrement terminées.
Des figures qui n ont point été peintes, et d’autres qui sont toutes brillantes
des plus vives couleurs, font conjecturer que le travail du peintre suivoit immédiatement
celui du sculpteur.
) La Position de ce petit temple tout près de l’hippodrome, porte à croire qu’il
n est point placé là par l’effet du hasard ; c’étoit peut-être le lieu où les vainqueurs
dans les jeux publics venoient rendre grâces aux dieux, des victoires qu’ils avoient
remportées.
S- V I I I.
De l Hippodrome, et du Temple situé à son extrémité sud.
A r t i c l e I . "
D e l ’Hippodrome de Medynet-aboll,
L ORDRE que nous suivons nous conduit naturellement à la description de la
vaste, enceinte rectangulaire qui est située au sud de Medynet-abou, et dont nous
avons déjà dit quelques mots dans notre aperçu général ( i ) des monumens de
Thèbes. Le petit temple que nous venons de décrire, se trouve dans le prolongement
du côté nord de cette enceinte, à la distance de cent soixante mètres environ.
Ce côté peut avoir mille mètres d’étendue (a). Il faut se le représenter
forme de cinq monticules ou buttes en terre d’à peu près treize mètres (3 ) d’élér
.vation, auxquels il faut ajouter encore la hauteur des dépôts du Nil sous lesquels
leur base est cachée. La largeur de ces monticules est de cinquante mètres à fleur
de terre, et leurs longueurs sont très-inégales; ils sont séparés.par des intervalles
presque égaux. Ils ne se prolongent point jusqu’aux côtés de l’est et de l’ouest
de l’enceinte, de manière que, dans les angles, il y a de grandes ouvertures qui
servoient d’issues principales. Il est difficile de distinguer, après les dégradations
que le temps a fait éprouver à ces masses, quelles étoient originairement leurs
( 1 ) Voyez l’Introduction, pag, 6. Voyez aussi la (z) Mesuré au pas, il a été trouvé de 988 métrés.
p i / , A . vol. I I . (3) Quarante pieds.
limites : nous avons seulement remarqué qu’elles sont distantes à leur sommet de
cinquante à soixante mètres. Ces monticules ne présentent au premier aspect qu’un
amas de terres qui ont pris leur talus naturel; mais, en les examinant de plus près
et avec plus de soin, on ne tarde point à reconnoître qu’ils ont été construits en
briques de très-gros échantillon, séchées au soleil. On retrouve encore, dans quelques
endroits, des restes du parement qu’elles présentoient. La forme pyramidale de
ces constructions ne permet guère de douter qu’elles ne fussent une suite de pylônes
dont les portes donnoient entrée dans l’enceinte. Peut-être aussi n’étoit-ce que des
massifs pyramidatix présentant dans leur élévation la forme trapézoïde, et séparés
par des intervalles qui servoient d’issues. Cette dernière hypothèse paroît d’autant
plus probable, que d’autres lieux de l’Egypte offrent dans un état parfait de conservation
des murs d’enceinte tels que nous les supposons ici. On trouve, sur
ces monticules, des restes de constructions qui annoncent qu’à une époque postérieure,
on y a élevé quelques villages dont les débris ont encore contribué à
augmenter leur masse et à altérer la régularité de leurs formes.
Le côté occidental de l’enceinte est .formé de deux rangées de monticules, de
cinquante à soixante mètres de longueur à la base : elles laissent entre elles un
intervalle de vingt-cinq mètres. Les monticules de l’une et de l’autre rangée se correspondent
parfaitement, ainsi que les ouvertures qui les séparent. Malgré leur état
de dégradation, on trouve encore, dans beaucoup d’endroits, de quoi justifier
l’opinion que nous avons émise plus haut sur leur forme primitive. Ces monticules
sont au nombre de vingt-trois, et laissent entre eux vingt-deux ouvertures, qui
probablement étoient primitivement égales, mais qui ne le paroissent plus maintenant.
Ce côté de l’enceinte a deux mille cinq cents mètres. Les monticules
sont moins élevés que ceux qui forment le côté nord, et sont d’inégale longueur.
Les plus considérables se trouvent immédiatement à partir du petit temple : ce
sont aussi ceux dont les intervalles se correspondent le mieux, et dont la hauteur
est la plus gntnde. Sur la plupart d’entre eux, on trouve des tessons de poteries
et des débris de constructions modernes. Un tombeau de santon se voit encore
sur les derniers monticules, vers le sud, où l’on trouve des restes d’habitations.
Vers le milieu de cette longue avenue, on remarque une ouverture plus grande
que les autres, qui paroît se prolonger bien au-delà de l’enceinte, à travers les
mamelons de pierre calcaire formant en cet endroit le pied de la chaîne Libyque :
elle offre des traces d’un torrent, qui, dans quelques saisons de l’année, se précipite
du haut de la montagne et sillonne tout le terrain vers le nord-ouest. De petits
cailloyx roulés, d’agate et de jaspe, dont tout le sol est semé, annoncent aussi le
passage des eaux.
Le côté oriental de l’enceinte n’est formé, comme le côté nord, que d’une
seule rangée de monticules; mais il offre cela de remarquable, qu’il y a, dans le
milieu, une grande ouverture de sept cent quatre-vingts à huit cents mètres de largeur.
C’étoit probablement l’entrée principale. A droite de cette ouverture, en
regardant la chaîne Libyque, les monticules sont au nombre de six, laissant entre
eux des intervalles très-distincts. Sur le dernier, vers le nord, s’élève encore le