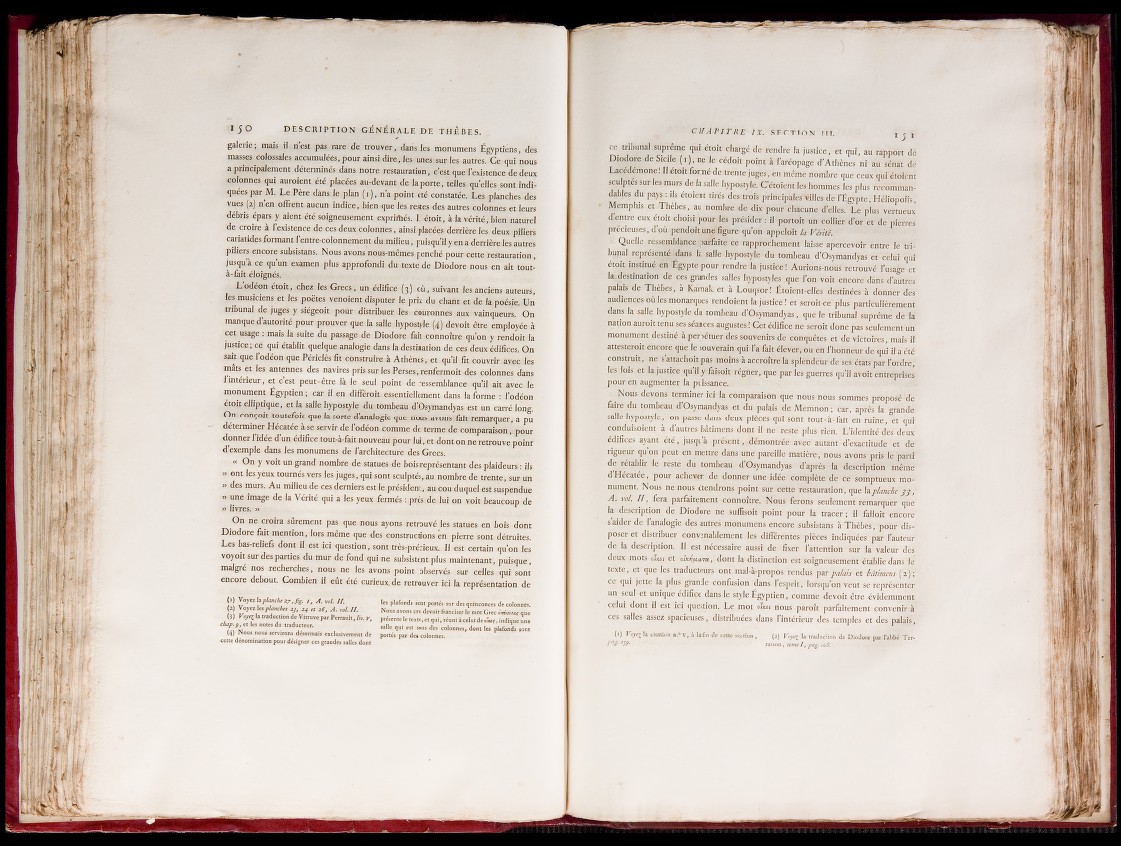
galerie; mais il n’est pas rare de trouver, dans les monumens Égyptiens, des
masses colossales accumulées, pour ainsi dire, les unes sur les autres. Ce qui nous
a principalement détermines dans notre restauration, c’est que l’existence de deux
colonnes qui auraient été placées au-devant de la porte, telles quelles sont indiquées
par M. Le Père dans le plan ( i) , n’a point été constatée. Les planches des
vues (2) nen offrent aucun indice, bien que les restes des autres colonnes et leurs
débris épars y aient été soigneusement exprimés. Il étoit, à la vérité, bien naturel
de croire à l’existence de ces deux colonnes, ainsi placées derrière les deux piliers
cariatides formant l’entre-colonnement du milieu, puisqu’il y en a derrière les autres
piliers encore subsistans. Nous avons nous-mêmes penché pour cette restauration,
jusqu a ce qu un examen plus approfondi du texte de Diodore nous en ait tout-
à-fàit éloignés.
Lodéon étoit, chez les Grecs, un édifice (3) où, suivant les anciens auteurs,
les musiciens et les poètes venoient disputer le prix du chant et de la poésie. Un
tribunal de juges y siégeoit pour distribuer les couronnes aux vainqueurs. On
manque d’autorité pour prouver que la salle hypostyie (4) devoit être employée à
cet usage ; mais la suite du passage de Diodore fait connoître qu’on y rendoit la
justice; ce qui établit quelque analogie dans la destination de ces deux édifices. On
sait que l’odéon que Périclès fit construire à Athènes, et qu’il fit couvrir avec les
mats et les antennes des navires pris sur les Perses, renfermoit des colonnes dans
1 intérieur, et cest peut-etre là le seul point de ressemblance qu’il ait avec le
monument Égyptien ; car il en différait essentiellement dans la forme : l’odéon
étoit elliptique, et la salle hypostyie du tombeau d’Osymandyas est un carré long.
On conçoit toutefois que la sorte d.analogie que nous avons fait remarquer, a pu
déterminer Hécatée à-se servir de l’odéon comme de terme de comparaison,’ pour
donner l’idée d’un édifice tout-à-fait nouveau pour lui, et dont on ne retrouve point
d’exemple dans les monumens de l’architecture des Grecs.
« On y voit un grand nombre de statues de bois représentant des plaideurs : ils
» ont les yeux tournés vers les juges, qui sont sculptés, au nombre de trente, sur un
» des murs. Au milieu de ces derniers est le président, au cou duquel est suspendue
» une finage de la Vérité qui a les yeux fermés : près de lui on voit beaucoup de
» livres. »
On ne croira sûrement pas que nous ayons retrouvé les statues en bois dont
Diodore fait mention, lors même que des constructions en pierre sont détruites.
Les bas-reliefs dont il est ici question, sont très-précieux. Il est certain qu’on les
voyoit sur des parties du mur de fond qui ne subsistent plus maintenant, puisque,
malgré nos recherches, nous ne les avons point observés sur celles qui sont
encore debout. Combien il eût été curieux, de retrouver ici la représentation de
(1) Voyez la planche 2 7 , fig. 1 , A . vol. I I .
(2) Voyez les planche! 23, 24 et 26, A . vol. I I .
(3) V °I* l la traduction de Vitruve par Perrault, liv. V,
chop, g , et les notes du traducteur.
(4) Nous nous servirons désormais exclusivement de
cette dénomination pour désigner ces grandes salles dont
les plafonds sont portés sur des quinconces de colonnes.
Nous avons cru devoir franciser le mot Grec u'Wçvaoc que
présente le texte, et qui, reuni à celui de oixoç, indique une
salle qui est sous des colonnes, dont les plafonds sont
portés par des colonnes.
ce tribunal suprême qui étoit chargé de rendre la justice, et qui, au rapport dé
Diodore de Sicile ( i) ,n e le cédoit point à l’aréopage d’Athènes ni au sénat de
Lacedemone! U étoit formé de trente juges, en même nombre que ceux qui étoient
sculptéasur les murs de la salle hypostyie. C’étoient les hommes les plus recommandâmes
du pays : ils étoient tirés des trois principales Villes de l’Égypte, Héliopolis,
Memphis et Thebes, au nombre de dix pour chacune d’elles. Le plus vertueux
d entre eux étoit choisi pour les présider : il portoit un collier d’or et de pierres
précieuses, d’où.pendoit une figure qu’on appeloit la Vérité.
Quelle ressemblance parfaite ce rapprochement laisse apercevoir entre le tribunal
représenté dans la salle hypostyie du tombeau d’Osymandyas et celui qui
étoit institué en Égypte pour rendre la justice! Aurions-nous retrouvé l’usage et
la-destination de ces grandes salles hypostyles que l’on voit encore dans d’autres
palais de Thèbes, à Karnak et à Louqsor! Étoient-elles destinées à donner des
audiences ou les monarques rendoient la justice ! et seroit-ce plus particulièrement
dans la salle hypostyie du tombeau d’Osymandyas, que le tribunal suprême de la
nation auroit tenu ses séances augustes ! Cet édifice ne serait donc pas seulement un
monument destiné à perpétüer des souvenirs de conquêtes et de victoires, mais il
attesterait encore que le souverain qui l’a fait élever, ou en l’honneur de qui il a été
construit, ne s’attachoit pas moins à accroître la splendeur de ses états par l’ordre,
les lois et la justice qu’il y faisoit régner, que par les guerres qu’il avoit entreprise^
pour en augmenter la puissance.
Nous devons terminer ici la comparaison que nous nous sommes proposé de
faire du tombeau d’Osymandyas et du palais de Memnon| car, après la grande
salle hypostyie, on passe dans deux pièces qui sont tout-à-fait en ruine, et qui
conduisoient à d’autres bâtimens dont il ne reste plus rien. L ’identité des deux
édifices ayant été, jusqu’à présent, démontrée avec autant d’exactitude et de
rigueur qu on peut en mettre dans une pareille matière, nous avons pris le parti
de rétablir le reste du tombeau d’Osymandyas d’après la description même
d Hécatée, pour achever de donner une idée complète de ce somptueux monument.
Nous ne nous étendrons point sur cette restauration, que la planche 3 3 ,
A . vol, I I , fera parfaitement connoître. Nous ferons seulement remarquer què
la description de Diodore ne suffisoit point pour la tracer ; il falloit encore
s’aider de l’analogie des autres monumens encore subsistans à Thèbes, pour disposer
et distribuer convenablement les différentes pièces indiquées par l’auteur
de la description. U est nécessaire aussi de fixer l’attention sur la valeur des
deux mots oTxm et 0ixAy.a.m, dont la distinction est soigneusement établie dans le
texte, et que les traducteurs ont mal-à-propos rendus par palais et bâtimens (2);
ce qui jette la plus grande confusion dans l’esprit, lorsqu’on veut se représenter
un seul et unique édifice dans le style Égyptien, comme devoit être évidemment
celui dont il est ici question. Le mot 0Txoi nous paraît parfaitement convenir à
ces salles assez spacieuses, distribuées dans l’intérieur des temples et des palais,
(") I V t là citation n.» y , h la En de celte section , (2) la traduction de Diodors par labbé Terl
'1 S, l59‘ rasson, tome 1 , pag. 10S.