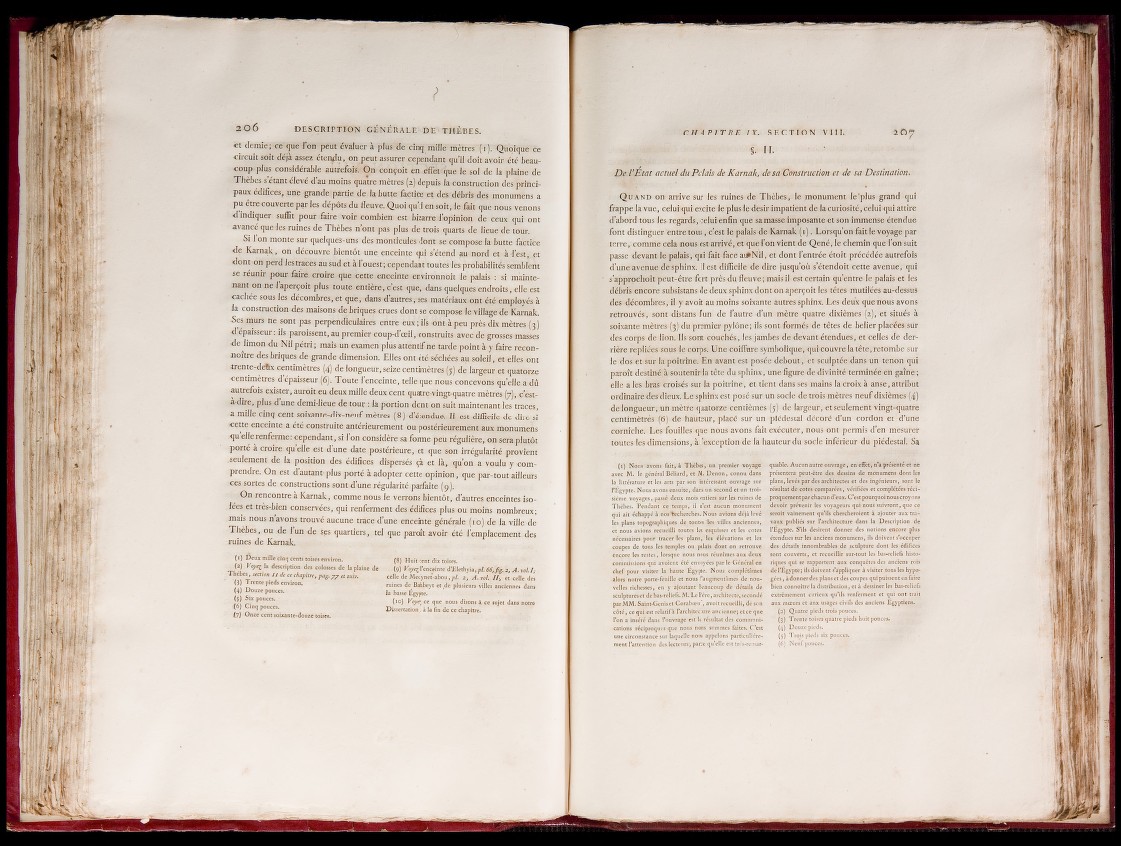
et demie; ce que l’on peut évaluer à plus de cinq mille mètres (i). Quoique ce
circuit soit déjà assez étendu, on peut assurer cependant qu’il doit avoir été beaucoup
plus considérable autrefois. On conçoit en effet que le sol de la plaine de
Thèbes s’étant élevé d’au moins quatre mètres (2) depuis la construction des principaux
édifices, une grande partie de la butte factice et des débris des monumens a
pu être couverte par les dépôts du fleuve. Quoi qu’il en soit, le fait que nous venons
d ’indiquer suffit pour faire voir combien est bizarre l’opinion de ceux qui ont
avancé que les ruines de Thèbes n’ont pas plus de trois quarts de lieue de tour.
Si 1 on monte sur quelques-uns des monticules dont se compose la butte factice
de Karnak, on découvre bientôt une enceinte qui s’étend au nord et à l’est, et
dont on perd lestraces au sud et à l’ouest ; cependant toutes les probabilités semblent
se réunir pour faire croire que cette enceinte environnoit le palais : si maintenant
on ne l’aperçoit plus toute entière, c’est qüe, dans quelques endroits, elle est
cachée sous les décombres, et que, dans d’autres, ses matériaux ont été employés à
la construction des maisons de briques crues dont se compose le village de Karnak.
Ses murs ne sont pas perpendiculaires entre eux; ils ont à peu près dix mètres (3)
d épaisseur : ils paroissent, au premier coupd’oeil, construits avec de grosses masses
de limon du Nil pétri ; mais un examen plus attentif ne tarde point à y faire recon-
noitre des briques de grande dimension. Elles ont été séchées au soleil, et elles ont
trente-deftx centimètres (4) de longueur, seize centimètres (5) de largeur et quatorze
centimètres dcpaisseur (6). Toute l’enceinte, telle que nous concevons qu’elle a dû
autrefois exister, auroit eu deux mille deux cent quatre-vingt-quatre mètres (7), c’est-
a-dire, plus d une demi-lieue de tour : la portion dont on suit maintenant les traces,
a mille cinq cent soixante-dix-neuf mètres (8) detendue. Il est difficile de dire si
cette enceinte a été construite antérieurement ou postérieurement aux monumens
qu elle renferme: cependant, si 1 on considère sa forme peu régulière, on sera plutôt
porté a croire quelle est dune date postérieure, et que son irrégularité provient
.seulement de la position des édifices dispersés çà et là, qu’on a voulu y comprendre.
On est d autant'plus porté à adopter cette opinion, que par-tout ailleurs
ces sortes de constructions sont d’une régularité parfaite ( 9 ).
On rencontre à Karnak, comme nous le verrons bientôt, d’autres enceintes isolées
et tres-bien conservées, qui renferment des édifices plus ou moins nombreux;
mais nous n’avons trouvé aucune trace d’une enceinte générale (10) de la ville de
Thèbes, ou de 1 un de ses quartiers, tel que paroît avoir été l’emplacement des
ruines de Karnak.
(8) Huit cent dix toises.
(9) l’enceinte d\Elethyia,p/. 66, f g . 2, A . vol.I;
celle de Medynet-abou, p l. 2 , A . vol., //> et celle des
ruines de Bahbeyt et de plusieurs villes anciennes dans
la basse Egypte.
(10) Vtyez ce que nous disons à ce sujet dans notre
Dissertation, à la fin de ce chapitre.
(1) Deux mille cinq cents toises environ.
(2) ^r°yeL k description des colosses de la plaine de
Thèbes, section i l de ce chapitre, pag. y y et suiv.
(3) Trente pieds environ.
(4) Douze pouces.
(5) Six .pouces.
i6 ) Cinq pouces.
{7) Onze cent soixante-douze toises.
§. 1 1 .
D e l ’É ta t actuel du Palais de Karnak, de sa Construction et de sa Destination.
Q u a n d on arrive sur les ruines de Thèbes, le monument le'plus grand qui
frappe la vue, celui qui excite le plus le désir impatient de la curiosité, celui qui attire
d’abord tous les regards, celui enfin que sa masse imposante et son immense étendue
font distinguer entre tous, c’est le palais de Karnak ( i) . Lorsqu’on fait le voyage par
terre, comme cela nous est arrivé, et que l’on vient de Qené, le chemin que l’on suit
passe devant le palais, qui fait face ail»Nil, et dont l’entrée étoit précédée autrefois
d’une avenue de sphinx. Il est difficile de dire jusqu’où s’étendoit cette avenue, qui
s’approchoit peut-être fort près du fleuve ; mais il est certain qu’entre le palais et les
débris encore subsistans de deux sphinx dont on aperçoit les têtes mutilées au-dessus
des décombres, il y avoit au moins soixante autres sphinx. Les deux que nous avons
retrouvés, sont distans l’un de l’autre d’un mètre quatre dixièmes (2), et situés à
soixante mètres-(3) du premier pylône; ils sont formés de têtes de belier placées sur
des corps de lion. Ils sont couchés, les jambes de devant étendues, et celles de derrière
repliées sous le corps. Une coiffure symbolique, qui couvre la tête, retombe sur
le dos et sur la poitrine. En avant est posée debout, et sculptée dans un tenon qui
paroît destiné à soutenir la tête du sphinx, une figure de divinité terminée en gaîne ;
elle a lés bras croisés sur la poitrine, et tient dans ses mains la croix à anse, attribut
ordinaire des dieux. Le sphinx est posé sur un socle de trois mètres neuf dixièmes (4)
de longueur, un mètre quatorze centièmes (5) de largeur, et seulement vingt-quatre
centimètres (6) de hauteur, placé sur un piédestal décoré d’un cordon et d’une
corniche. Les fouilles que nous avons fait exécuter, nous ont permis d’en mesurer
toutes les dimensions, à l’exception de la hauteur du socle inférieur du piédestal. Sa
(1) Nous avons fait, à Thèbes, un premier voyage
avec M. le général Béliard, et M. Denon, connu dans
la littérature et les arts par son intéressant ouvrage sur
l’Egypte. Nous avons ensuite, dans un second et un troisième
voyages, passé deux mois entiers sur les ruines de
Thèbes. Pendant ce temps, il n’est aucun monument
qui ait échappé à nos Recherches. Nous avions déjà levé
les plans topographiques de toutes ‘les villes anciennes,
et nous avions recueilli toutes les esquisses et les cotes
nécessaires pour tracer les plans, les élévations et les
coupes de tous les temples ou palais dont on retrouve
encore les restes, lorsque nous nous réunîmes aux deux
commissions qui avoient été envoyées par le Général en
chef pour visiter la haute Egypte. Nous complétâmes
alors notre porte-feuille et nous l’augmentâmes de nouvelles
richesses, en y ajoutant beaucoup de détails de
sculptures et de bas-reliefs. M . Le Père, architecte, secondé
par MM. Saint-Geniset Corabceuf, avoit recueilli, de son
côté, ce qui est relatif à l’architecture ancienne; et ce que
l’on a inséré dans l’ouvrage est le résultat des communications
réciproques que nous nous sommes faites. C.’est
une circonstance sur laquelle nous appelons particulièrement
l’attention des lecteurs', parce qu’elle est trcs-remarquable.
Aucun autre ouvrage, en effet, n’a présenté et ne
présentera peut-être des dessins de monumens dont les
plans, levés par des architectes et des ingénieurs, sont le
résultat de cotes comparées, vérifiées et complétées réciproquement
par chacun d’eux. C ’est pourquoi nous croyons
devoir prévenir les voyageurs qui nous suivront, que ce
seroit vainement qu’ ils chercheroient à ajouter aux travaux
publiés sur l’architecture dans la Description de
l’Egypte. S’ils desirent donner des notions encore plus
étendues sur les anciens monumens, ils doivent s’occuper
des détails innombrables de sculpture dont les édifices
sont couverts, et recueillir sur-tout les bas-reliefs historiques
qui se rapportent aux conquêtes des anciens rois
de l’Egypte; ils doivent s’appliquer à visiter tous les hypogées
, à donner des plans et des coupes qui puissent en faire
bien connoître"la distribution, et à dessiner les bas-reliefs
extrêmement curieux qu’ils renferment et qui ont trait
aux moeurs et aux usages civils des anciens Egyptiens.
(2) Quatre pieds trois pouces.
(3) Trente toises quatre pieds huit pouces.
(4) Douze pieds.
(5) Trois pieds six pouces.
(6) Neuf pouces.