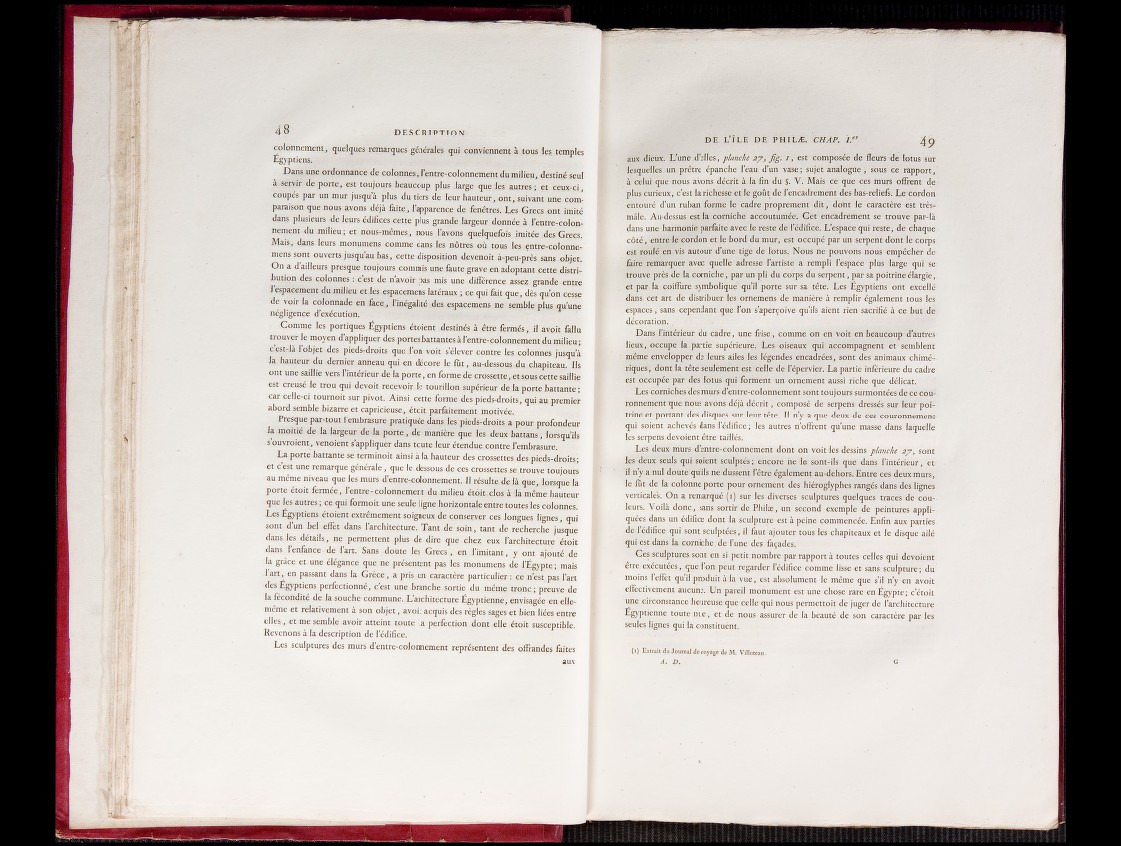
colonncment, quelques remarques générales qui conviennent à tous les temples
Égyptiens.
Dans une ordonnance de colonnes, 1 entre-colonnement du milieu, destiné seul
à.servir de porte, est toujours beaucoup plus large que les autres; et ceux-ci,
coupes par un mur jusqua plus du tiers de leur hauteur, ont, suivant une comparaison
que nous avons déjà faite, l’apparence de fenêtres. Les Grecs ont imité
dans plusieurs de leurs édifices cette plus grande largeur donnée à l’entre-colon-
nement du milieu; et nous-mêmes, nous l’avons quelquefois imitée des Grecs.
Mais, dans leurs monumens comme dans les nôtres où tous les entre-colonne-
mens sont ouverts jusqu’au bas, cette disposition devenoit à-peu-près sans objet.
On a d ailleurs presque toujours commis une faute grave en adoptant cette distribution
des colonnes : cest de n avoir pas mis une différence assez grande entre
l’espacement du milieu et.les espacemens latéraux ; ce qui fait que, dès qu’on cesse
de voir la colonnade en face, l’inégalité des espacemens ne semble plus qu’une
négligence d’exécution.
Comme les portiques Égyptiens étoient destinés à être fermés, il avoit fallu
trouver le moyen d’appliquer des portes battantes à l’entre-colonnement du milieu ;
c est-là 1 objet des pieds-droits que l’on voit s’élever contre les colonnes jusqu’à
la hauteur du dernier anneau qui en décore le fût, au-dessous du chapiteau. Us
ont une saillie vers 1 intérieur de la porte, en forme de crossette, et sous cette saillie
est creusé le trou qui devoit recevoir le tourillon supérieur de la porte battante ;
car celle-ci tournoit sur pivot. Ainsi cette forme des pieds-droits, qui au premier
abord semble bizarre et capricieuse, étoit parfaitement motivée.
Presque par-tout 1 embrasure pratiquée dans les pieds-droits a pour profondeur
la moitié de la largeur de là porte, de manière que les deux battans, lorsqu’ils
s’ouvroient, venoient s’appliquer dans toute leur étendue contre l’embrasure.
La porte battante se terminoit ainsi à la hauteur des crossettes des pieds-droits;
et cest une remarque générale, que le dessous de ces crossettes se.trouve toujours
au même niveau que les murs d’entre-colonnement. Il résulte de là que, lorsque la
porte étoit fermée, l’entre-colonnement du milieu étôit clos à la même hauteur
que les autres; ce qui formoit une seule ligne horizontale entre toutes les colonnes.
Les Égyptiens étoient extrêmement soigneux de conserver ces longues lignes, qui
sont d’un bel effet dans l’architecture. Tant de soin, tant de recherche jusque
dans les détails, ne permettent plus de dire que chez eux l’architecture étoit
dans 1 enfance de 1 art. Sans doute les Grecs , en l’imitant, y ont ajouté de
la grâce et une élégance que ne présentent pas les monumens de l’Égypte; mais
1 art, en passant dans la Grèce, a pris un caractère particulier : ce n’est pas l’art
des Égyptiens perfectionne, cest une branche sortie du même tronc; preuve de
la fécondité de la souche commune. L ’architecture Égyptienne, envisagée en elle-
meme et relativement à son objet, avoit acquis des règles sages et bien liées entre
elles,, et me semble avoir atteint toute la perfection dont elle étoit susceptible.
Revenons à la description de l’édifice.
Les sculptures des murs d’entre-colonnement représentent des offrandes faites
aux
aux dieux. L ’une d’elles, planche 2 7 , Jig . 1 , est composée de fleurs de lotus sur
lesquelles un prêtre épanche l’eau d’un vase; sujet analogue, sous ce rapport,
à celui que nous avons décrit à la fin du §. V. Mais ce que ces murs offrent de
plus curieux, c’est la richesse et le goût de l’encadrement des bas-reliefs. Le cordon
entouré d’un ruban forme le cadre proprement dit, dont le caractère est très-
mâle. Au-dessus est la corniche accoutumée. Cet encadrement se trouve par-là
dans une harmonie parfaite avec le reste de l’édifice. L ’espace qui reste, de chaque
côté, entre le cordon et le bord du mur, est occupé par un serpent dont le corps
est roulé en vis autour d’une tige de lotus. Nous ne pouvons nous empêcher de
faire remarquer avec quelle adresse l’artiste a rempli l’espace plus large qui se
trouve près de la corniche, par un pli du corps du serpent, par sa poitrine élargie,
et par la coiffure symbolique qu’il porte sur sa tête. Les Égyptiens ont excellé
dans cet art de distribuer les ornemens de manière à remplir également tous les
espaces, sans cependant que l’on s’aperçoive qu’ils aient rien sacrifié à ce but de
décoration.
Dans l’intérieur du cadre, une frise, comme on en voit en beaucoup d’autres
lieux, occupe la partie supérieure. Les oiseaux qui accompagnent et semblent
même envelopper de leurs ailes les légendes encadrées, sont des animaux chimériques,
dont la tête seulement est celle de l’épervier. La partie inférieure du cadre
est occupée par des lotus qui forment un ornement aussi riche que délicat.
Les corniches des murs d’entre-colonnement sont toujours surmontées de ce couronnement
que nous avons déjà décrit, composé de serpens dressés sur leur poitrine
et portant des disques sur leur tete. Il ny a que deux de ces couronnemens
qui soient achevés dans l’édifice ; les autres n’ofifent qu’une masse dans laquelle
les serpens devoient être taillés.
Les deux murs d’entre-colonnement dont on voit les dessins planche 2 7 , sont
les deux seuls qui soient sculptés ; encore ne le sont-ils que dans l’intérieur, et
il n’y a nul doute qu’ils ne dussent l’être également au-dehors. Entre ces deux murs,
le fut de la colonne porte pour ornement des hiéroglyphes rangés dans des lignes
verticales. On a remarqué (1) sur les diverses sculptures quelques traces de couleurs.
Voilà donc, sans sortir de Philæ, un second exemple de peintures appliquées
dans un édifice dont la sculpture est à peine commencée. Enfin aux parties
de 1 édifice qui sont sculptées, il faut ajouter tous les chapiteaux et le disque ailé
qui est dans la corniche.de l’une des façades.
Ces sculptures sont en si petit nombre par rapport à toutes celles qui devoient
etre exécutées, que Ion peut regarder l’édifice comme lisse et sans sculpture; du
moins 1 effet qu il produit à la vue, est absolument le même que s’il n’y en avoit
effectivement aucune. Un pareil monument est une chose rare cnÉgypte; c’étoit
une circonstance heureuse que celle qui nous permettoit de juger de l’architecture
Egyptienne toute nue, et de nous assurer de fa beauté de son caractère par les
seules lignes qui la constituent.
(1) Extrait du Journal de voyage de M. Villoteau,
A . D\ G