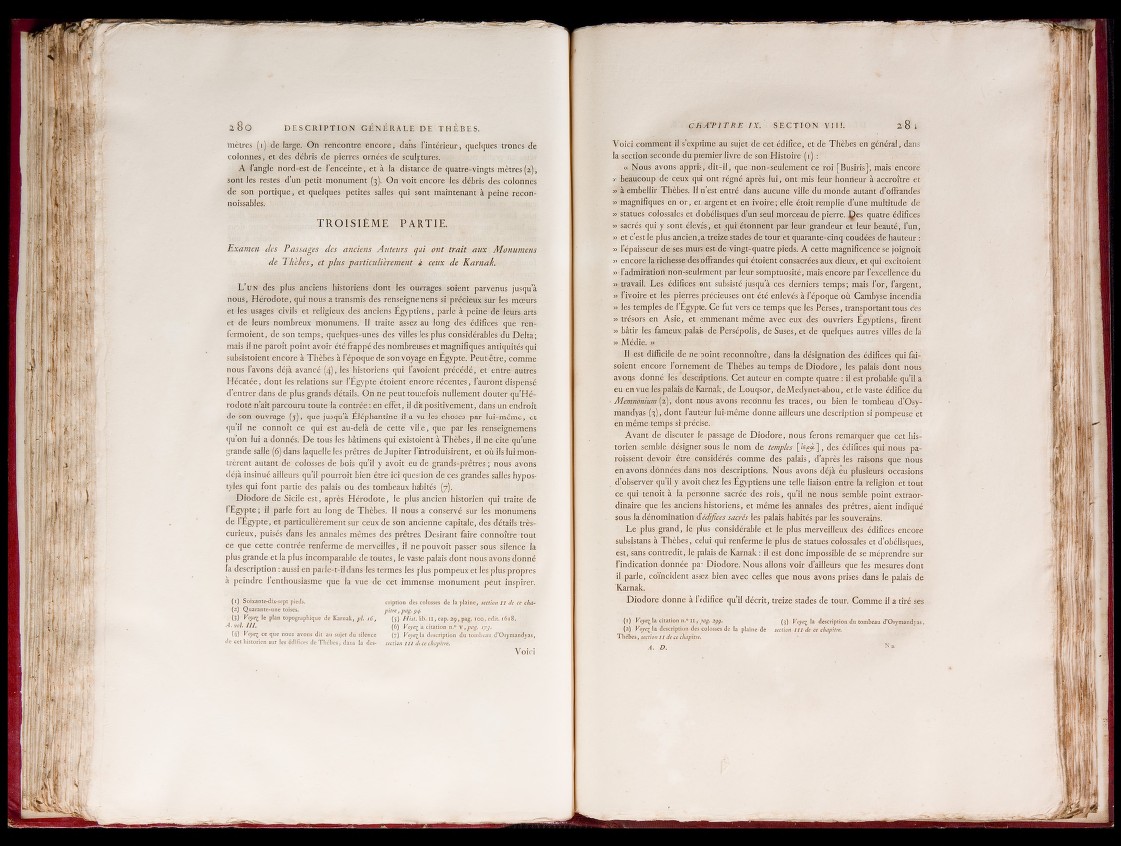
mètres (i) de large. Oh rencontre encore, dans l’intérieur, quelques troncs de
colonnes, et des débris de pierres ornées de sculptures.
A l’angle nord-est de l’enceinte, et à la distance de quatre-vingts mètres (2),
sont les restes d’un petit monument (3), On voit encore les débris des colonnes
de son portique, et quelques petites salles qui sont maintenant à peine recon-
noissables.
TROIS IÈME PARTIE.
Examen des Passages des anciens Ailleurs qui ont trait aux Monumens
de Thèbes, et p lu s particulièrement a ceux de Karnak.
L ’ u n des plus anciens historiens dont les ouvrages soient parvenus jusqu’à
nous, Hérodote, qui nous a transmis des renseignemens si précieux sur les moeurs
et les usages civils et religieux des anciens Egyptiens, parle à peine de leurs arts
et de leurs nombreux monumens. Il traite assez au long des édifices que ren-
fermoient, de son temps, quelques-unes des villes les plus considérables du Delta;
mais il ne paroît point avoir été frappé des nombreuses et magnifiques antiquités qui
subsistoient encore à Thèbes à l’époque de son voyage en Egypte. Peut-être, comme
nous l’avons déjà avancé (4), les historiens qui l’avoient précédé, et entre autres
Hécatée, dont les relations sur l’Egypte étoient encore récentes, l’auront dispensé
d’entrer dans de plus grands détails. On ne peut toutefois nullement douter qu’Hé-
rodotê n’ait parcouru toute la contrée : en effet, il dit positivement, dans un endroit
de son ouvrage (y), que jusqu’à Éléphantine il a vu les choses par lui-même, et
qu’il ne connoit ce qui est au-delà de cette ville, que par les renseignemens
qu on lui a donnés. De tous les bâtimens qui existoient à Thèbes, il ne cite qu’une
grande salle (6) dans laquelle les prêtres de Jupiter l’introduisirent, et où ils lui montrèrent
autant de colosses de bois qu’il y avoit eu de grands-prêtres ; nous avons
déjà insinué ailleurs qu’il pourroit bien être ici question de ces grandes salles hypos-
tyles qui font partie des palais ou des tombeaux habités (7).
Diodore de Sicile est, après Hérodote, le plus ancien historien qui traite de
1 Egypte ; il parle fort au long de Thèbes. Il nous a conservé sur les monumens
de 1 Egypte, et particulièrement sur ceux de son ancienne capitale, des détails très-
curieux, puisés dans les annales mêmes des prêtres. Désirant faire connoître tout
ce que cette contrée renferme de merveilles, il ne pouvoit passer sous silence la
plus grande et la plus incomparable de toutes, le vaste palais dont nous avons donné
la description : aussi en parle-t-il dans les termes les plus pompeux et les plus propres
à peindre l’enthousiasme que la vue de cet immense monument peut inspirer.
(1) Soixante-dix-sept pieds. cription des colosses de la plaine, s e c t io n I I d e c e c h a -
(2) Quarante-une toisés. p i t r e , p a g . p f .
(3) k P^an topographique de Karnak, pl. 16 , (5) Hist. lib. I I , cap. 2 9 , pag. 100, edit. 1618.
A. vol. I I I . (6) Voye^ la citation n.° V , pag. 17y .
(4) ce *îue nous avons dit au sujet du silence (7) Voye^ la description du tombeau d’Osymandyas,
de cet historien sur les édifices de Thèbes, dans la des- s e c t io n I I I d e c e c h a p i t r e ,
Voici
Voici comment il s’exprime au sujet de cet édifice, et de Thèbes en général, dans
la section seconde du premier livre de son Histoire (i) :
« Nous avons appris, dit-il, que non-seulement ce roi [Busiris], mais encore
3- beaucoup de ceux qui ont régné après lui, ont mis leur honneur à accroître et
» à embellir Thèbes. Il n'est entré dans aucune ville du monde autant d'offrandes
» magnifiques en or, en argent et en ivoire ; elle étoit remplie d’une multitude de
» statues colossales et d’obélisques d’un seul morceau de pierre. Des quatre édifices
» sacrés qui y sont élevés, et qui étonnent par leur grandeur et leur beauté, l’un,
» et c’est le plus ancien, a treize stades de tour et quarante-cinq coudées de hauteur :
» l’épaisseur de ses murs est de vingt-quatre pieds. A cette magnificence se joignoit
» encore la richesse des offrandes qui étoient consacrées aux dieux, et qui excitoient
»■l’admiration non-seulement par leur somptuosité, mais encore par l’excellence du
» travail. Les édifices ont subsisté jusqu’à ces derniers temps; mais l’or, l’argent,
» l’ivoire et les pierres précieuses ont été enlevés à l’époque où Cambyse incendia
» les temples de l’Egypte. Ce fut vers ce temps que les Perses, transportant tous c’es
» trésors en Asie, et emmenant même avec eux des ouvriers Égyptiens, firent
» bâtir les fameux palais de Persépolis, de Suses, et de quelques autres villes de la
» Médie. »
Il est difficile de ne point reconnoitre, dans la désignation des édifices qui fai-
soient encore l’ornement de Thèbes au temps de Diodore, les palais dont nous
avons donné les descriptions. Cet auteur en compte quatre : il est probable qu’il a
eu en vue les palais de Karnak, de Louqsor, deMedynet-abou, et le vaste édifice du
Memnonium (2), dont nous avons reconnu les traces, ou bien le tombeau d’Osymandyas
(3), dont l’auteur lui-même donne ailleurs une description si pompeuse et
en même temps si précise.
Avant de discuter le passage de Diodore, nous ferons remarquer que cet historien
semble désigner sous le nom de temples ['*©!], des édifices qui nous paraissent
devoir être considérés comme des palais, d’après les raisons que nous
en avons données dans nos descriptions. Nous avons déjà eu plusieurs occasions
d’observer qu’il y avoit chez les Égyptiens une telle liaison entre la refigion et tout
ce qui tenoit à la personne sacrée des rois, qu’il ne nous semble point extraordinaire
que les anciens historiens, et même les annales des prêtres, aient indiqué
sous la dénomination d'édifices sacrés les palais habités par les souverains.
Le plus grand, le plus considérable et le plus merveilleux des édifices encore
subsistans à Thèbes, celui qui renferme le plus de statues colossales et d’obélisques,
est, sans contredit, le palais de Karnak : il est donc impossible de se méprendre sur
l’indication donnée par Diodore. Nous allons voir d’ailleurs que les mesures dont
il parle, coïncident assez bien avec celles que nous avons prises dans le palais de
Karnak.
Diodore donne à 1 édifice qu’il décrit, treize stades de tour. Comme il a tiré ses
( 1 ) Voye^ l a c i t a t io n n . ° i l y pag. z p p . ( 3 ) V o y e^ l a d e s c r ip t io n d u tom b e a u d ’ O s y m a n d y a s ,
( 2 ) V o y e z l a d e s c r ip t io n d e s c o lo s s e s d e l a p la in e d e s e c t io n n i d e c e c h a p it r e .
Thèbes, s e c t io n 1 1 d e c e c h a p it r e .
A. D. ' Ñ»