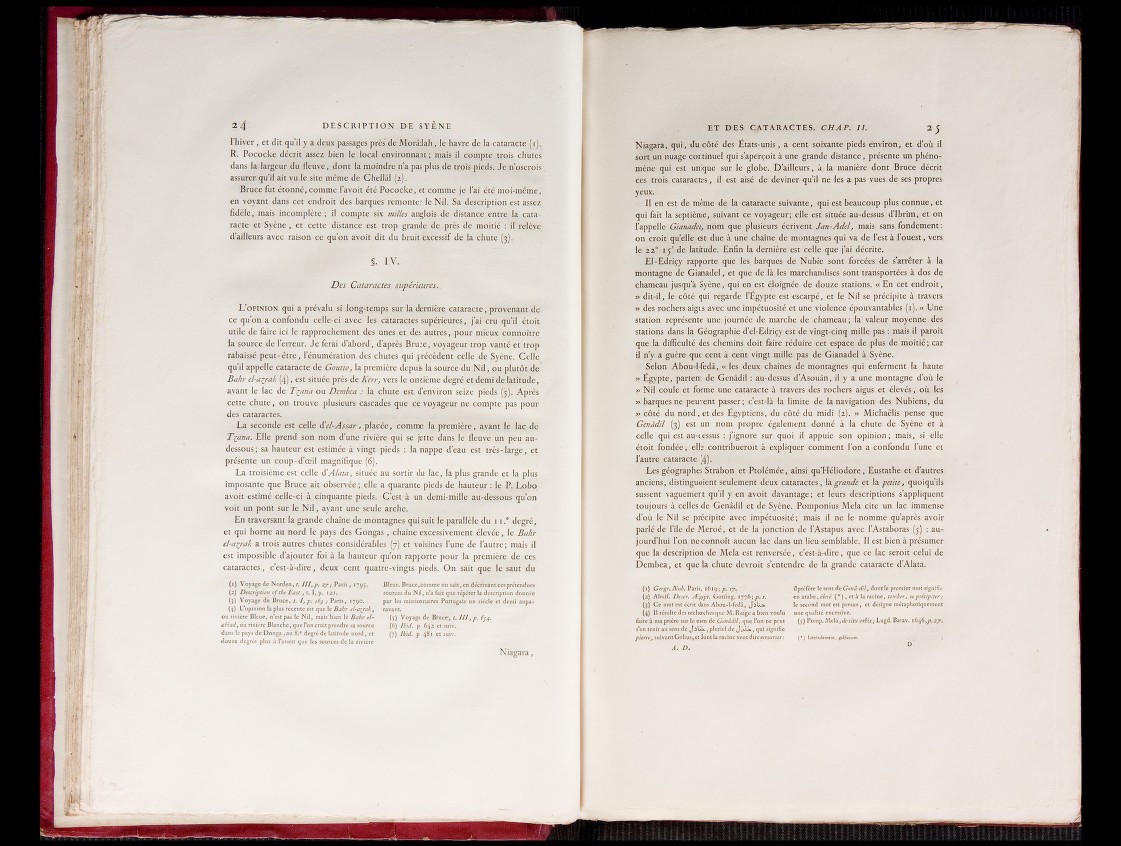
l’hiver , et dit qu’il y a deux passages près de Morâdah, le havre de la cataracte (i).
R. Pococke décrit assez bien le local environnant; mais il compte trois chutes
dans la largeur du fleuve, dont la moindre n’a pas plus de trois pieds. Je n’oserois
assurer qu’il ait vu le site même de Chellâl (2).
Bruce fut étonné, comme l’avoit été Pococke, et comme je l’ai été moi-même,
en voyant dans cet endroit des barques remonter le Nil. Sa description est assez
fidèle, mais incomplète ; il compte six milles anglois de distance entre la cataracte
et Syène , et cette distance est trop grande de près de moitié : il relève
d’ailleurs avec raison ce qu’on avoit dit du bruit excessif de la chute (3).
§. IV .
Des Cataractes supérieures..
L ’ o p i n io n qui a prévalu si Jong-temps sur la dernière cataracte, provenant de.
ce qu’on a confondu celle-ci avec les cataractes supérieures, j’ai cru qu’il étoit
utile de faire ici le rapprochement des unes et des auires, pour mieux connoître
la source de l’erreur. Je ferai d’abord, d’après Bruce, voyageur trop vanté et trop
rabaissé peut-être, l’énumération des chutes qui précèdent celle de Syène. Celle
qu’il appelle cataracte de Goutto, la première depuis la source du N il, ou plutôt de
Bahr el-afrak (4), est située près de Kerr, vers le onzième degré et demi de latitude,
avant le lac de Tfana ou Dembea : la chute est d’environ seize pieds (5). Après
cette chute, on trouve plusieurs cascades que ce voyageur ne compte pas pour
des cataractes.
La seconde est celle d'el-Assar, placée, comme la première, avant le lac de
T%ana. Elle prend son nom d’une rivière qui se jette dans le fleuve un peu au-
dessous; sa hauteur est estimée à vingt pieds : la nappe d’eau est très-large, et
présente un coup-d’oeil magnifique (6).
La troisième est celle à’Alata, située au sortir du lac, la plus grande et la plus
imposante que Bruce ait observée ; elle a quarante pieds de hauteur : le P. Lobo
avoit estimé celle-ci à cinquante pieds. C ’est à un demi-mille au-dessous qu’on
voit un pont sur le Nil, ayant une seule arche.
En traversant la grande chaîne de montagnes qui suit le parallèle du 1 1 ,e degré,
et qui borne au nord le pays des Gongas , chaîne excessivement élevée, le Bahr
el-afrak a trois autres chutes considérables (7) et voisines l’une de l’autre; mais il
est impossible d’ajouter foi à la hauteur qu’on rapporte pour la première de ces,
cataractes, c’est-à-dire, deux cent quatre-vingts pieds. On sait que le saut du
( i ) Voyage de Norden, t. 111, p . 2.7; Paris, 1795. Bleue. Bruce, comme on sait, en décrivant ces prétendues
(2) Description o f the E a s i, t. I, p. 121. sources du Nil , n’a fait que répéter la description donnée
(3) Voyage de Bruce, t. I , p . 169 ; Paris, 1790. par les missionnaires Portugais un siècle et demi aupa-
(4) L’opinion la plus récente est que le Bahr el-ajrak, ravant.
ou rivière Bleue, n’est pas le Nil, mais bien le Bah r el- (5) Voyage de Bruce*, t. I I I , p . 654.
abiad, ou rivière Blanche, que l’on croit prendre sa source (6) Ibid. p. 64.2 et suiv.
dans le pays de"Donga,au 8.e degré de latitude nord, et (7) Ibid. p. 481 et suiv.
douze degrés plus à l’ouest que les sources de la rivière
Niagara,
Niagara, qui, du côté des Etats-unis, a cent soixante pieds environ, et d’où il
sort un nuage continuel qui s’aperçoit à une grande distance, présente un phénomène
qui est unique sur le globe. D’ailleurs, à la manière dont Bruce décrit
ces trois cataractes, il est aisé de deviner qu’il ne les a pas vues de ses propres
yeux.
Il en est de même de la cataracte suivante, qui est beaucoup plus connue, et
qui fait la septième, suivant ce voyageur; elle est située au-dessus d’Ibrim, et on
l’appelle Gianadel, nom que plusieurs écrivent Jan-A del, mais sans fondement:
on croit qu’elle est due à une chaîne de montagnes qui va de l’est à l’ouest, vers
le 220 1.5' de latitude. Enfin la dernière est celle que j’ai décrite.
El-Edriçy rapporte que les barques de Nubie sont forcées de s’arrêter à la
montagne de Gianadel, et que de là les marchandises sont transportées à dos de
chameau jusqu’à Syène, qui en est éloignée de douze stations. « En cet endroit,
» dit-il, le côté qui regarde l’Egypte est escarpé, et le Nil se précipite à travers
» des rochers aigus avec une impétuosité et une violence épouvantables (1).» Une
station représente une journée de marche de chameau; la valeur moyenne des
stations dans la Géographie d’el-Edriçy est de vingt-cinq mille pas : mais il paroît
que la difficulté des chemins doit làire réduire cet espace de plus de moitié; car
il n’y a guère que cent à cent vingt mille pas de Gianadel à Syène.
Selon Abou-I-fedâ, « les deux chaînes de montagnes qui enferment la haute
» Egypte, partent de Genâdil : au-dessus d’Asouân, il y a une montagne d’où le
» Nil coule et forme une cataracte à travers des rochers aigus et élevés, où les
». barques ne peuvent passer; c’est-là la limite de la navigation des Nubiens, du
» côté du nord, et des Egyptiens, du côté du midi (2). » Michaëlis pense que
Genâdil (3) est un nom propre également donné à la chute de Syène et à
celle qui est au-dessus : j’ignore sur quoi il appuie son opinion ; mais, si elle
étoit fondée, elle contribueroit à expliquer comment l’on a confondu l’une et
l’autre cataracte (4).
Les géographes Strabon et Ptolémée, ainsi qu’Héliodore, Eustathe et d’autres
anciens, distinguoient seulement deux cataractes, la grande et la petite, quoiqu’ils
sussent vaguement qu’il y en avoit davantage ; et leurs descriptions s’appliquent
toujours à celles de Genâdil et de Syène. Pomponius Mêla cite un lac immense
d’où le Nil se précipite avec impétuosité; mais il ne le nomme qu’après avoir
parlé de l’île de Meroé, et de la jonction de l’Astapus avec l’Astaboras (j) : aujourd’hui
l’on ne connoît aucun lac dans un lieu semblable. Il est bien à présumer
que la description de Mêla est renversée, c’est-à-dire, que ce lac seroit celui de
Dembea, et que la chute devroit s’entendre de la grande cataracte d’Alata.
( i ) Ceogr. Nub. Paris, 1619; p. 17 , il préfère le sens de Genâ-dil, dont le premier mot signifie
(2) Abulf. Descr. Æçypt. Gotting. 17 76 ; p . /. en arabe, élevé ( * ) , et à la racine, tomber, se précipiter ;
(3) Ce mot est écrit dans Àbou-l-fedâ, J i L a . le second mot est persan, et désigne métaphoriquement
(4) 11 résulte des recherches que M. Raige a bien voulu une qualité excessive.
faire & ma prière sur le nom de Genâdil, que l’on ne peut (5) Pomp. M êla, de situ orbis j Lugd. Batav. 1646,77.2 7 .
s'en tenir au sens de J ¿Uâ. , pluriel de Jd -lL , qui signifie
pierre j suivant Golius, et dont la racine veut dire renverser: ( * ) Littéralement, gittosum.
A . D . °