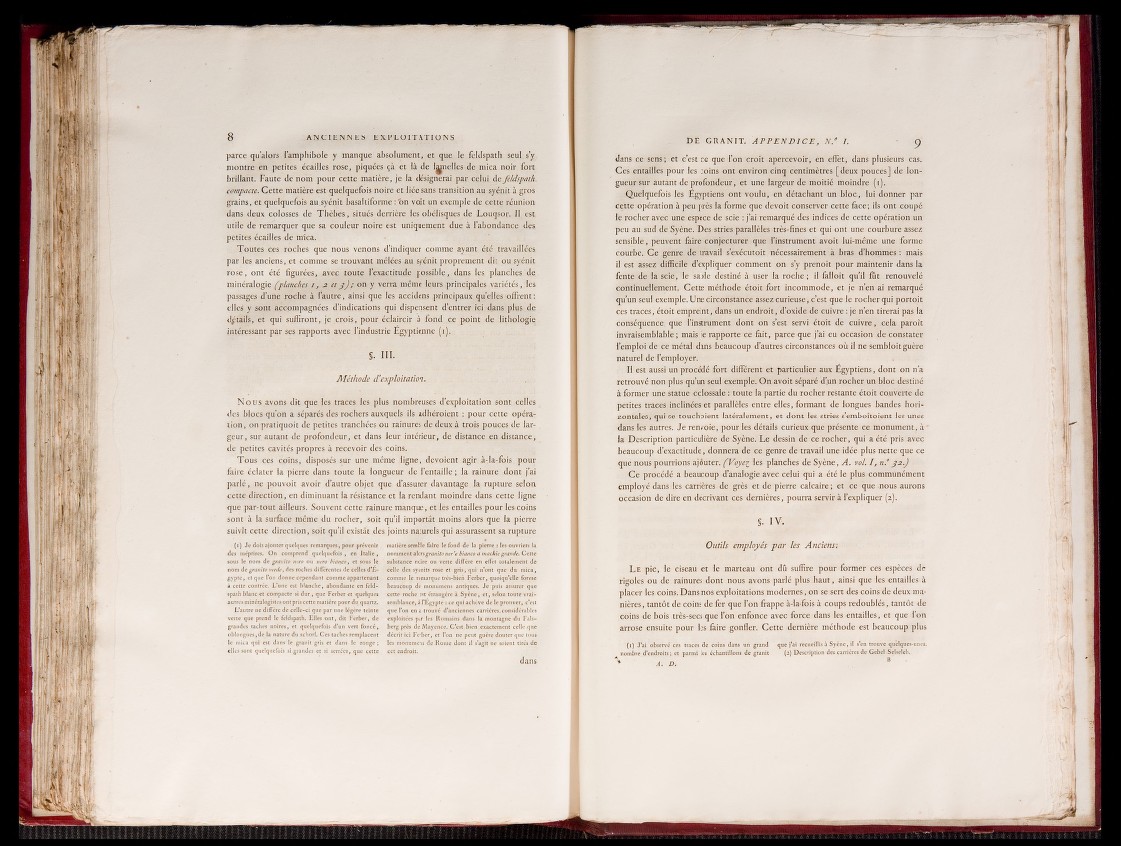
IR
n i
¡ i
f
lu í
8 A N C I E N N E S E X P L O I T A T I O N S
parce qu’alors l’amphibole y manque absolument, et que le feldspath seul s’y
montre en petites écailles rose, piquées çà et là de lmnelles de mica noir fort
brillant. Faute de nom pour cette matière, je la désignerai par celui été feldspath,
compacte. Cette matière est quelquefois noire et liée sans transition au syénit à gros
grains, et quelquefois au .syénit basaitiforme : "on voit un exemple de cette réunion
dans deux colosses de Thèbes, situés derrière les obélisques de Louqsor. 11 est
utile de remarquer que sa couleur noire est uniquement due à l’abondance des
petites écailles de mica.
Toutes ces roches que nous venons d’indiquer comme ayant été travaillées
par les anciens, et comme se trouvant mêlées au syénit proprement dit ou syénit
rose, ont été figurées, avec toute l’exactitude possible, dans les planches de
minéralogie (planches / , 2 et3 ) ; on y verra même leurs principales variétés, les
passages d’une roche à l’autre, ainsi que les accidens principaux qu’elles offrent:
cllcà y sont accompagnées d’indications qui dispensent d’entrer ici dans plus de
détails, et qui suffiront, je crois, pour éclaircir à fond ce point de lithologie
intéressant par ses rapports avec l’industrie Egyptienne (1).
S. III.
Méthode d ’exploitation.
Nous avons dit que les traces les plus nombreuses d’exploitation sont celles
des blocs qu’on a séparés des rochers auxquels ils adhéroient : pour cette opération,
on pratiquoit de petites tranchées ou rainures de deux à trois pouces de largeur,
sur autant de profondeur, et dans leur intérieur, de distance en distance,
de petites cavités propres à recevoir des coins.
Tous ces coins, disposés sur une même ligne, dévoient agir à-la-fois pour
faire éclater la pierre dans toute la longueur de l’entaille ; la rainure dont j’ai
parlé, ne pouvoit avoir d’autre objet que d’assurer davantage la rupture selon
cette direction, en diminuant la résistance et la rendant moindre dans cette ligne
que par-tout ailleurs. Souvent cette rainure manque, et les entailles pour les coins
sont à la surface même du rocher, soit qu’il importât moins alors que la pierre
suivît cette direction, soit qu’il existât des joints naturels qui assurassent sa rupture
(1) J e dois ajouter quelques remarques, pour prévenir
des méprises. On comprend quelquefois , en Ita lie ,
sous le nom de granito mro ou nero bianco, et sous le
nom de granito verde, des roches différentes de celles d’E gypte,
et que l’on donne cependant comme appartenant
à cette contrée. L ’une est blanche, abondante en feldspath
blanc et compacte si dur, que Ferber et quelques
autres minéralogistes ont pris cette matière pour du quartz.
L’autre ne diffère de celle-ci que par une légère teinte
verte que prend le feldspath. Elles ont, dit Ferber, de
grandes taches noires, et quelquefois d’un vert foncé,
oblongues, de la nature du schorl. Ces taches remplacent
le mica qui est dans le granit gris et dans le rouge;
elles sont quelquefois si grandes et si serrées, que cette
matière semble faire le fond de la pierre : les ouvriers la
nomment alors granito ner ’e bianco a machie grande. Cette
substance noire ou verte diffère en effet totalement de
celle des syénits rose et gris, qui n’ont que du mica,
comme le remarque très-bien Ferber, quoiqu’elle forme
beaucoup de monumens antiques. Je puis assurer que
cette roche est étrangère à Syène, et, selon toute vraisemblance,
à l’Egypte : ce qui achève de le prouver, c’est
que l'on en a trouvé d’anciennes carrières, considérables
exploitées par les Romains dans la montagne du Fals-
berg près de Mayence. C ’est.bien exactement celle que
décrit ici Ferber, et l’on ne peut guère douter que tous
monumens de Rome dont il s’agit ne soient tirés de
cet endroit.
dans
D E G R A N I T . A P P E N D I C E , N . ’ I . O
dans ce sens ; et c’est ce que l’on croit apercevoir, en effet, dans plusieurs cas.
Ces entailles pour les coins ont environ cinq centimètres [deux pouces] de longueur
sur autant de profondeur, et une largeur de moitié moindre (1).
Quelquefois les Égyptiens ont voulu, en détachant un bloc, lui donner par
cette opération à peu près la formé que devoit conserver cette face ; ils ont coupé,
le rocher avec une espèce de scie : j’ai remarqué des indices de cette opération un
peu au sud de Syène. Des stries parallèles très-fines et qui ont une courbure assez
sensible, peuvent faire conjecturer que l’instrument avoit lui-même une forme
courbe. Ce genre de travail s’exécutoit nécessairement à bras d’hommes : mais
il est assez difficile d’expliquer comment on s’y prenoit pour maintenir dans la
fente de la scie, le sable destiné à user la roche; il falloit qu’il fût renouvelé
continuellement. Cette méthode étoit fort incommode, et je n’en ai remarqué
qu’un seul exemple. Une circonstance assez curieuse, c’est que le rocher qui portoit
ces traces, étoit empreint, dans un endroit, d’oxide de cuivre : je n’en tirerai pas la
conséquence, que l’instrument dont on s’est servi étoit de cuivre, cela paroît
invraisemblable ; mais je rapporte ce fait, parce que j’ai eu occasion de constater
l’emploi de ce métal dans beaucoup d’autres circonstances où il ne sembloit guère
naturel de l’employer. . .
Il est aussi un procédé fort différent et particulier aux Egyptiens, dont on n’a
retrouvé non plus qu’un seul exemple. On avoit séparé d’un rocher un bloc destiné
à former ime statue colossale : toute la partie du rocher restante étoit couverte de
petites traces inclinées et parallèles entre elles, formant de longues bandes horizontales,
qui se touchoient latéralement, et dont les stries s’emboîtoient les unes
dans les autres. Je renvoie, pour les détails curieux que présente ce monument, à *
la Description particulière de Syène. Le dessin de ce rocher, qui a été pris avec
beaucoup d’exactitude, donnera de ce genre de travail une idée plus nette que ce
que nous pourrions ajouter. (Voye^ les planches de Syène, A . vol. I , n.° 3 2 .)
Ce procédé a beaucoup d’analogie avec celui qui a été le plus communément
employé dans les carrières de grès et de pierre calcaire ; et ce que nous aurons
occasion de dire en décrivant ces dernières, pourra servir à l’expliquer (2).
§. IV .
Outils employés p a r les Anciens',
L e pic, le ciseau et le marteau ont dû suffire pour former ces espèces de
rigoles ou de rainures dont nous avons parlé plus haut, ainsi que les entailles à
placer les coins. Dans nos exploitations modernes, on se sert des coins de deux manières,
tantôt de coins de fer que l’on frappe à-la-fois à coups redoublés, tantôt de
coins de bois très-secs que l’on enfonce avec force dans les entailles, et que l’on
arrose ensuite pour les faire gonfler. Cette dernière méthode est beaucoup plus
(1) J ’ai observé ces traces de coins dans un grand que j’ai recueillis à Syène, il s’en trouve quelques-unes,
nombre d’endroits ; et parmi les échantillons de granit (2) Description des carrières de Gebel Selseleh.
B
^ A . D .
i ü S l