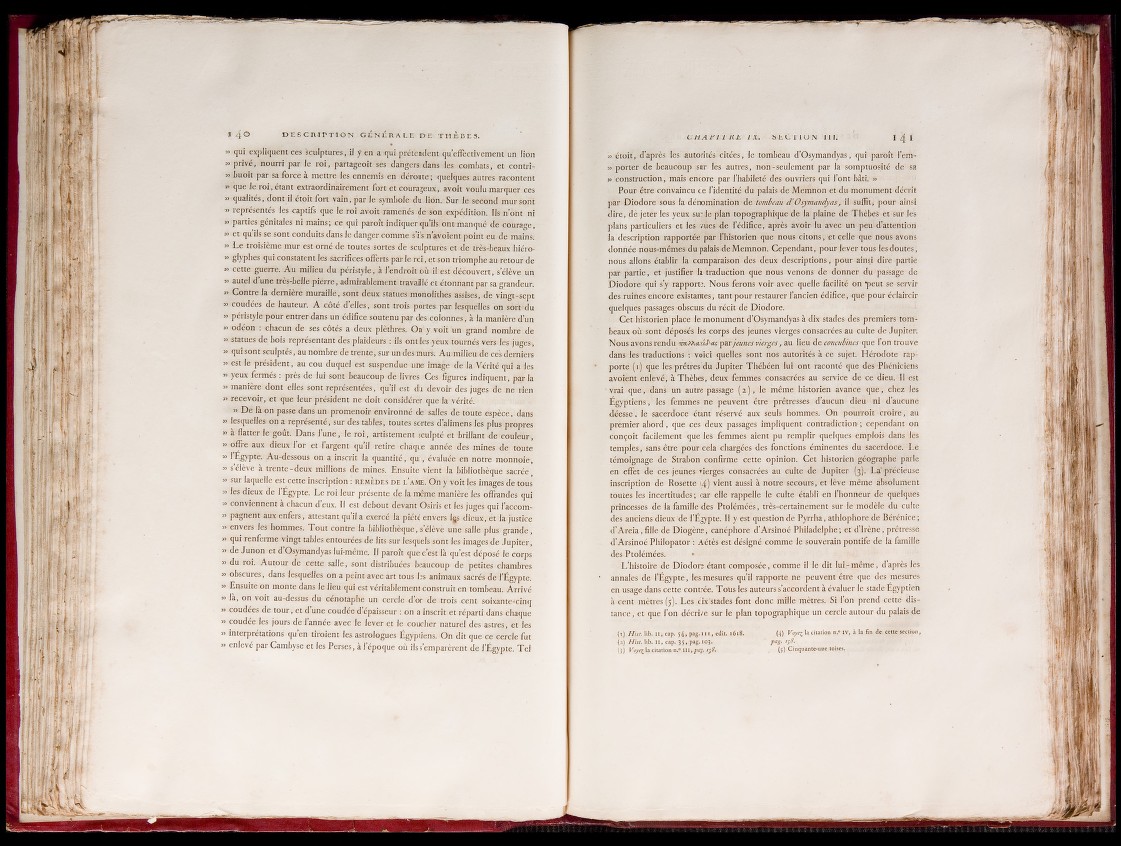
» qui expliquent ces sculptures, il y en a qui prétendent qu'effectivement un lion
33 prive, nourri par le roi, partageoit ses dangers dans les combats, et contri-
buoit par sa force a mettre les ennemis en déroute; quelques autres racontent
v que Je roi, étant extraordinairement fort et courageux, avoit voulu marquer ces
» qualités, dont il étoitfort vain, par le symbole du lion. Sur le second mur sont
» représentés les captifs que le roi avoit ramenés de son expédition. Ils n’ont ni
» parties génitales ni mains; ce qui paroît indiquer qu’ils ont manqué de courage,
» et qu ils se sont conduits dans le danger comme s’ils n’avoîent point eu de mains.
« Le troisième mur est orné de toutes sortes de sculptures et de très-beaux hiéro-
15 glyphes qui constatent les sacrifices offerts parle roi, et son triomphe au retour de
« cette guerre. Au milieu du péristyle, à l’endroit où il est découvert, s’élève un
33 autel d une tres-belle pierre, admirablement travaillé et étonnant par sa grandeur.
» Contre la dernière muraille, sont deux statues monolithes assises, de vingt-sept
» coudées de hauteur. A côté d’elles, sont trois portes par lesquelles on sort du
» péristyle pour entrer dans un édifice soutenu par des colonnes, à la manière d’un
» odéon ; chacun de ses côtés a deux plèthres. On y voit un grand nombre de
» statues de bois représentant des plaideurs : ils ont les yeux tournés vers les juges,
» qui sont sculptés, au nombre de trente, sur un des murs. Au milieu de ces derniers
» est le président, au cou duquel est suspendue une image de la Vérité qui a les
» yeux fermes : près de lui sont beaucoup de livres. Ces figures indiquent, par la
» manière dont elles sont représentées, qu’il est du devoir des juges de ne rien
33 recevoir, et que leur président ne doit considérer que la vérité.
33 De là on passe dans un promenoir environné de salles de toute espèce, dans
33 lesquelles on a représenté, sur des tables, toutes sortes d’alimens les plus propres
33 a flatter le goût. Dans l ’une, le roi, artistement sculpté et brillant de couleur,
33 offre aux dieux 1 or et 1 argent qu’il retire chaque année des mines de toute
33 1 Egypte. Au-dessous on a inscrit la quantité, qui, évaluée en notre monnoie,
33 s’élève à trente-deux millions de mines. Ensuite vient la bibliothèque sacrée
33 sur laquelle est cette inscription : r e m è d e s d e l ’ a m e . On y voit les images de tous
33 les dieux de 1 Egypte. Le roi leur présente de la même manière les offrandes qui
33 conviennent a chacun d’eux. Il est debout devant Osiris et les juges qui l’accom-
33 pagnent aux enfers, attestant qu’il a exercé la piété envers Igs dieux, et la justice
33 envers les hommes. Tout contre la bibliothèque, s’élève une salle plus grande,
33 qui renferme vingt tables entourées de lits sur lesquels sont les images de Jupiter,
33 de Junon et d Osymandyas lui-même. Il paroît que c’est là qu’est déposé le corps
33 du roi. Autour de cette salle, sont distribuées beaucoup de petites chambres
33 obscures, dans lesquelles on a peint avec art tous les animaux sacrés de l’Egypte.
33 Ensuite on monte dans le lieu qui est véritablement construit en tombeau. Arrivé
33 la, on voit au-dessus du cénotaphe un cercle d’or de trois cent soixante^cinq
33 coudées de tour, et d une coudée d’épaisseur : on a inscrit et réparti dans chaque
33 coudée les jours de l’année avec le lever et le coucher naturel des astres, et les
33 interprétations qu en tiroient les. astrologues Égyptiens. On dit que ce cercle fut
33 enlevé par Cambyse et les Perses, à l’époque où ils s’emparèrent de l’Egypte. Tel
C H A P I T R E IX. S E C T IO N I I I . í 1
33 étoit, d’après les autorités citées, le tombeau d’Osymandyas, qui paroît l’em-
33 porter de beaucoup sur les autres, non-seulement par la somptuosité de sa
33 construction, mais encore par l’habileté des ouvriers qui l’ont bâti. 33
Pour être convaincu de l'identité du palais de Memnon et du monument décrit
par Diodore sous la dénomination de tombeau d ’Osymandyas, il suffit, pour ainsi
dire, dè jeter les yeux sur le plan topographique de la plaine de Thèbes et sur les
plan? particuliers et les vues de l’édifice, après avoir lu avec un peu d’attention
la description rapportée par l’historien que nous citons, et celle que nous avons
donnée nous-mêmes du palais de Memnon. Cependant, pour lever tous les doutes,
nous allons établir la comparaison des deux descriptions, pour ains.i dire partie
par partie , et justifier la traduction que nous venons de donner du passage de
Diodore qui s’y rapporte. Nous ferons voir avec quelle facilité on 'peut se servir
des ruines encore existantes, tant pour restaurer l’ancien édifice, que pour éclaircir
quelques passages obscurs du récit de Diodore.
Cet historien place le monument d’Osymandyas à dix stades des premiers tombeaux
où sont déposés les corps des jeunes vierges consacrées au culte de Jupiter;
Nous avons rendu mto.a.xiJ'ac par jeunes vierges, au lieu de concubines que l’on trouve
dans les traductions : voici quelles sont nos autorités à ce sujet. Hérodote rapporte
(1) que les.prêtres du Jupiter Thébéen lui ont raconté que des Phéniciens
avoient enlevé, à Thèbes, deux femmes consacrées au service de ce dieu. II est
vrai que, dans un autre passage ( 2 ) , le même historien avance que, chez les
Égyptiens , les femmes ne peuvent être prêtresses d’aucun dieu ni d’aucune
déesse, le sacerdoce étant réservé aux seuls hommes. On pourroit croire, au
premier abord, que ces deux passages impliquent contradiction- ; cependant on
conçoit facilement que les femmes aient pu remplir quelques emplois dans les
temples, sans être pour cela chargées des fonctions éminentes du sacerdoce. Le
témoignage de Strabon confirme cette opinion. Cet historien géographe parle
en effet de ces jeunes vierges consacrées au culte de Jupiter (3). La‘ précieuse
inscription de Rosette (4) vient aussi à notre secours, et lève même absolument
toutes les incertitudes; car elle rappelle le culte établi en l’honneur de quelques
princesses de la famille des Ptolémées, très-certainement sur le modèle du culte
des anciens dieux de l’Egypte. Il y est question de Pyrrha, athlophore de Bérénice ;
d’Areia, fille de Diogène, canéphore d’Arsinoé Philadelphe; et d’Irèpe, prêtresse
d’Arsinoé Philopator ; Aétès est désigné comme le souverain pontife de la famille
des Ptolémées. •
L ’histoire de Diodore étant composée, comme il le dit lui- même, d après les
annales de l’Egypte, les mesures qu’il rapporte ne peuvent être que des mesures
en usage dans cette contrée. Tous les auteurs s’accordent à évaluer le stade Égyptien
à cent mètres (y). Les dix stades font donc mille mètres. Si 1 on prend cette distance
, et que l’on décrive sur le plan topographique un cercle autour du palais de
(1) I-Ilsc. lib. 1 1 ; cap. 54 » pag- 1 • 1 , Cil il. 1618.
(2) Hist. lib. I I , cap. 3 5 , pag. 103.
(3) Voytr^ la citation n.° II I, pag. rj8.
(4 ) V°y*l Ia citation n.° IV , à la fin de cette section,
ja g . r;S.
(5) Cinquante-une toises.