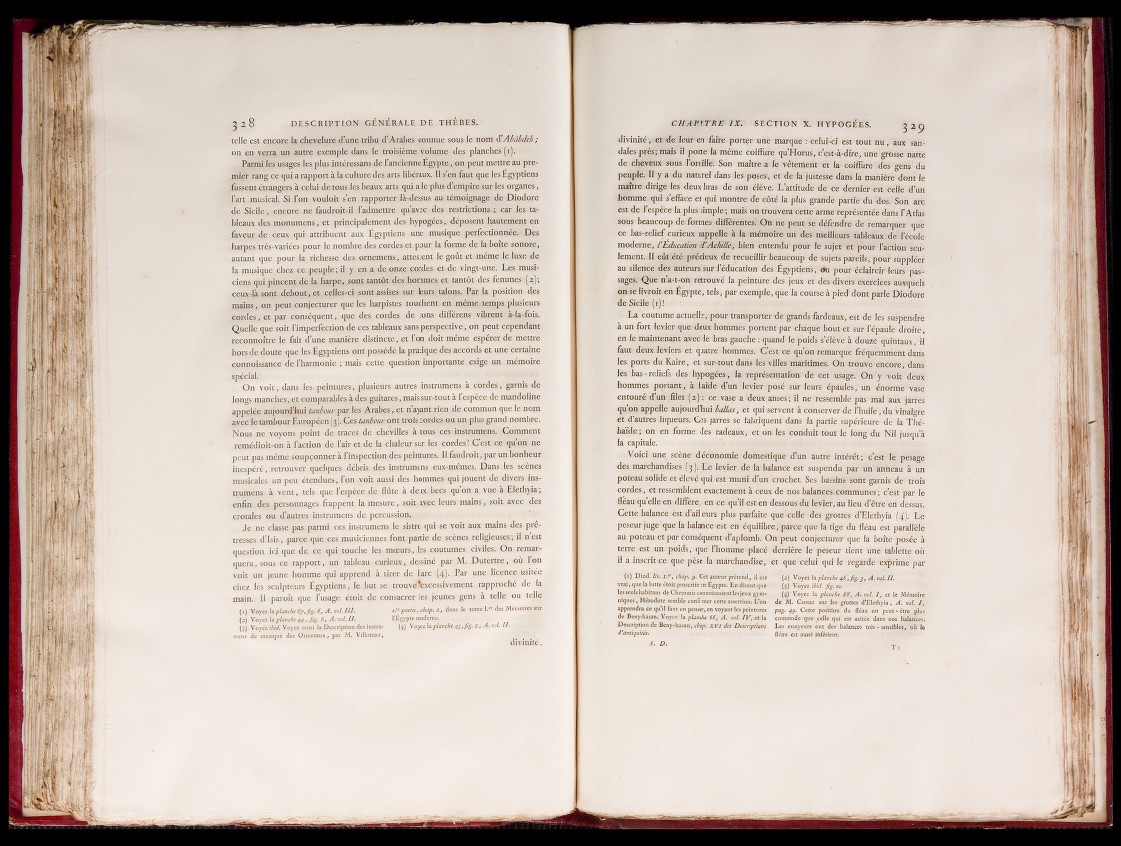
telle est encore la chevelure d’une tribu d’Arabes connue sous le nom SAbâbdeli ;
on en verra un autre exemple dans le troisième volume des planches (1).
Parmi les usages les plus intéressans de l’ancienne Egypte, on peut mettre au premier
rang ce qui a rapport à la culture des arts libéraux. Il s’en faut que les Égyptiens
fussent étrangers à celui de tous les beaux arts qui a le plus d’empire sur les organes,
l’art musical. Si l’on vouloit s’en rapporter là-dessus au témoignage de Diodore
de Sicile, encore ne faudroit-il l’admettre qu’avec des restrictions ; car les tableaux
des monumens, et principalement des hypogées, déposent hautement en
faveur de ceux qui attribuent aux Égyptiens une musique perfectionnée. Des
harpes très-variées pour le nombre des cordes et pour la forme de la boîte sonore,
autant que pour la richesse des ornemens, attestent le gout et meme le luxe de
la musique chez ce peuple; il y en a de onze cordes et de vingt-une. Les musiciens
qui pincent de la harpe, sont tantôt des hommes et tantôt des femmes (2);
ceux-là sont debout, et celles-ci sont assises sur leurs, talons. Par la position des
mains, on peut conjecturer que les harpistes touchent en même temps plusieurs
cordes, et par conséquent, que des cordes de tons différens vibrent à-la-fois.
Quelle que soit l’imperfection de ces tableaux sans perspective, on peut cependant
reconnoître le fait d’une manière distincte, et l’on doit même espérer de mettre
hors de doute que les Égyptiens ont possédé la pratique des accords et une certaine
connoissance de l’harmonie ; mais cette question importante exige un mémoire
spécial. ’
On voit, dans les peintures, plusieurs autres instrumens à cordes, garnis de
longs .manches, et comparables à des guitares, mais sur-tout a 1 espece de mandoline
appelée aujourd’hui tanbour par les Arabes, et n ayant rien de commun que le nom
avec le tambour Européen (3). Ces tanbour ont trois cordes ou un plus grand nombre.
Nous ne voyons point de traces de chevilles à tous ces instrumens. Comment
remédioit-on à l’action de l'air et de la chaleur sur les cordes I C’est ce qu’on ne
peut pas même soupçonner à l’inspection des peintures. II faudrait, par un bonheur
inespéré, retrouver quelques débris des instrumens eux-mêmes. Dans les scènes
musicales un peu étendues, Ion voit aussi des hommes qui jouent de divers instrumens
à vent, tels que l’espèce de flûte à deux becs quon a vue a Elethyia;
enfin des personnages frappent la mesure, soit avec leurs mains, soit avec des
crotales ou d’autres instrumens de percussion.
Je ne classe pas parmi ces instrumens le sistre qui se voit aux mains des prêtresses
d’Isis, parce que ces musiciennes font partie de scènes religieuses; il nest
question ici que de ce qui touche les moeurs, les coutumes civiles. On remarquera,
sous ce rapport, un tableau curieux, dessiné par M. Dutertre, où Ion
voit un jeune homme qui apprend à tirer de l’arc (4). Par une licence usitee
chez les sculpteurs Égyptiens, le but se trouve*excessivement rapproché de la
main. Il paraît que l’usage étoit de consacrer les jeunes gens à telle ou telle
(1) Voyez la planche f y , f g . 6, A . vol. I I I . ¡ . " partie, chap. 2 , dans le tome I . " des Mémoires sur
(2) Voyez la planche44., Jig. 6, A . vol. I I . 1 Égypte moderne.
(3) Voyez iiw. Voyez aussi la Description des instru- (4) Voyez la planche 2 , A . vol. l i ment
de musique des Orientaux, par M. Viiloteau, .e v
divinité,
divinité, et de leur en faire porter une marque : celui-ci est tout nu, aux sandales
près; mais il porte la même coiffure qu’Horus, c’est-à-dire, une grosse natte
de cheveux sous l’oreille. Son maître a le vêtement et la coiffure des gens du
peuple. Il y a du naturel dans les poses, et de la justesse dans la manière dont le
maître dirige les deux bras de son élève. L ’attitude de ce dernier est celle d’un
homme qui S’efface et qui montre de côté la plus grande partie du dos. Son arc
est de l’espèce la plus simple; mais on trouvera cette arme représentée dans f Atlas
sous beaucoup de formes différentes. On ne peut se défendre de remarquer que
ce bas-relief curieux rappelle à la mémoire un des meilleurs tableaux de l’école
moderne, l ’Éducation d'Achille, bien entendu pour le sujet et pour l’action seulement.
II eût été précieux de recueillir beaucoup de sujets pareils, pour suppléer
au silence des auteurs sur l’éducation des Égyptiens, du pour éclaircir leurs passages.
Que n a-t-on retroUve la peinture des jeux et des divers exercices auxquels
on se livroit en Égypte, tels, par exemple, que la course à pied dont parle Diodore
de Sicile (i)!
La coutume actuelle, pour transporter de grands fardeaux, est de les suspendre
à un fort levier que deux hommes portent par chaque bout et sur l’épaule droite,
en le maintenant avec le bras gauche ; quand le poids s élève à dou2é quintaux, il
faut deux leviers et quatre hommes. C’est ce qu’on remarque fréquemment dans
les ports du Kaire, et sur-tout dans lés villes maritimes. On trouve encore, dans
les bas - reliefs des hypogées, la représentation de cet usage. On y voit deux
hommes portant, à laide d’un levier posé sur leurs épaules, un énorme vase
entouré d’un filet (2) ; ce vase a deux anses; il ne ressemble pas mal aux jarres
qu’on appelle aujourd’hui ballas, et qui servent à conserver de l’huile, du vinaigre
et d’autres liqueurs. Ces jarres se fabriquent dans la partie supérieure de la Thé-
baide ; on en forme des radeaux, et on les conduit tout le long du Nil jusqu’à
la capitale.
Voici une scène d’économie domestique d’un autre intérêt; c’est le pesage
des marchandises (3). Le levier de la balance est suspendu par un anheau à un
poteau solide et eleve qui est muni d’un crochet. Ses bassins sont garnis de trois
cordes, et ressemblent exactement à ceux de nos balances.communes; c’est par le
fléau qu elle en diffère , en ce qu’il est en dessous du levier, au lieu d’être en dessus.
Cette balance est d ailleurs plus parfaite que celle des grottes d’Elethyia (4). Le
peseur juge que la balance est en équilibre, parce que là tige du fléau est parallèle
au poteau et par conséquent d’aplomb. On peut conjecturer que la boîte posée à
terre est un poids, que l’homme placé derrière le peseur tient une tablette où
il a inscrit ce que pèse la marchandise, et que celui qui le regarde exprime par
(i) Diod. liv. i . ,r, chap, p. Cet auteur prétend, il est (2) Voyez la planche 4.6,f ig .3 , A . vol, I I .
vrai, que la lutte étoit proscrite en Égypte. En disant que (3) Voyez ibid. Jig. 10.
les seuls habitans deChemmis connoissoient les jeux gym- (4) Voyez la planche 68, A . vol. I , et le Mémoire
niques, Hérodote semble confirmer cette assertion. L’on de M. Costaz sur les grottes d’Elethyia, A . vol. I ,
apprendra ce qu’il faut en penser, en voyant les peintures pag. 49. Cette position du fléau est peut - être plus
de Beny-hasan. Voyez la planche 66, A . vol. IV , et la commode que celle qui est usitée dans nos balances.
Description de Beny-hasan, chap. x V I des Descriptions Les essayeurs-ont des balances très - sensibles, où le
d antiquités. fléau est aussi inférieur.
M M T 1