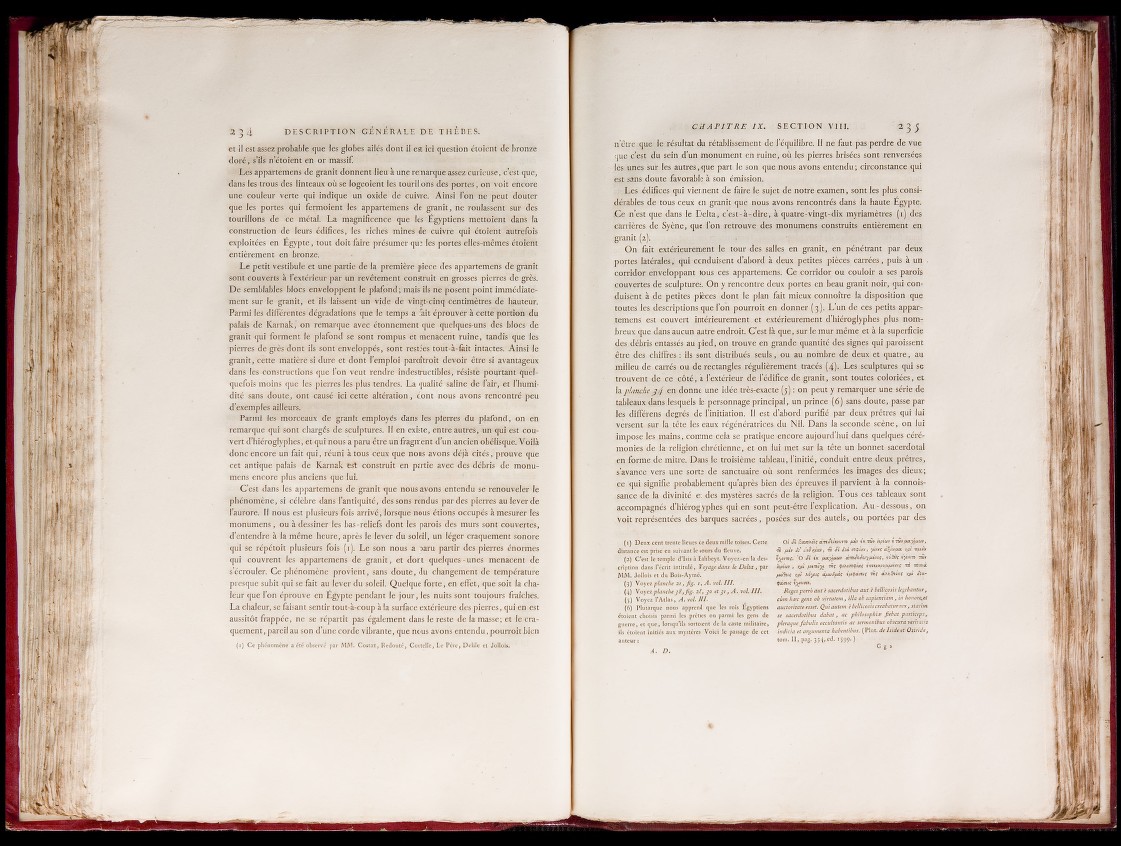
et il est assez probable que les globes ailés dont il est ici question étoient de bronze
doré, s’ils n’étoient en or massif.
Les appartemens de granit donnent lieu à une remarque assez curieuse, c’est que,
dans les trous des linteaux où se logeoient les tourillons des portes, on voit encore
une couleur verte qui indique un oxide de cuivre. Ainsi l’on ne peut douter
que les portes qui fermoient les appartemens de granit, ne roulassent sur des
tourillons de ce métal. La magnificence que les Egyptiens mettoient dans la
construction de leurs édifices, les riches mines de cuivre qui étoient autrefois
exploitées en Egypte, tout doit faire présumer que les portes elles-mêmes étoient
entièrement en bronze.
Le petit vestibule et une partie de la première piece des appartemens de granit
sont couverts à l’extérieur par un revêtement construit en grosses pierres de grès.
De semblables blocs enveloppent le plafond ; mais ils ne posent point immédiatement
sur le granit, et ils laissent un vide de vingt-cinq centimètres de hauteur.
Parmi les différentes dégradations que le temps a fait éprouver à cette portion du
palais de Karnak, on remarque avec étonnement que quelques-uns des blocs de
granit qui forment lé plafond se sont rompus et menacent ruine, tandis que ies
pierres de grès dont ils sont enveloppés, sont restées tout-à-feit intactes. Ainsi le
granit, cette matière si dure et dont l’emploi paroîtroit devoir être si avantageux
dans les constructions que l’on veut rendre indestructibles, résiste pourtant quelquefois
moins cjue les pierres les plus tendres. La qualité saline de l’air, et l’humidité
sans doute, ont causé ici cette altération, dont nous avons rencontré peu
d’exemples ailleurs.
Parmi les morceaux de granit employés dans les pierres du plafond, on en
remarque qui sont chargés de sculptures. Il en existe, entre autres, un qui est couvert
d’hiéroglyphes, et qui nous a paru être un fragment d’un ancien obélisque. Voilà
donc encore un fait qui, réuni à tous ceux que nous avons déjà cités, prouve que
cet antique palais de Karnak est construit en partie avec des débris de monumens
encore plus anciens que lui.
C’est dans les appartemens de granit que nous avons entendu se renouveler le
phénomène, si célèbre dans l’antiquité, des sons rendus par des pierres au lever de
l’aurore. Il nous est plusieurs fois arrivé, lorsque nous étions occupés à mesurer les
monumens, ou à dessiner les bas-reliefs dont les parois des murs sont couvertes,
d’entendre à la même heure, après le lever du soleil, un léger craquement sonore
qui se répétoit plusieurs fois (i). Le son nous a paru partir des pierres énormes
qui couvrent les appartemens de granit, et dont quelques-unes menacent de
s’écrouler. Ce phénomène provient, sans doute, du changement de température
presque subit qui se fait au lever du soleil. Quelque forte, en effet, que soit la chaleur
que l’on éprouve en Egypte pendant le jour, les nuits sont toujours fraîches.
La chaleur, se faisant sentir tout-à-coup à la surface extérieure des pierres, qui en est
aussitôt frappée, ne se répartit pas également dans le reste de la masse; et le craquement,
pareil au son d’une corde vibrante, que nous avons entendu, pourroit bien
(i) Ce phénomène a été observé par MM. Costaz, Redouté, Coutelle, Le Père, Delile et Jollois.
n’être que le résultat du rétablissement de l’équilibre. Il ne faut pas perdre de vue
que c’est du sein d’un monument en ruine, où les pierres brisées sont renversées
lés unes sur les autres, que part le son que nous avons entendu; circonstance qui
est sans doute favorable à son émission.
Les édifices qui viennent de faire le sujet de notre examen, sont les plus considérables
de tous ceux en granit que nous avons rencontrés dans la haute Egypte.
.Ce n’est que dans le Delta, c’est-à-dire, à quatre-vingt-dix myriamètres (i) des
carrières de Syène, que l’on retrouve des monumens construits entièrement en
granit (z). . , . S‘ ' ' y , ’
On fait extérieurement le tour des salles en granit, en pénétrant par deux
portes latérales, qui conduisent d’abord à deux petites pièces carrées, puis à un .
corridor enveloppant tous ces appartemens. Ce corridor ou cpuloir a ses parois
couvertes de sculptures. On y rencontre deux portes en beau granit noir, qui conduisent
à de petites pièces dont le plan fait mieux connoître la disposition que
toutes les descriptions que l’on pourroit en donner (3). L ’un de ces petits appartemens
est couvert intérieurement et extérieurement d’hiéroglyphes plus nombreux
que dans aucun autre endroit. C’est là que, sur le mur même et à la superficie
des débris entassés au pied, on trouve en grande quantité des signes qui paroissent
être des chiffres : ils sont distribués seuls, ou au nombre de deux et quatre, au
milieu de carrés ou de rectangles régulièrement tracés (4). Les sculptures qui se
trouvent de ce côté, à l’extérieur de ledifice de granit, sont toutes coloriées, et
la planche $ 4 en donne une idée très-exacte (j) : on peut y remarquer une série de
tableaux dans lesquels le personnage principal, un prince (6) sans doute, passe par
les différens degrés de l’initiation. Il est d’abord purifié par deux prêtres qui lui
versent sur la tête les eaux régénératrices du Nil. Dans la seconde scène, on lui
impose les mains, comme cela se pratique encore aujourd’hui dans quelques cérér
monies de la-religion chrétienne, et on lui met sur la tête un bonnet sacerdotal
en forme de mitre. Dans le troisième tableau, l’initié, conduit entre deux prêtres,
s’avance vers une sorte de sanctuaire où sont renfermées les images des dieux;
ce qui signifie probablement qu’après bien des épreuves il parvient à la connois-
sance de la divinité et des mystères sacrés de la religion. Tous ces tableaux sont
accompagnés d’hiéroglyphes qui en sont peut-être l’explication. Au - dessous, on
Voit représentées des barques sacrées, posées sur des autels, ou portées par des
(1) Deux cent trente lieues de deux mille toises. Cette
distance est prise en suivant le cours du fleuve.
(2) C'est le temple d’isis à Bahbeyt. Voyez-en la description
dans l’écrit intitulé, Voyage dans le D elta, par
MM. Jollois et du Bois-Aymé.
(3) V°yez planche 2 1 , fig. 1 , A . vol. I I I .
(4) Voyez planche 3 8 , fig. 28 , 30 et 3 1 , A . vol. I I I .
(5) Voyez l’Atlas, A . vol. I I I .
(6) Plutarque nous apprend que les rois Egyptiens
étoient choisis parmi les prêtres ou parmi les gens de
guerre, et que, lorsqu’ils sortoient de la caste militaire,
ils étoient initiés aux mystères. Voici le passage de cet
auteur : .
A . D .
O l ßaatXHC ¿■nSlix.yvvn /my Ìk tuy itpiay n Tuvpa^uar,
•» p i i l ì ¿ìI'eloLV, « S i S là m fla v , ytYVC àZicoua. jyu tì/miv
in erite. 'O S Ì Ìk pcLjSpüiv etmStStiy/Mrof, tv Sò f t j i v in 70V
ìiptùìY , xal vie <p/Accro<p/(*i im*txpvpp.ime to Ä a
u ó% i( Kffì hóyne àpuSpàc ìpufàmie v ie àfo id tia e ¡¡su Slamarne
iyoumv.
Reges porrò aut è sacerdoùbus aut ì belli cosis legebantur,
cùm li tee gens ob virtutem, illa ab sapiennam, in honore^et
auctoritatc esset. Qui autem è bellicosiscreabaturrex, statim
se sacerdotibus dabat, ac philosophic fiebat particeps^
pleraque fabulis occultantis ac sermonibus obscura veritatis
indicia et argumenta habentibus. (Plut. de Iside et Osiride,
tom . I I , p a g. 3 5 4 , e d . 1 5 9 9 . )
C g »