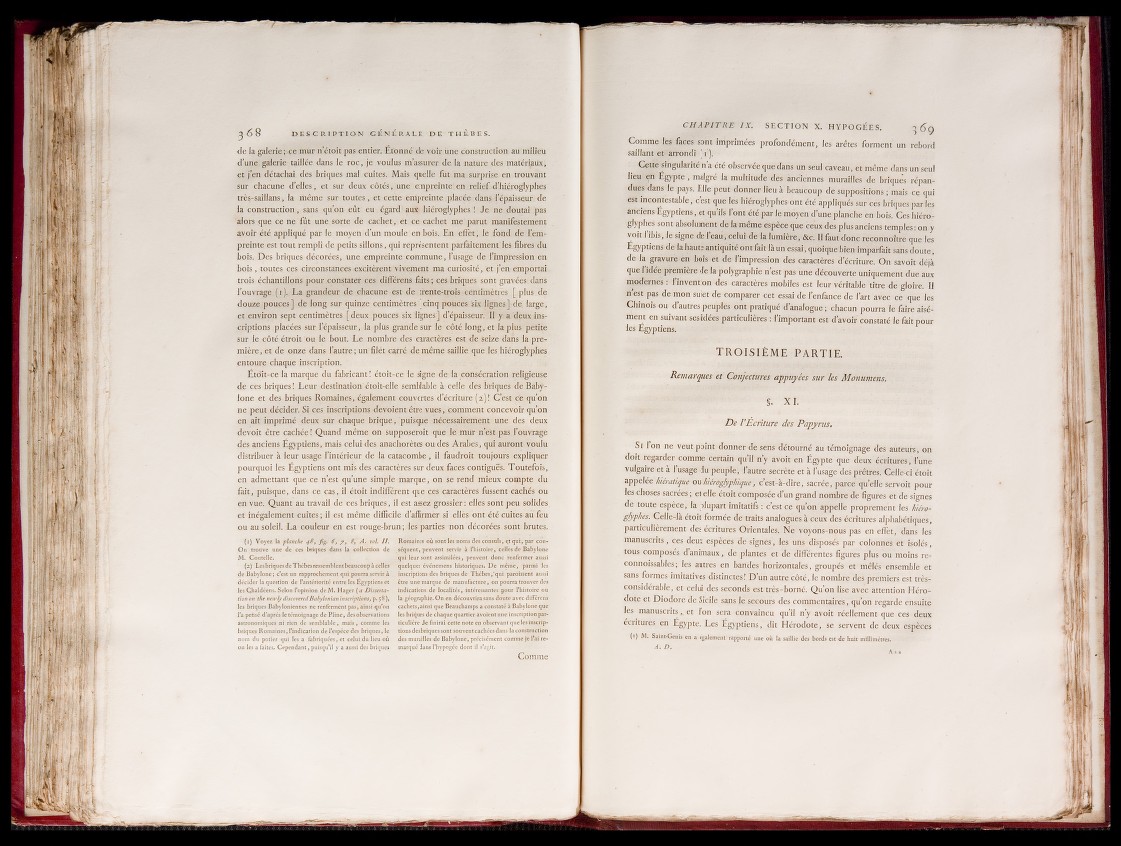
de la galerier.ee mur n’étoit pas entier. Étonné de voir une construction au milieu
d’une galerie taillée dans le roc, je voulus m’assurer de la nature des matéri,aiix,
et j’en détachai des briques mal cuites. Mais quelle fut ma surprise en trouvant
sur chacune d’elles, et sur deux côtés, une empreinte en relief d’hiéroglyphes
très-saillans, la même sur toutes, et cette empreinte placée dans l’épaisseur de
la construction, sans qu’on eût eu égard aux hiéroglyphes ! Je ne doutai pas
alors que ce ne fût une sorte de cachet, et ce cachet me parut manifestement
avoir été appliqué par le moyen d’un moule en bois. En effet, le fond de l’empreinte
est tout rempli de petits sillons, qui représentent parfaitement les fibres du
bois. Des briques décorées, une empreinte commune, l’usage de l’impression en
bois , toutes ces circonstances excitèrent vivement ma curiosité, et j’en emportai
trois échantillons pour constater ces différens faits; ces briques sont gravées.dans
l’ouvrage ( 1 ). La grandeur de chacune est de trente-trois centimètres [ plus de
douze pouces] de long sur quinze centimètres [cinq pouces six lignes] dé. large,
et environ sept centimètres [ deux pouces six lignes] d’épaisseur. Il y a deux inscriptions
placées sur l’épaisseur, la plus grande sur le côté long, et la plus petite
sur le côté étroit ou le bout. Le nombre des caractères est de seize dans la première,
et de onze dans l’autre; un filet carré de même saillie que les hiéroglyphes
entoure chaque inscription.
Étoit-ce la marque du fabricant ! étoit-ce le signe de la consécration religieuse
de ces briques'. Leur destination étoit-elle semblable à celle des briques de Babÿ-
lone et des briques Romaines, également couvertes d’écriture (2)! C’est ce qu’on
ne peut décider. Si ces inscriptions devoient être vues, comment concevoir qu’on
en ait imprimé deux sur chaque brique, puisque nécessairement une des deux
devoit être cachée i Quand même on supposerait que le mur n’est pas l’ouvrage
des anciens Égyptiens, mais celui des anachorètes ou des Arabes, qui auront voulu
distribuer à leur usage l’intérieur de la catacombe, il faudrait toujours expliquer
pourquoi les Égyptiens ont mis des caractères sur deux faces contiguës. Toutefois,
en admettant que ce n’est qu’une simple marque, on se rend mieux compte du
fait, puisque, dans ce cas, il étoit indifférent que ces caractères fussent cachés ou
en vue. Quant au travail de ces briques, il est assez grossier: elles sont peu solides
et inégalement cuites ; il est même difficile d’affirmer si elles ont été cuites au feu
ou au soleil. La couleur en est rouge-brun; les parties non décorées sont brutes.
(1) Voyez la planche 4 8 , fig. 8 , 7 , 8, A . vol. I I .
On trouve une de ces briques dans la collection de
M. Coutelle.
(2) Les briques de Thèbes ressemblent beaucoup à celles
de Babylone ; c'est un rapprochement qui pourra servir à
décider la question de l’antériorité entre les Egyptiens et
les Qhaldéens. Selon l'opinion de M. Hager ( a Dissertation
on the newly discovered Babylonian inscriptions, p. 58),
les briques Babyloniennes ne renfermënt pas, ainsi qu'on
l'a pensé d’après le témoignage de P line, des observations
astronomiques ni rien de semblable, mais, comme les
briques Romaines, l’indication de l’espèce des briques, le
nom du potier qui Tes a fabriquées, et celui du lieu où
on les a faites. Cependant, puisqu'il y a aussi des briques
Romaines où sont les noms des consuls, et qui, par conséquent,
peuvent servir à l'histoire, celles de Babylone
qui leur sont assimilées, peuvent donc renfermer aussi
quelques événemens historiques. De même, parmi les
inscriptions des briques de Thèbes,’ qui paroissent aussi
être une marque de manufacture, on pourra trouver des
indications de localités, intéressantes pour l’histoire ou
la géographie. On en découvrira sans doute avec différens
cachets, ainsi que Beauchamps a constaté à Babylone que
les briques de chaque quartier avoient une inscription particulière.
Je finirai cette note en observant que les inscriptions
des briques sont souvent cachées dans la construction
des murailles de Babylone, précisément comme Je l’ai remarqué
dans l’hypogée dont il s’agi{.
Comme
Comme les faces sont imprimées profondément, les arêtes forment un rebord
saillant et arrondi ( i ).
Cette singularité n’a été observée que dans un seul caveau, et même dans un seul
lieu en Égypte , malgré la multitude des anciennes murailles de briques répandues
dans le pays. Elle peut donner lieu à beaucoup de suppositions ; mais ce qui
est incontestable, c est que les hiéroglyphes ont été appliqués sur ces briques parles
anciens Egyptiens, et qu’ils l’ont été par le moyen d’une planche en bois. Ces hiéroglyphes
sont absolument de la même espèce que ceux des plus anciens temples : on y
voit l’ibis, le signe de l’eau, celui de la lumière, &c. II faut donc reconnoître que les
Egyptiens de la haute antiquité ont fait là un essai, quoique bien imparfait sans doute,
de la gravure en bois et de l’impression des caractères d’écriture. On savoit déjà
que l’idée première de la polygraphie n’est pas une découverte uniquement due aux
modernes : 1 invention des caractères mobiles est leur véritable titre de gloire. Il
n’est pas de mon sujet de comparer cet essai de l’enfance de l’art avec ce que les
Chinois ou d’autres peuples ont pratiqué d’analogue ; chacun pourra le faire aisément
en suivant ses idées particulières : l’important est d’avoir constaté le fait pour
les Égyptiens.
TROIS IÈME PARTIE.
Remarques et Conjectures appuyées sur les Monumens.
%. X I .
De l ’Ecriture des Papyrus.
St 1 on ne veut point donner de sens détourné au témoignage des auteurs, on
doit regarder comme certain quil n’y avoit en Égypte que deux écritures, l’une
vulgaire et à l’usage du peuple, l’autre secrète et à l’usage des prêtres. Celle-ci étoit
appelée hiératique ou hiéroglyphique, c’est-à-dire, sacrée, parce qu’elle servoit pour
les choses sacrées ; et elle etoit composée d’un grand nombre de figures et de signes
de toute espèce, la plupart imitatifs : c’est ce qu’on appelle proprement les hiéroglyphes.
Celle-là étoit formée de traits analogues à ceux des écritures alphabétiques,
particulièrement des écritures Orientales. Ne voyons-nous pas en effet, dans les
manuscrits, ces deux espèces de signés, les uns disposés par colonnes et isolés,
tous composes danimaux, de plantes et de différentes figures plus ou moins re-
connoissables; les autres en bandes horizontales, groupés et mêlés ensemble et
sans formes imitatives distinctes! D’un autre côté, le nombre des premiers est très-
considérable, et celui des seconds est très-borné. Qu’on lise avec attention Hérodote
et Diodore de Sicile sans le secours des commentaires, qu’on regarde ensuite
les manuscrits k et l’on sera convaincu qu’il n’y avoit réellement que ces deux
écritures en Égypte. Les Égyptiens, dit Hérodote, se servent de deux espèces
(i) M. Saint-Genis en a également rapporté une où la saillie des bords est de huit millimètres.
A. D.