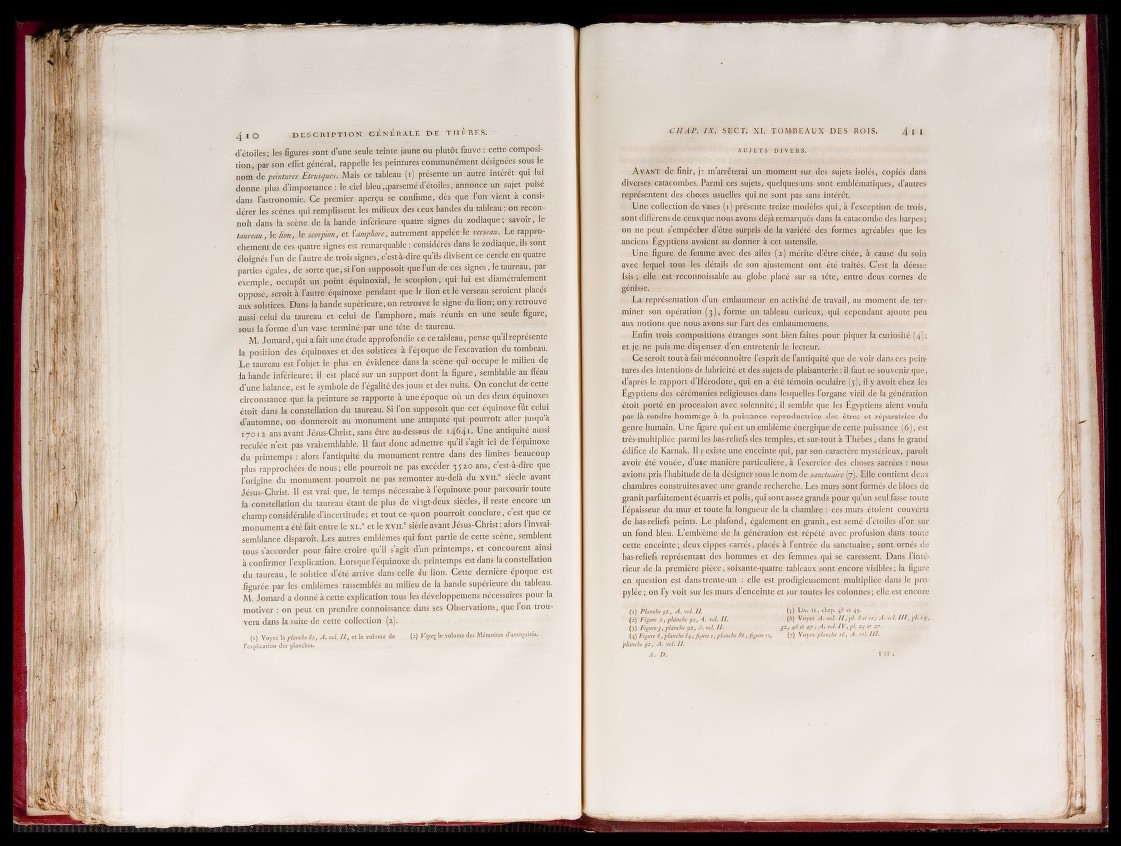
d’étoiles; les figures sont d’une seule teinte jaune ou plutôt fauve : cette composition,
par son effet général, rappelle les peintures communément désignées sous le
n o m de peintures Étrusques. Mais ce tableau (l) présente un autre intérêt qui lui
donne plus d’importance : le ciel bleu,.parsemé d’étoiles, annonce un sujet puisé
dans l’astronomie. Ce premier aperçu se confirme, dès que l’on vient à considérer
les scènes qui remplissent les milieux des deux bandes du tableau : on recon-
noît dans la scène de la bande inférieure quatre signes du zodiaque; savoir, le
taureau, le lion, le scorpion, et l’amphore, autrement appelée le Verseau. Le rapprochement
de ces quatre signes est remarquable : considérés dans le zodiaque, ils sont
éloignés l’un de l’autre de trois signes, c’est-à-dire qu’ils divisent ce cercle en quatre
parties égales, de sorte que,si l’on supposoit que l’un de ces signes, le taureau, par
exemple, occupât un point équinoxial, le scorpion, qui lui est diamétralement
opposé, seroit à l’autre équinoxe pendant que le lion et le verseau seroient placés
aux solstices. Dans la bande supérieure, on retrouve le signe du lion; on y retrouve
aussi celui du taureau et celui de 1 amphore, mais reunis en une seule figuie,
sous la forme d’un vase terminé-par une tête de taureau.
M. Jomard, qui a fait une étude approfondie de ce tableau, pense qu il représente
la position' des équinoxes et des solstices à l’époque de l’excavation du tombeau.
Le taureau est l’objet le plus en évidence dans la scene qui occupe le milieu de
la bande inférieure ; il est placé sur un support dont la figure, semblable au fléau
d’une balance, est le symbole de l’égalité des jours et des nuits. On conclut de cette
circonstance que la peinture se rapporte à une époque où un des deux equinoxes
étoit dans la constellation du taureau. Si 1 on supposoit que cet equinoxe fut celui
d’automne, on donneroit au monument une antiquité qui pourroit aller jusquà
170 1 2 ans avant Jésus-Christ, sans être au-dessous de 14641 • Une antiquité aussi
reculée n’est pas vraisemblable. Il faut donc admettre qu il s agit ici de I équinoxe
du printemps : alors l’antiquité du monument rentre dans des limites beaucoup
plus rapprochées de nous; elle pourroit ne pas excéder 3520 ans, c’est-à-dire que
l’origine du monument pourroit ne pas remonter au-delà du xvn.c siècle avant
Jésus-Çhrist. Il est vrai que, le temps nécessaire à lequinoxe pour parcourir toute
la constellation du taureau étant de plus de vingt-deux siècles, il reste encore un
champ considérable d’incertitude ; et tout ce qu on pourroit conclure, c est que ce
monument a été fait entre le x l .c et le x v i i .c siecle avant Jesus-Christ. alors 1 inyiai-
semblance disparoît. Les autres emblèmes qui font partie de cette scene, semblent
tous s’accorder pour faire croire qu’il s’agit d’un printemps, et concourent ainsi
à confirmer l’explication. Lorsque l’équinoxe du printemps est dans la constellation
du taureau, le solstice d’été arrive dans celle du lion. Cette derniere epoque est
figurée par les emblèmes rassemblés au milieu de la bande supérieure du tableau.
M. Jomard a donné à cette explication tous les développemens nécessaires pour la
motiver : on peut en prendre connoissance dans ses Observations, que 1 on trouvera
dans la suite de cette collection (2).
(1) Voyez lu planche Sz, A . vol. I I , et le volume de (2) Voyez le volume des Mémoires d’amiquiiw.
l'explication des planches.
S U J E T S ’ D I V E R S .
A v a n t de finir, je m’arrêterai un moment sur des sujets isolés, copiés dans
diverses catacombes. Parmi ces sujets, quelques-uns sont emblématiques, d’autres
représentent des choses usuelles qui ne sont pas sans intérêt.
Une collection de vases (1) présente treize modèles qui, à l’exception de trois,
sont difiérens de ceux que nous avons déjà remarqués clans la catacombe des harpes ;
on ne peut s’empêcher d’être surpris de la variété des formes agréables que les
anciens Egyptiens avoient su donner à cet ustensile.
Une figure de femme avec des ailes (2) mérite d’être citée, à cause du soin
avec lequel tous les détails de son ajustement ont été traités. C’est la déesse
Isis ; elle est reconnoissabie au globe placé sur sa tête, entre deux cornes de
génisse.
La représentation d’un embaumeur en activité de travail, au moment de terminer
son opération (3), forme un tableau curieux, qui cependant ajoute peu
aux notions que nous avons sur l’art des embaumemens.
Enfin trois compositions étranges sont bien faites pour piquer la curiosité (4) ;
et je ne puis me dispenser d’en entretenir le lecteur.
Ce seroit tout-à-fait méconnoître l’esprit de l’antiquité que de voir dans ces peintures
des intentions de lubricité et des sujets de plaisanterie : il faut se souvenu- que,
d’après le rapport d’Hérodote, qui en a été témoin oculaire (5), il y avoit chez lès
Égyptiens des cérémonies religieuses dans lesquelles l’organe viril de la génération
étoit porté en procession avec solennité; il semble que les Égyptiens aient voulu
par-là rendre hommage à la puissance reproductrice des êtres et réparatrice du
genre humain. Une figure qui est un emblème énergique de cette puissance (6), est
très-multipliée parmi les bas-reliefs des temples, et sur-tout à Thèbes, dans le grand
édifice de Karnak. Il y existe une enceinte qui, par son caractère mystérieux, paroît
avoir été vouée, d’une manière particulière, à l’exercice des choses sacrées : nous
avions pris l’habitude de la désigner sous le nom de sanctuaire (7). Elle contient deux
chambres construites avec une grande recherche. Les murs sont formés de bloès de
granit parfaitement équarris et polis, qui sont assez grands pour qu’un seul fasse toute
l’épaisseur du mur et toute la longueur de la chambre : ces murs étoient couverts
de bas-reliefs peints. Le plafond, également en granit, est semé d’étoiles d’or sur
un fond bleu. L ’emblème de la génération est répété avec profusion dans toute
cette enceinte; deux cippes carrés, placés à l’entrée du sanctuaire, sont ornés de
bas-reliefs représentant des hommes et des femmes qui se caressent. Dans l’intérieur
de la première pièce, soixante-quatre tableaux sont encore visibles ; la figure
en question est dans trente-un : elle est prodigieusement multipliée dans le propylée
; on l’y voit sur les murs d’enceinte et sur toutes les colonnes ; elle est encore
(1) Planche92., A . vol. 11. (5) Liv. I I , chap. 48 et 49. .
(2) Figure 2 , planche 9 1 , A . vol. 11. (6) Voyez A. vol. I I , pl. S et 1 1 1 A . vol. I I I , pl. ¡4 ,
(3) F igu r e j, planche 9 2 , A . vol. I I . 3 2 , 46 et 4 7 ; A . vol. IV , pl. 24 et 27.
(4) Figure 6, planche 8 4 ; figure t , planche 36 ; figure tt, (7) Voyez planche 16, A . vol, I I I .
planche 9 2 , A . vol. 11.