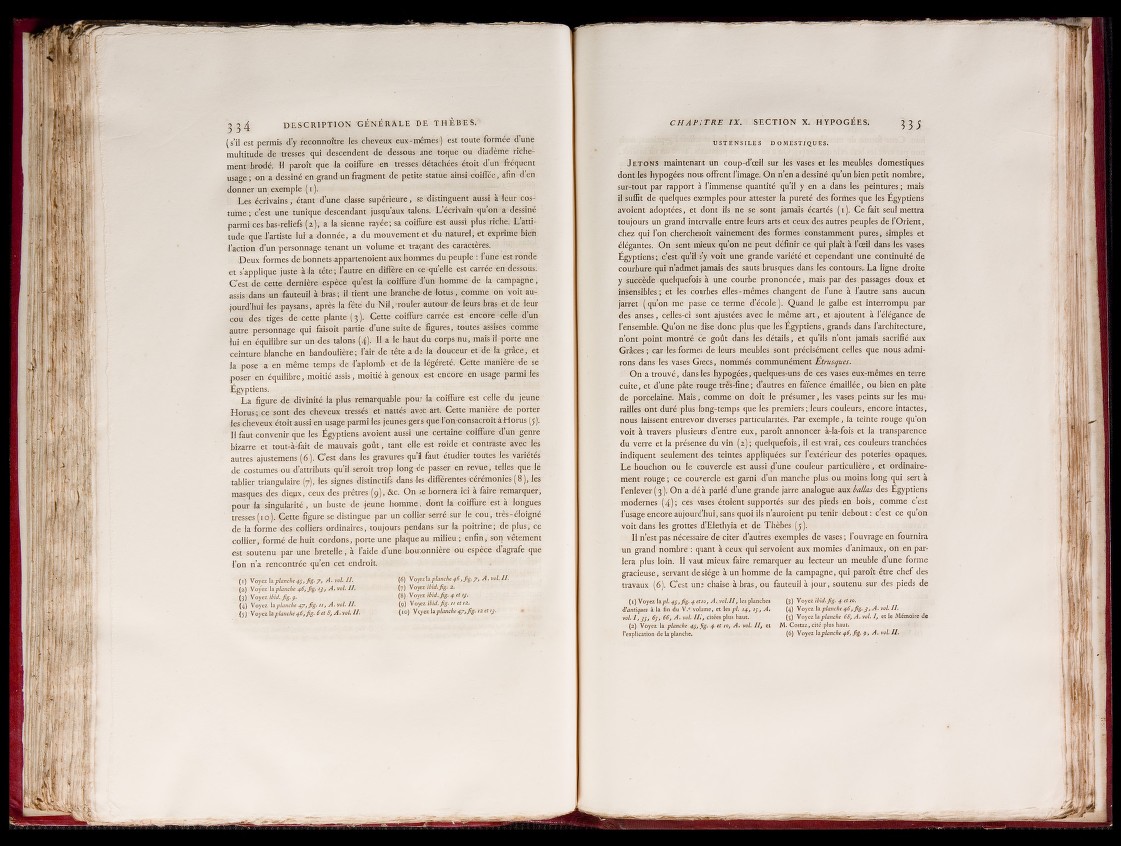
(s’il est permis d’y reconnoître les cheveux eux-mêmes) est toute formée d’une
multitude de tresses qui descendent de dessous une toque ou diadème richement
brodé. Il paroît que la coiffure en tresses détachées étoit d’un fréquent
usage ; on a dessiné en.grand un fragment de petite statue ainsi coiffée, afin d en
donner un exempte ( i ).
Les écrivains, étant d’une classe supérieure, se distinguent aussi a leur costume
; c’est une tunique descendant jusqu’aux talons. L écrivain qu on a dessiné
parmi ces bas-reliefs ( 2), a la sienne rayée-, sa coiffure est aussi plus riche. L ’attitude
que l ’artiste lui a donnée, a du mouvement et du naturel, et exprime bien
l’action d’un personnage tenant un volume et traçant des caractères.
Deux formes de bonnets appartenoient aux hommes du peuple : 1 une est ronde
et s’applique juste à la tête; l’autre en diffère en ce -quelle est carree -en-dessous.
C’est de cette dernière espèce qu est la coiffure d un homme de la campagne,
assis dans un fauteuil à bras; il tient une branclre de -lotus, comme on voit aujourd’hui
les paysans, après la fêté du Nil, rouler autour de leurs bras et de leur
cou des tiges de cette plante (3). Cette coiffure carrée est encore celle d’un
autre personnage qui faisoit partie d une suite de .figures, toutes-assises comme
|ui en équilibre sur un des talons (4). II n Ie haut du corps nu, mais il porte une
ceinture blanche en bandoulière ; 1 air de tete a de la douceur et de la gr-ace, et
la pose a en même temps de l ’aplomb et de la legerete. Cette manière de se
poser en équilibre, moitié assis, moitié à genoux, est encore en usage parmi les
Egyptiens.
La figure de divinité la plus remarquable pour la coiffure -est celle du jeune
fjorus, ce sont des cheveux tressés et nattés avec art. Cette manière de porter
les cheveux étoit aussi en usage parmi les jeunes gens que 1 onconsacroit a-Horus (y).
II faut convenir que les Égyptiens avoient aussi une certaine coiffure dun genre
bizarre et tout-à fait de mauvais goût, tant elle est roide et contraste avec les
autres ajustemens (6). Cest dans -les gravures qu’il faut étudier toutes les variétés
de costumes ou d’attributs qu’il seroit trop long de passer en revue, telles que le
tablier triangulaire (7), les signes distinctifs dans -les différentes Cérémonies (8), les
masques des dieux, ceux des prêtres (9), &c. On se bornera ici a faire remarquer,
pour la singularité , un buste de jeune homme, dont la coiffure est à longues
tresses (10). Cette figure se distingue par un collier serré sur le cou, très-éloigné
de la forme des colliers ordinaires, toujours pendans sur la poitrine; de plus, ce
collier, formé de huit cordons, porte une plaque au milieu ; enfin, son vetement
est soutenu par une bretelle, à 1 aide d une boutonnière ou espece d agrafe que
l’on n’a rencontrée qu’en cet endroit,
( 0 Voyez la planche fig. 7 , A . vol. I I . \6) Voyezla planche+ 6 , fig. 7 , A . v o l I I .
(2) Voyez la planche 46, fig. i j , A .vo l. I I . (7) Voyez ihid.fig. 2.
(3) Voyez ibid.fig.p. («■} Voyez ibid.fig. 4 et //.
(4) Voyez la p l a n c h e 4 7 , fig .e e . A . vol. 11. (9) Voyez ibid. fig.11 et 12.
(5) Voyez h planche 46, fig. 6 a S, A . vol. I I . (10) Voy ezla planche +7, fig. 12 etej.
U S T E N S I L E S D O M E S T IQ U E S .
J e t o n s maintenant un coup-d’oeil sur les vases et les meubles domestiques
dont les hypogées nous offrent l’image. On n’en a dessiné qu’un bien petit nombre,
sur-tout par rapport à l’immense quantité qu’il y en a dans les peintures ; mais
il suffit de quelques exemples pour attester la pureté des formes que les Égyptiens
avoient adoptées, et dont ils ne se sont jamais écartés ( i ). Ce fait seul mettra
toujours un grand intervalle entre leurs arts et ceux des autres peuples de l’Orient,
chez qui l’on chercheroit vainement des formes constamment pures, simples et
élégantes. On sent mieux qu’on ne peut définir ce qui plaît à l’oeil dans les vases
Égyptiens; c’est qu’il s’y voit une grande variété et cependant une continuité de
courbure qui n’admet jamais des sauts brusques dans les contours- La ligne droite
y succède quelquefois à une courbe prononcée, mais par des passages doux et
insensibles ; et les courbes elles-mêmes changent de l’une à l’autre sans aucun
jarret ( qu’on me passe ce terme d’école ). Quand le galbe est interrompu par
des anses, celles-ci sont ajustées avec le même art, et ajoutent à l’élégance de
l’ensemble. Qu’on ne dise donc plus que les Égyptiens, grands dans l’architecture,
n’ont point montré de goût dans les détails, et qu’ils n’ont jamais sacrifié aux
Grâces ; car les formes de leurs meubles sont précisément celles que nous admirons
dans les vases Grecs, nommés communément Etrusques.
On a trouvé, dans les hypogées, quelques-uns de ces vases eux-mêmes en terre
cuite, et d’une pâte rouge très-fine; d’autres en faïence émaillée, ou bien en pâte
de porcelaine. Mais, comme on doit le présumer, les vases peints sur les murailles
ont duré plus long-temps que les premiers; leurs couleurs, encore intactes,
nous laissent entrevoir diverses particularités. Par exemple, la teinte rouge qu’on
voit à travers plusieurs d’entre eux, paroît annoncer à-la-fois et la transparence
du verre et la présence du vin (2); quelquefois, il est vrai, ces couleurs tranchées
indiquent seulement des teintes appliquées sur l’extérieur des poteries opaques.
Le bouchon ou le couvercle est aussi d’une couleur particulière, et ordinairement
rouge ; ce couvercle est garni d’un manche plus ou moins long qui sert à
l’enlever ( 3 ). On a déjà parlé d’une grande jarre analogue aux ballas des Égyptiens
modernes (4); ces vases étoient supportés sur des pieds en bois, comme c’est
l’usage encore aujourd’hui, sans quoi ils n’auroient pu tenir debout : c est ce qu on
voit dans les grottes d’Eletliyia et de Thèbes (y ).
II n’est pas nécessaire de citer d’autres exemples de vases ; l’ouvrage en fournira
un grand nombre : quant à ceux qui servoient aux momies d’animaux, on en parlera
plus loin. Il vaut mieux faire remarquer au lecteur un meuble d’une forme
gracieuse, servant de siège à un homme de la campagne, qui paroît être chef des
travaux (6). C’est une chaise à bras, ou fauteuil à jour, soutenu sur des pieds de
(1) Voyez la pl. 45, fig* 4 et ¡0, A .v o l. I I , les planches (3} Voyez ibid.fig. 4 et 10.
d’antiques à la fin du V.® volume, et les pl. 14 , i j , A , (4) Voyez la planche 4 6 ,fig. 3 , A . vol. I I .
vol. 1 , 3 5 , 6 j, 66, A . vol. I I I , citées plus haut. Voyez la planche 68, A . vol. I , et le Mémoire de
(2) Voyez la planche 43, fig. 4 et 10, A . vol. I I , et M. Costaz, cité plus haut.
l’explication de la planche. (6) Voyez \&planche 46, fig. p , A. vol. I I .