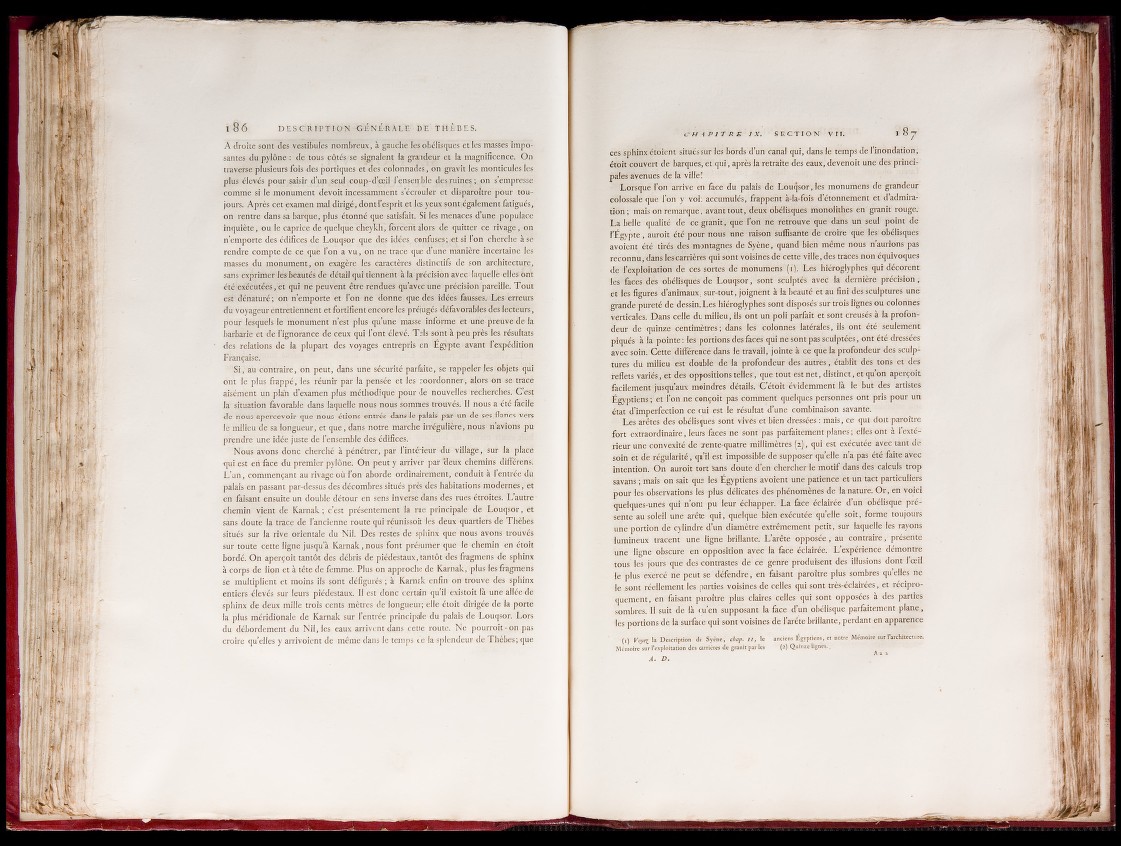
A droite sont des vestibules nombreux, à gauche les obélisques et les masses imposantes
du pylône : de tous côtés se signalent la grandeur et la magnificence. On
traverse plusieurs fois des portiques et des colonnades, on gravit les monticules les
plus élevés pour saisir d’un seul coup-d’ceil l’ensemble des ruines ; on s’empresse
comme si le monument devoit incessamment s’écrouler et clisparoître pour toujours,
Après cet examen mal dirigé, dont l’esprit et les yeux sont également fatigués,
on rentre dans sa barque, plus étonné que satisfait. Si les menaces d’une populace
inquiète, ou le caprice de quelque cheykh, forcent alors de quitter ce rivage, on
n’emporte des édifices de Louqsor que des idées confuses ; et si l’on cherche à se
rendre compte de ce que l’on a vu, on ne trace que d’une manière incertaine les
masses du monument, on exagère les caractères distinctifs de son architecture,
sans exprimer les beautés de détail qui tiennent à la précision avec laquelle elles ont
été exécutées, et qui ne peuvent être rendues qu’avec une précision pareille. Tout
est dénaturé; on n’emporte et l’on ne donne que des idées fausses. Les erreurs
du voyageur entretiennent et fortifient encore les préjugés défavorables des lecteurs,
pour lesquels le monument n’est plus qu’une masse informe et une preuve de la
barbarie et de l’ignorance de ceux qui l’ont élevé. Tels sont à peu près les résultats
des relations de la plupart des voyages entrepris en Egypte avant l’expédition
Française.
Si, au contraire, on peut, dans une sécurité parfaite, se rappeler les objets qui
ont le plus frappé, les réunir par la pensée et les coordonner, alors on se trace
aisément un plan d’examen plus méthodique pour de nouvelles recherches. C est
la situation favorable dans laquelle nous nous sommes trouvés. Il nous a etc facile
de nous apercevoir que nous étions entrés dans le palais par un de ses flancs vers
le milieu de sa longueur, et que, dans notre marche irrégulière, nous navions pu
prendre une idée juste de l’ensemble des édifices.
Nous avons donc cherché à pénétrer, par l’intérieur du village, sur la place
qui est en face du premier pylône. On peut y arriver par ‘deux chemins différens.
L ’un, commençant au rivage où l’on aborde ordinairement, conduit à 1 entrée du
palais en passant par-dessus des décombres situés près des habitations modernes, et
en faisant ensuite un double détour en sens inverse dans des rues étroites. L ’autre
chemin vient de Karnak ; c’est présentement la rue principale de Louqsor, et
sans doute la trace de l’ancienne route qui réunissoit les deux quartiers de Thèbes
situés sur la rive orientale du Nil. Des restes de sphinx que nous avons trouvés
sur toute cette ligne jusqu’à Karnak,nous font présumer que le chemin en étoit
bordé. On aperçoit tantôt des débris de piédestaux, tantôt des fragmens de sphinx
à corps de lion et à tête de femme. Plus on approche de Karnak, plus les fragmens
se multiplient et moins ils sont défigurés ; à Karnak enfin on trouve des sphinx
entiers élevés sur leurs piédestaux. 11 est donc certain qu’il existoit là une allée de
sphinx de deux mille trois cents mètres de longueur; elle étoit dirigée de la porte
la plus méridionale de Karnak sur l’entrée principale du palais de Louqsor. Lors
du débordement du Nil, les eaux arrivent dans cette route. Ne pourroit - on pas
croire qu’elles y arrivoient de même dans le temps de la splendeur de Thèbes; que
ces sphinx étoient situés sur les bords d'un canal qui, dans le temps de I inondation,
étoit couvert de barques, et qui, après la retraite des eaux, devenoit une des principales
avenues de la ville !
Lorsque l’on arrive en face du palais de Louqsor,les monumens de grandeur
colossale que l’on y voit accumulés, frappent à-la-fois d’étonnement et d admiration;
mais on remarque, avant tout, deux obélisques monolithes en granit rouge.
La belle qualité de ce granit , que l’on ne retrouve que dans un seul point de
l'Egypte, auroit été pour nous une raison suffisante de croire que les’ obélisques
avoient été tirés des montagnes de Syène, quand bien même nous n aurions pas
reconnu, dans les carrières qui sont voisines de cette ville, des traces non équivoques
de l’exploitation de ces sortes de monumens (1). Les hiéroglyphes qui décorent
les faces des obélisques de Louqsor, sont sculptés avec la dernière précision,
et les figures d’animaux, sur-tout, joignent à la beauté et au fini des sculptures une
«rande pureté de dessin. Les hiéroglyphes sont disposés sur trois lignes ou colonnes
verticales. Dans celle du milieu, ils ont un poli parfait et sont creusés à la profondeur
de quinze centimètres; dans les colonnes latérales, ils ont été seulement
piqués à la pointe : les portions des faces qui ne sont pas sculptées, ont été dressées
avec soin. Cette différence dans le travail, jointe à ce que la profondeur des sculptures
du milieu est double de la profondeur des autres, établit des tons et des
reflets variés, et des oppositions telles', que tout est net, distinct, et qu’on aperçoit
facilement jusqu’aux moindres détails. C’étoit évidemment là le but des artistes
Égyptiens ; et l’on ne conçoit pas comment quelques personnes ont pris pour un
état d’imperfection ce qui est le résultat d’une combinaison savante.
Les arêtes des obélisques sont vives et bien dressées : mais, ce qui doit paroitre
fort extraordinaire, leurs faces ne sont pas parfaitement planes ; elles ont à 1 extérieur
une convexité de trente-quatre millimètres (2), qui est exécutée avec tant dè
soin et de régularité, qu’il est impossible de supposer qu’elle n’a pas été faite avec
intention. On auroit tort Sans doute d’en chercher le motif dans des calculs trop
savans ; mais on sait que les Égyptiens avoient une patience et un tact particuliers
pour les observations les plus délicates des phénomènes de la nature. Or, en voici
quelques-unes qui n’ont pu leur échapper. La face éclairée d’un obélisque présente
au soleil une arête qui, quelque bien exécutée qu’elle soit, forme toujours
une portion de cylindre d’un diamètre extrêmement petit, sur laquelle les rayons
lumineux tracent une ligne brillante. L ’arête opposée, au contraire, présente
une ligne obscure en opposition avec la face éclairée. L ’expérience démontre
tous les jours que des contrastes de ce genre produisent des illusions dont I oeil
le plus exercé ne peut se défendre, en faisant paroître plus sombres qu’elles ne
le sont réellement les parties voisines de celles qui sont très-éclairées, et réciproquement,
en faisant paroître plus claires celles qui sont opposées a des parties
sombres. 11 suit de là qu’en supposant la face d’un obélisque parfaitement plane,
les portions de la surface qui sont voisines de l'arête brillante, perdant en apparence
(1) Voyez la Description de Syène, cliap. i l , le anciens Égyptiens, et notre Mémoire sur l'architecture.
Mémoire sur l’exploitation des carrières de granit par les (2) Quinze lignes.,
A a %
A . D .