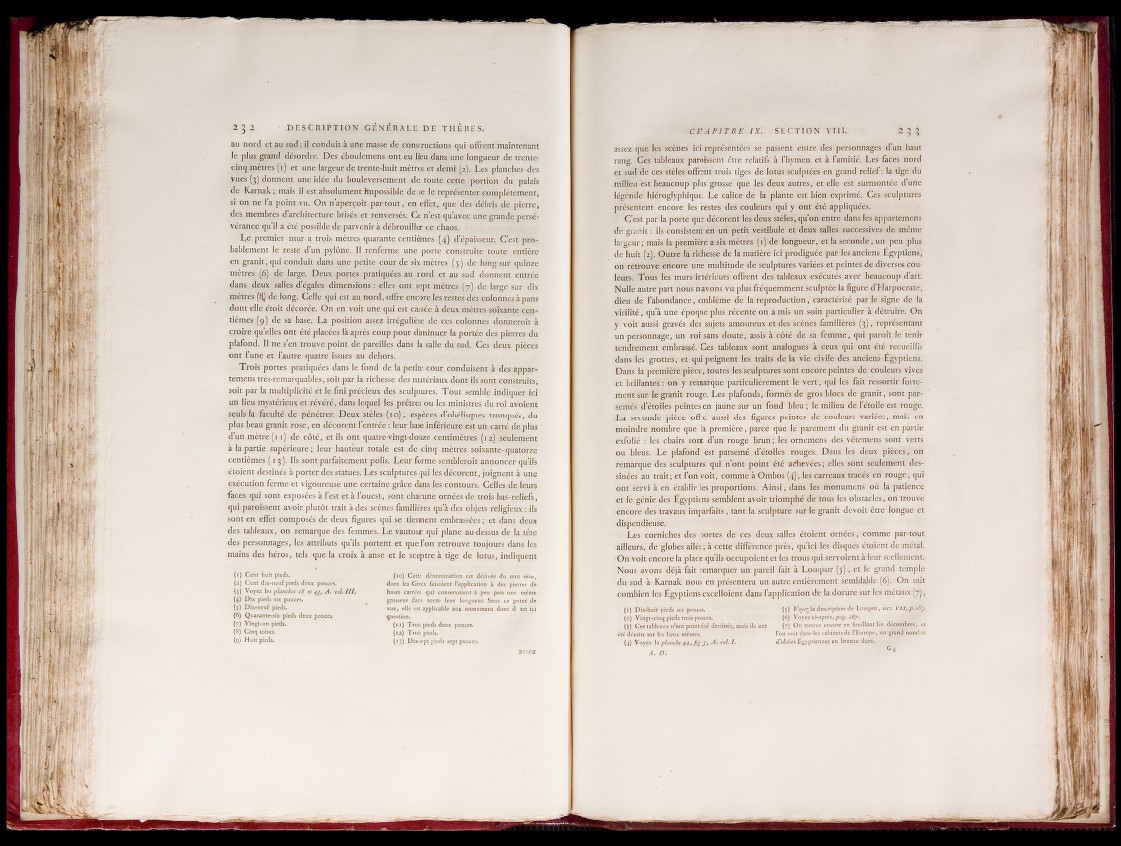
au nord et au sud : il conduit à une masse de constructions qui offrent maintenant
le plus grand désordre. Des éboulemens ont eu lieu, dans une longueur de trente-
cinq mètres (t) et une largeur de trente-huit mètres et demi (2). Les planches des
yues (3) donnent une idée du bouleversement de toute cette portion du palais
de Karnak ; mais il est absolument impossible de se le représenter complètement,
si on ne l’a point vu. On n’aperçoit par-tout, en effet, que des débris de pierre,
des membres d'architecture brisés et renversés. Ce n’est qu’avec une grande persévérance
qu’il a été possible de parvenir à débrouiller ce chaos.
Le premier mur a trois mètres quarante centièmes (4) d’épaisseur. C’est probablement
le reste d’un pylône. Il renferme une porte construite toute entière
en granit, qui conduit dans une petite cour de six mètres (y) de long sur quinze
mètres (6) de large. Deux portes pratiquées au nord et au sud donnent entrée
dans deux salles d’égales dimensions : elles ont sept mètres (7) de large sur dix
mètres (§) de long. Celle qui est au nord, offre encore les restes des colonnes à pans
dont elle étoit décorée. On en voit une qui est cassée à deux mètres soixante centièmes
(9) de sa base. La position assez irrégulière de ces colonnes donneroit à
croire qu’elles ont été placées là après coup pour diminuer la portée des pierres du
plafond. Il ne s’en trouve point de pareilles dans la salie du sud. Ces deux pièces
ont l’une et l’autre quatre issues au dehors.
Trois portes pratiquées dans le fond de la petite cour conduisent à des appar-
temens très-remarquables, soit par la richesse des matériaux dont ils sont construits,
soit par la multiplicité et le fini précieux des sculptures. Tout semble indiquer ici
un lieu mystérieux et révéré, dans lequel les prêtres ou les ministres du roi avoient
seuls la faculté de pénétrer. Deux stèles (10), espèces d’obélisques tronqués, du
plus beau granit rose, en décorent l’entrée : leur base inférieure est un carré de plus
d’un mètre (11) de côté, et ils ont quatre-vingt-douze centimètres (12) seulement
à la partie supérieure; leur hauteur totale est de cinq mètres soixante-quatorze
centièmes ( 13 ). Ils sont parfaitement polis. Leur forme sembleroit annoncer qu’ils
étoient destinés à porter des statues. Les sculptures qui les décorent, joignent à une
exécution ferme et vigoureuse une certaine grâce dans les contours. Celles de leurs
faces qui sont exposées à l’est et à l’ouest, sont chacune ornées de trois bas-reliefs,
qui paroissent avoir plutôt trait à des scènes familières qu’à des objets religieux : ils
sont en effet composés de deux figures qui se tiennent embrassées ; et dans deux
des tableaux, on remarque des femmes. Le vautour qui plane au-dessus de la tête
des personnages, les attributs qu’ils portent et que l’on retrouve toujours dans les
mains des héros, tels que la croix à anse et le sceptre à tige de lotus, indiquent
(1) Cent huit pieds.
(2) Cent dix-neuf pieds deux pouces.
(3) Voyez les planches /8 et 43, A . vol. I I I .
(4) D ix pieds six pouces.
(5) Dix-neuf pieds.
(’6) Quarante-six pieds deux pouces.
(7) Vingt-un pieds.
(8) Cinq toises.
(9) Huit pieds.
(10) Cette dénomination est dérivée du mot 01 ah ,
dont les Grecs faisoient l’application à des pierres de
bases carrées qui conservoient à peu près une même
grosseur dans toute leur longueur. Sous ce point de
vue, elle est applicable aux monumens dont il est ici
question.
( 1 1 ) Trois pieds deux pouces.
(12) Trois pieds.
(13) Dix-sept pieds sept pouces.
assez
assez que les scènes ici représentées se passent entre des personnages d un haut
rang. Ces tableaux paroissent être relatifs à l’hymen et à l’amitié. Les faces nord
et sud de ces stèles offrent trois tiges de lotus sculptées en grand relief: la tige du
milieu est beaucoup plus grosse que les deux autres, et elle est surmontée d’une
légende hiéroglyphique. Le calice de la plante est bien exprimé. Ces sculptures
présentent encore les restes des couleurs qui y ont été appliquées.
C’est par la porte que décorent les deux stèles, qu’on entre dans les àpparteinens
de granit : ils consistent en un petit vestibule et deux salles successives de même
largeur ; mais la première a six mètres (t) de longueur, et la seconde, un peu plus
de huit (2). Outre la richesse de la matière ici prodiguée par les anciens Egyptiens,
on retrouve encore une multitude de sculptures variées et peintes de diverses couleurs.
Tous les murs intérieurs offrent des tableaux exécutés avec beaucoup d’art.
Nulle autre part nous n’avons vu plus fréquemment sculptée la figure d’Harpocrate,
dieu de l’abondance, emblème de la reproduction, caractérisé par le signe de la
virilité, qu’à une époque plus récente on a mis un soin particulier à détruire. On
y voit aussi gravés des sujets amoureux et des scènes familières (3), représentant
un personnage, un roi sans doute, assis à côté de sa femme, qui paroît le tenir
tendrement embrassé. Ces tableaux sont analogues à ceux qui ont été recueillis
dans les grottes, et qui peignent les traits de la vie civile des anciens Égyptiens.
Dans la première pièce, toutes les sculptures sont encore peintes de couleurs vives
et brillantes : on y remarque particulièrement le vert, qui les fait ressortir fortement
sur le granit rouge. Les plafonds, formés de gros blocs de granit, sont parsemés
d’étoiles peintes en jaune sur un fond bleu ; le milieu de l’étoile est rouge.
La seconde pièce offre aussi des figures peintes de couleurs variées, mais en
moindre nombre que la première, parce que le parement du granit est en partie
exfolié : les chairs sont d’un rouge brun ; les ornemens des vêtemens sont verts
ou bleus. Le plafond est parsemé d’étoiles rouges. Dans les deux pièces, on
remarque des sculptures qui n’ont point été achevées; elles sont seulement dessinées
au trait; et l’on voit, comme à Ombos (4), les carreaux tracés en rouge, qui
ont servi à en établir les proportions. Ainsi, dans les monumens où la patience
et le génie des Égyptiens semblent avoir triomphé de tous les obstacles, on trouve
encore des travaux imparfaits, tant la sculpture sur le granit devoit être longue et
dispendieuse.
Les corniches des portes de ces deux salles étoient ornées, comme par-tout
ailleurs, de globes ailés ; à cette différence près, qu’ici les disques étoient de métal.
On voit encore la place qu’ils occupoient et les trous qui servoient à leur scellement.
Nous avons déjà fait remarquer un pareil fait à Louqsor (y), et le grand temple
du sud à Karnak nous en présentera un autre entièrement semblable (6). On sait
combien les Égyptiens excelloient dans l’application de la dorure sur les métaux (7) ,
(1) Dix-huit pieds six pouces. (5) Vn/<Z Ia description de Louqsor, srct. V II , p. 18;.
(2) Vingt-cinq pieds trois pouces. (6) Voyez, ci-après, pag. 2.67.
(3) Ces tableaux n’ont point été dessinés, mais ils ont (7) On trouve encore en fouillant les décombres, et
été décrits sur les lieux mêmes. l’on voit dans les cabinets de l’Europe, un grand nombre
(4) Voyez la planche 44 , Jîg. j , A . vol, / . d’idoles Égyptiennes en bronze dore.